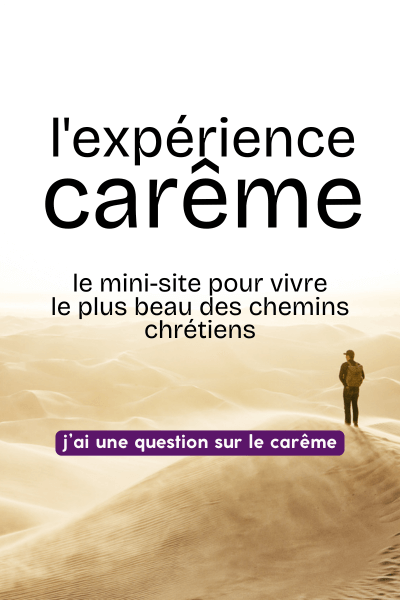Renoir, un film de Chie Hayakawa
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 17 septembre 2025, OFC 2025, n°26 – sur Renoir, un film de Chie Hayakawa
Renoir, un film de Chie Hayakawa Renoir est le deuxième film de la japonaise Chie Hayakawa. Il fut présenté au dernier Festival de Cannes, comme le fut son premier opus, Plan 75. Ce dernier, une dystopie, montre un Japon qui a choisi de « régler » la question de la vieillesse, puisque, à soixante-quinze ans, les personnes sont « recyclées », conduites à subir une euthanasie. L’OFC avait consacré une fiche à ce film, que nous recommandions.
C’est aussi avec encouragement que nous incitons à se rendre en salle pour assister à la projection de Renoir. La mort y demeure le thème principal. Ici, c’est une pré-adolescente qui s’y trouve confrontée, son père est en phase terminale d’un cancer.
Le titre se comprend au regard de la manière dont la metteuse en scène a agencé son film. Il est construit de scènes courtes qui forment une sorte de puzzle impressionniste, qui, considérées ensemble, dessinent le motif.
Une référence plus immédiate à Auguste Renoir est son tableau Portrait d’Irène Cahen d’Anvers à qui le père de la réalisatrice donna une reproduction dans son enfance.
Dans le film, c’est la jeune Fuki qui orne la chambre d’hôpital de son père d’une reproduction de cette œuvre.
Fuki est de toutes les images de ce film ; il faut souligner l’interprétation étonnante de celle qui l’incarne, Yui Suzuki ; elle est remarquable.

Le film se déroule dans les années 1980, avant l’arrivée du téléphone portable et des écrans plats ; il est nourri des expériences personnelles de la réalisatrice.
Il suit Fuki dans toutes les réactions et émotions qui surgissent en elle, du fait de la proximité de la mort de son père, des réactions des adultes dont elle est le témoin.
Par petites touches, le film montre comment l’imaginaire, le réalisme, la divination, les fantômes parfois – nous sommes au Japon –, la fuite également se croisent dans l’esprit de cette toute jeune-fille, jusqu’à la tentation d’écouter des messages sur ce que l’on appelait, à l’époque, le « téléphone rose » au risque de presque tomber dans les griffes d’un prédateur, d’un pédocriminel.
Elle est confrontée aux attitudes des adultes, avant tout celles de sa mère ; elle entend les paroles échangées par les soignants, les collègues de travail de son père… elle doit apprendre à faire avec tout cela, souvent douloureux, difficile.
Il faut beaucoup de délicatesse pour rendre perceptible ce qui se vit dans le cœur et l’esprit d’une jeune-fille de 10-11 ans ; Chie Hayakawa a cet art et cette finesse. La forme du film y consonne puisque tout est épart, éclaté, et l’on mesure la violence intime à quoi Fuki est confrontée. La cinéaste parle ainsi de son film : il s’agit de « raconter l’histoire intime d’une famille, et montrer combien les êtres humains sont à la fois fragiles, petits, et pourtant précieux ».
Renoir est de ces films par lesquels il s’agit de se laisser porter, les personnages n’y sont pas aimables, l’écriture est éclatée, mais n’en est-il pas ainsi de la vie ? Pascal Wintzer, OFC
+ Pascal Wintzer, OFC