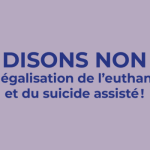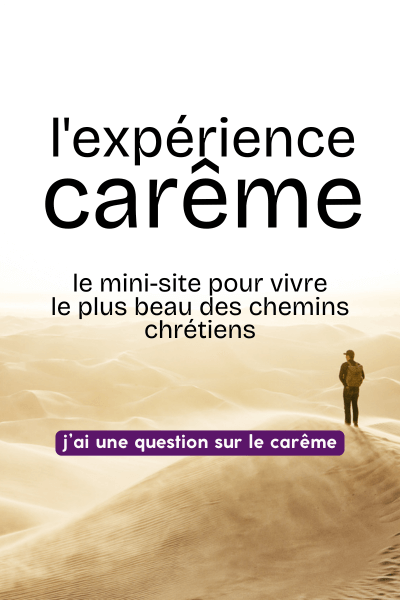La fin de vie au cinéma en 2025
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 14 mai 2025, OFC 2025, n°17 sur la fin de vie au cinéma en 2025
Bien avant les débats qui ont accompagné les différentes lois sur les soins palliatifs (1999) puis la fin de vie (Loi Leonetti – 2005), André Cayatte livrait en 1950 un film de procès retentissant sur une affaire d’euthanasie : Justice est faite. Le meurtre par sa maitresse d’un homme en stade terminal de cancer devenait alors un véritable réquisitoire contre la ‘bien-pensance’ de la société française. Le réalisateur y dénonçait les contradictions éthiques du droit à une époque où la peine de mort existait encore, et l’hypocrisie morale de ses concitoyens. A travers les trajectoires des différents personnages, dont les sept jurés du procès, il en éclairait toute la complexité humaine et abordait la question sous tous ses aspects : médical, moral, religieux, juridique, … Et à propos de la culpabilité de l’accusée, le médecin de la victime appelé comme témoin à la barre, déclarait avec une certaine ironie : « Dieu merci, ce n’est pas à moi de trancher ! ».
Les temps ont changé. Et chaque loi votée en France depuis, s’est accompagnée de nombreux films au succès critique et commercial variés, mais qui chacun ont démontré l’importance du cinéma comme révélateur des préoccupations des hommes.
Ainsi, quatre films viennent de sortir en moins de quatre mois sur les écrans français, avec le thème de la fin de vie au cœur de leur scénario : La Chambre d’à côté de Pedro Almodovar (8 janvier) : 600 000 spectateurs ; Le Dernier Souffle de Costa-Gavras (12 février) : 115 000 spectateurs ; On Ira d’Enya Barroux (12 mars) ; et le plus récent, Aimons-nous vivants, de Jean-Pierre Améris(16 avril) (auxquels on peut rajouter un autre film thaïlandais tendre sur un petit fils qui découvre l’importance et la valeur de la vie de son aïeule : Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère))
Pourquoi cette concomitance sur les écrans français ? Est-ce l’imminence d’une nouvelle loi ? Le cycle de fabrication d’un film étant de plusieurs années – entre l’idée initiale, l’écriture, la recherche de financement, le tournage puis la sortie en salles –, on peut raisonnablement penser à un hasard de calendrier de distributeurs. D’autres films sont d’ailleurs régulièrement sortis sur le sujet ces dernières années (De son vivant, d’Emmanuelle Bercot – 2021 ; Tout s’est bien passé, de François Ozon – 2021 ; Être vivant et le savoir, d’Alain Cavalier – 2019 ; …)
Mais cette profusion récente peut aussi être vue comme le signe d’une préoccupation devenue majeure pour nos contemporains, voire d’un changement plus profond des mentalités. D’autant que deux d’entre eux sont des comédies. Une première au cinéma pour un thème qui a priori ne prête pas particulièrement à rire…
Alors que nous disent-ils de nouveau sur le sujet ? Pour tous, la question centrale ne semble plus la mort assistée en elle-même, pourtant au point de départ de leur scénario. L’acte n’est filmé dans aucun des quatre films, contrairement à d’autres plus anciens comme Amour de Michael Haneke, Quelques Heures de printemps de Stéphane Brizé ou Les Invasions barbares de Denys Arcand.
Doit-on s’en réjouir ou n’est-ce pas un évitement, une démission, ou même la preuve que cette option est devenue envisageable pour tous ? On peut y voir aussi un déplacement pour aborder un autre aspect, celui de la préparation à la mort. Quand les films de ces dernières années cherchaient à lier l’idée du ‘bien mourir’ (dans la dignité ?) à la liberté du mourant de choisir l’instant de sa mort, tous mettent plutôt l’accent aujourd’hui sur l’entourage, médical, familial ou amical, et sur l’importance des relations affectives.
Cette question est au cœur du film de Costa-Gavras, Le Dernier Souffle. Adapté d’un livre d’entretien entre le médecin de soins palliatifs Claude Grangé et le philosophe Régis Debray, les situations décrites sont toutes réelles et vécues. A l’écran, le docteur Augustin Masset (Kad Merad) et l’écrivain Fabrice Toussaint (Denis Podalydès) dialoguent à propos des différents patients. Les questions posées y sont très justes, proches des nôtres et certaines, bouleversantes. Jusqu’où leur dire la vérité ? Que faire face à la souffrance ou au déni des proches ? Peut-on « apprendre à mourir » ?
Mais Costa-Gavras échoue malheureusement à en faire une fiction convaincante. La succession de scènes, trop souvent didactiques et parfois même artificielles, empêche l’émotion de poindre et limite la portée du propos. Le cinéaste le confesse lui-même dans le dossier de presse : il a réalisé ce film pour « se débarrasser de [ses] fantasmes et de [ses] terreurs ». On peut regretter aussi que ne soit pas abordé des aspects plus spirituels ou transcendantaux. Il dit ne voir dans les religions qu’« un formidable refuge, digne de respect », un contournement face au refus de la mort.
Dans On ira, premier long métrage de Enya Barroux, là encore, rien n’est montré de la mort de Marie (Hélène Vincent). Octogénaire en phase terminale d’un cancer, elle a signé pour un suicide assisté en Suisse et n’ose pas l’annoncer à son fils, divorcé et immature, et à sa petite[1]fille de 15 ans. Inventant un improbable héritage et grâce à un aide de vie mis dans la confidence, ils embarquent ensemble dans un vieux camping-car. Le voyage est l’occasion de resserrer des liens familiaux dont tous ont besoin, et de communiquer enfin. Alors que le fils et la petite-fille sont dévastés par sa décision, leur halte dans une communauté de gens du voyage leur permet de voir une autre façon d’accepter la mort.
Ces scènes « relèvent du hasard », dixit la réalisatrice. Elle a découvert leurs rites et leur foi par une amie gitane, juste après le décès de sa grand-mère qui venait de mourir seule à l’hôpital. N’ayant pu l’accompagner dans ses derniers jours, elle a écrit pour elle ce scénario de road-movie drôle et idéalisé.
Autre comédie, celle de Jean-Pierre Améris, avec Valérie Lemercier et Gérard Darmon, Aimons-nous vivants. Un vieux crooner dépressif part en Suisse (encore !) pour une mort programmée et rencontre en route une de ses fans délurée et enthousiaste, dont on se doute rapidement qu’elle va le faire changer d’avis. Un scénario poussif et sans aucune profondeur, ni dans les personnages ni dans les situations. Même les acteurs semblent y croire à moitié ! D’autant plus décevant que Jean-Pierre Améris fut l’un des premiers à signer un film sur les soins palliatifs. C’était le très beau C’est la vie en 2001, la rencontre entre une infirmière, jouée par Sandrine Bonnaire, et un patient en fin de vie (Jacques Dutronc). Entre eux deux naissait un amour qui allait, comme l’a écrit si magnifiquement Anne-Dauphine Julliand depuis, « rajouter de la vie aux jours quand on ne peut pas rajouter de jours à la vie ».
Quant à La Chambre d’à côté de Pedro Almodovar, il a déjà fait ici l’objet d’une analyse. Je n’y reviendrai donc pas en détails. Rappelons juste que lui aussi se concentre sur l’amitié qui se renoue entre les deux femmes et qu’il s’agit d’un suicide où la seule assistance réclamée est celle d’une présence dans « la chambre d’à côté ».
En conclusion, le cinéma comme les arts en général contribuent à leur manière à la représentation que l’on se fait de la mort. Et si nul ne sait comment il réagira face à cette grande inconnue, il est intéressant de voir comment, dans nos sociétés largement sécularisées et déchristianisées, le 7e art peut aider à l’envisager. Il fait écho ainsi à la longue et très ancienne tradition des « arts chrétiens du bien-mourir ». Les soins palliatifs actuels s’en inspirent. Dans le film De son vivant, le Dr Sara (qui joue son propre rôle) donne à Benjamin (Benoit Magimel) les cinq mots à dire à ceux qu’on aime avant de mourir : Pardonne-moi, je te pardonne, je t’aime, merci, au revoir. Ce qui n’est pas sans se rapprocher des notions chrétiennes de grâce, de repentance, de miséricorde ou d’amour. Et quant à la mort de Jésus sur la Croix qui fut loin d’être « un long fleuve tranquille », c’est Pier Paolo Pasolini, un réalisateur athée mais profondément mystique qui s’est approché au plus près du sacré dans son Evangile selon Saint Mathieu.
Valérie de Marnhac, Signis