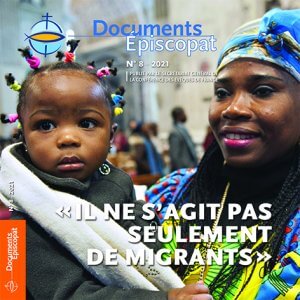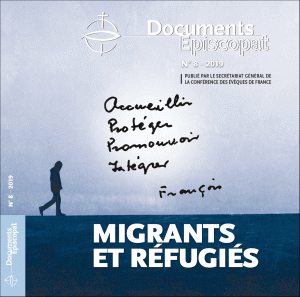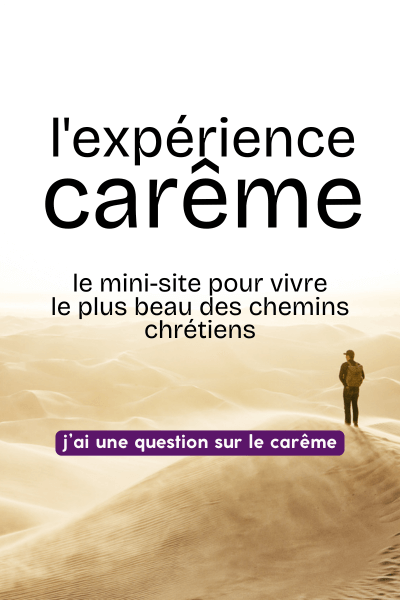Les orientations pastorales sur les déplacés climatiques
Le Saint-Siège via le Dicastère pour le service du développement humain intégral a publié le 30 mars 2021 les Orientations pastorales sur les déplacés climatiques de la Section Migrants et Réfugiés, et encourager les catholiques à s’engager dans la prise en compte des migrants obligés de fuir pour des raisons climatiques.
PRÉFACE

La brochure Orientations pastorales sur les déplacés climatiques est pleine de faits pertinents, d’interprétations, de stratégies et de propositions … Mais, d’emblée, je suggère que nous adaptions la célèbre phrase de Hamlet « être ou ne pas être » et affirmions : « Voir ou ne pas voir : telle est la question ! » C’est avec la vision de chacun, oui, la mienne et la vôtre, que tout commence.
Nous sommes submergés de nouvelles et d’images de peuples entiers déracinés par les changements cataclysmiques de notre climat et contraints d’émigrer. Pourtant, l’effet que ces histoires ont sur nous et la façon dont nous réagissons – qu’elles provoquent des réactions fugaces ou déclenchent quelque chose de plus profond en nous ; qu’elles semblent lointaines ou si nous les sentons proches de chez nous – dépend de notre capacité à prendre la peine de voir la souffrance que chaque histoire entraîne afin de « prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter » (Laudato si’ 19).
Quand des personnes sont expulsées parce que leur environnement local est devenu inhabitable, cela peut sembler un processus naturel, fait inévitable. Pourtant, la détérioration du climat est très souvent la conséquence de mauvais choix et d’activités destructrices, d’égoïsme et de négligence, qui mettent l’humanité en déséquilibre avec la création, notre maison commune.
À la différence de la pandémie, qui s’est abattue sur nous soudainement, sans prévenir, presque partout, et qui a touché tout le monde en même temps, la crise climatique se déroule depuis la révolution industrielle. Elle s’est longtemps développée si lentement qu’elle est restée imperceptible, sauf pour un petit nombre de gens clairvoyants. Aujourd’hui encore, son impact est inégal : le changement climatique se produit partout, mais la plus grande douleur est ressentie par ceux qui y ont le moins contribué.
Pourtant, comme la crise COVID-19, le nombre immense et croissant des déplacés climatiques devient rapidement une grande urgence de notre époque, visible presque chaque soir sur nos écrans, et exige des réponses mondiales.
J’imagine ici Dieu disant, par la bouche du prophète Isaïe, ces quelques paroles actualisées : Venez, discutons de tout cela. Si vous êtes prêts à écouter, nous pouvons encore avoir un grand avenir. Mais si vous refusez d’écouter et d’agir, vous serez dévorés par la chaleur et la pollution, d’un côté par la sécheresse, de l’autre par la montée des eaux (cf. Isaïe 1,18-20).
Lorsque nous regardons, que voyons-nous ? Beaucoup sont dévorés dans des conditions qui rendent leur survie impossible. Forcés d’abandonner champs et rivages, maisons et villages, les gens s’enfuient en hâte, emportant tout juste quelques souvenirs et trésors, des morceaux de leur culture et de leur patrimoine. Ils partent avec espoir, c’est-à-dire pour recommencer leur vie dans un lieu sûr. Pourtant, la plupart d’entre eux finissent dans des bidonvilles dangereusement surpeuplés ou des installations de fortune, dans l’attente de leur sort.
Ceux que la crise climatique chasse de chez eux doivent être accueillis, protégés, promus et intégrés. Ils veulent recommencer. Pour créer un nouvel avenir pour leurs enfants, il faut leur permettre de le faire et les aider. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer sont autant de verbes d’action utile. Enlevons, un par un, ces rochers qui bloquent le chemin des déplacés, ce qui les réprime et les met à l’écart, ce qui les empêche de travailler et d’aller à l’école, ce qui les rend invisibles et nie leur dignité.
Les Orientations pastorales sur les déplacés climatiques nous invitent à élargir notre regard sur ce drame de notre temps. Elles nous appellent à voir la tragédie du déracinement prolongé qui pousse nos frères et sœurs à se lamenter, année après année : « Nous ne pouvons pas revenir en arrière, et nous ne pouvons pas recommencer ». Elles nous invitent à prendre conscience de l’indifférence des sociétés et des gouvernements quant à cette tragédie. Elles nous demandent de voir et de nous inquiéter. Elles invitent l’Église et les autres à agir ensemble, et elles nous expliquent comment nous pouvons le faire.
C’est le travail que le Seigneur nous demande maintenant, et il s’y trouve une grande joie. Nous ne sortirons pas des crises comme celle du climat ou de COVID-19 en nous terrant dans l’individualisme, mais seulement en « étant beaucoup ensemble », par la rencontre, le dialogue et la coopération. C’est pourquoi je suis si heureux que ces Orientations pastorales sur les déplacés climatiques aient été produites, au sein du Dicastère pour le service du développement humain intégral, conjointement avec la Section Migrants et Réfugiés et le Secteur de l’écologie intégrale. Ce rapprochement est en soi un signe de la voie à suivre.
Voir ou ne pas voir – telle est la question qui nous conduit à la réponse dans l’action commune. Ces pages nous montrent ce qui est nécessaire et, avec l’aide de Dieu, ce qu’il faut faire.
Franciscus
GLOSSAIRE
Église catholique désigne et inclut, dans le présent document, le leadership officiel de l’Église, les évêques et les conférences épiscopales, les prêtres, les religieux et religieuses, les responsables et les chefs du personnel des organisations humanitaires d’inspiration catholique et des organisations caritatives axées sur les migrations, ainsi que chaque membre de l’Église catholique.
Crise climatique est un terme de plus en plus utilisé pour exprimer un sentiment d’urgence accru vis-à-vis de la phase actuelle du changement climatique causé par les activités humaines et l’urgence d’y répondre afin d’éviter des conséquences désastreuses.
Déplacés climatiques (DC) sont des individus ou des groupes de personnes qui sont forcés de quitter leur lieu de résidence habituel en raison d’une crise climatique aiguë. Les déplacements peuvent être dus soit à des déclencheurs à démarrage rapide – principalement des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les tempêtes, les sécheresses et les incendies de forêt; soit à des processus lents tels que la désertification, l’épuisement des ressources naturelles, la pénurie d’eau, la hausse des températures et l’élévation du niveau de la mer. Dans le cas de risques naturels comme les phénomènes météorologiques extrêmes, les victimes déplacées pourraient peut-être revenir. Le déplacement sera, au contraire, permanent pour la plupart des personnes dans le cas de catastrophes naturelles graves et face à des processus de longue durée comme l’élévation du niveau de la mer. Le déplacement peut se faire soit à l’intérieur du pays, soit en traversant une frontière internationale.
Résilience climatique est la capacité à se préparer, à s’adapter et à réagir aux phénomènes et tendances liés au climat. Le renforcement de la résilience climatique implique de comprendre comment la crise climatique produira de nouveaux risques et d’adopter des mesures pour mieux faire face à ces risques.
Déplacement désigne la situation dans laquelle les personnes sont contraintes de quitter l’endroit où elles vivent normalement et partir vers un autre endroit, soit à l’intérieur des frontières nationales, soit à l’étranger.
INTRODUCTION
Ces dernières années, la communauté internationale a reconnu l’ampleur de la crise climatique et a fait des efforts considérables, par le biais de divers accords, pour en atténuer les effets. L’Église catholique reconnaît et apprécie ces efforts pour mettre en place des cadres juridiques, collecter des données et mener des analyses rigoureuses sur les conséquences de la crise climatique, ainsi que l’engagement de nombreux acteurs de la société civile – en particulier des jeunes – à relever ce défi.
La crise climatique a un « visage humain ». Elle est déjà une réalité pour une multitude de personnes dans le monde, en particulier pour les plus vulnérables. L’Église catholique a une sollicitude maternelle pour tous ceux qui ont été déplacés par ses effets. Cette situation particulière de vulnérabilité est la raison d’être du présent document.
Le magistère de l’Église catholique s’est déjà penché sur la détresse des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, ainsi que sur celui d’autres catégories de migrants, et a présenté des réflexions et des instructions relatives à leur prise en charge pastorale, reflétées notamment dans la Lettre encyclique Laudato si’. Les Orientations pastorales sur les déplacés climatiques (OPDC) se concentrent exclusivement sur les déplacées climatiques (DC), mettant en lumière les nouveaux défis posés par le scénario mondial actuel et suggérant des réponses pastorales adéquates. L’objectif principal de ces orientations est de fournir une série de considérations essentielles qui peuvent être utiles aux Conférences épiscopales, aux églises locales, aux Congrégations religieuses, aux organisations catholiques, aux agents pastoraux catholiques et à tous les fidèles catholiques dans la planification pastorale et l’élaboration de programmes pour assister efficacement les DC.
Les OPDC sont profondément ancrées dans la réflexion et la doctrine de l’Église ainsi que dans l’expérience pratique qu’elle a acquise en répondant aux besoins des DC, qu’ils soient déplacés à l’intérieur des frontières de leur pays d’origine ou à l’extérieur. Les DC sont des migrants, et le présent document s’inspire de ces documents magistériels, qui traitent en particulier des migrants et peuvent également s’appliquer aux DC. Les OPDC s’appuient également sur la longue expérience pratique de nombreuses organisations catholiques qui travaillent sur le terrain et sur les observations des représentants des Conférences épiscopales. Bien qu’approuvées par le Saint-Père, les OPDC ne prétendent pas épuiser l’enseignement de l’Église sur la crise climatique et le déplacement.
Les OPDC mettent en lumière dix défis qui sont liés au changement climatique et concernent ses victimes. Ces défis, ainsi que les réponses suggérées par l’Église catholique, constituent les jalons d’une feuille de route en vue de la planification pastorale pour les DC, et, avec ce document, ils étendent la préoccupation pastorale du Pape aux DC. Ce document contient aussi une section qui traite de la coopération et du travail d’équipe, qui sont à la base de la réussite des projets et essentiels pour rendre des services efficaces et adéquats aux DC.
1. Reconnaître le lien entre la crise climatique et les déplacements
[Les matelots] ont lancé la sonde et trouvé vingt brasses ; un peu plus loin, ils l’ont lancée de nouveau et trouvé quinze brasses. Craignant que nous n’allions échouer sur des rochers, ils ont jeté quatre ancres à l’arrière, et ils appelaient de leurs vœux la venue du jour. […] Les indigènes nous ont traités avec une humanité peu ordinaire. Ils avaient allumé un grand feu, et ils nous ont tous pris avec eux, car la pluie s’était mise à tomber et il faisait froid (Ac 27,27-29; 28,1-2).
 Des tempêtes virulentes, de violents ouragans et des cyclones désastreux continuent de se déchaîner. En fait, ils sont devenus plus fréquents et plus intenses à mesure que la crise climatique s’aggrave. Nous voyons un nombre croissant de personnes déplacées en raison des effets dévastateurs de la crise climatique et d’autres manifestations de la crise écologique. Les vies et les foyers de tant de nos frères et sœurs dans le monde entier ont vraiment fait naufrage. Beaucoup d’entre eux sont contraints de fuir leur pays d’origine pour trouver abri et sécurité.
Des tempêtes virulentes, de violents ouragans et des cyclones désastreux continuent de se déchaîner. En fait, ils sont devenus plus fréquents et plus intenses à mesure que la crise climatique s’aggrave. Nous voyons un nombre croissant de personnes déplacées en raison des effets dévastateurs de la crise climatique et d’autres manifestations de la crise écologique. Les vies et les foyers de tant de nos frères et sœurs dans le monde entier ont vraiment fait naufrage. Beaucoup d’entre eux sont contraints de fuir leur pays d’origine pour trouver abri et sécurité.
En tant que chrétiens, nous croyons que l’amour et l’attention peuvent éclairer les nuits les plus obscures. Les Maltais ont offert un accueil exceptionnellement aimable à saint Paul et à ses compagnons naufragés. Les sans-abri ont trouvé un foyer, car ils ont été accueillis à bras ouverts, nourris et logés. Un feu a été allumé – un « foyer » –, créant une atmosphère familiale de chaleur contre le froid de l’indifférence.
La crise climatique
L’un des facteurs qui font de la planète Terre un foyer unique pour la vie est son système climatique particulier. Cependant, après plus de 10000 ans de stabilité relative – soit toute l’étendue de la civilisation humaine –, le climat de notre planète est en train de changer rapidement en raison des activités humaines.
La température moyenne de la Terre a augmenté d’environ 1,1 degré Celsius depuis l’époque préindustrielle, entraînant « de profondes modifications des systèmes humains et naturels, notamment une augmentation des sécheresses, des inondations et de certains autres types de conditions météorologiques extrêmes, une élévation du niveau de la mer et une perte de la biodiversité[1] ». Le rythme actuel de réchauffement est plus rapide qu’à tout autre moment des 65 derniers millions d’années.
Nous sommes déjà dans une crise climatique, qui s’accélère rapidement. En novembre 2019, 11000 scientifiques se sont réunis pour déclarer « une urgence climatique[2] », une préoccupation reprise par le Pape François dans son Message pour la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, le 1er septembre 2020, lorsqu’il a déclaré que « nous nous trouvons en situation d’urgence » climatique et que « nous sommes à court de temps[3] ».
La face « humaine » de la crise
 La crise climatique n’est pas une abstraite menace future. L’augmentation de la température d’un peu plus de 1 °C par rapport à l’ère industrielle cause déjà d’immenses souffrances à des millions de nos frères et sœurs dans le monde, sans parler des dommages causés aux écosystèmes et au reste du biome.
La crise climatique n’est pas une abstraite menace future. L’augmentation de la température d’un peu plus de 1 °C par rapport à l’ère industrielle cause déjà d’immenses souffrances à des millions de nos frères et sœurs dans le monde, sans parler des dommages causés aux écosystèmes et au reste du biome.
Comme le pape François l’a à juste titre reconnu, « le lien entre la fragilité environnementale, l’insécurité alimentaire et les mouvements migratoires est évident[4] ». La crise climatique menace aussi les droits humains fondamentaux comme le droit à la vie, à une alimentation et à un approvisionnement en eau adéquats, à un logement (ou un abri) adéquat et à la santé.
Ce sont les communautés pauvres et vulnérables du monde entier qui sont touchées de manière disproportionnée par les crises écologiques et climatiques. Ce sont les innocents, qui ont le moins contribué à l’origine du problème. Il s’agit d’une question profondément morale, qui fait appel à l’éco-justice. En effet, la Terre a été destinée à être une maison commune où chacun a le droit de vivre et de s’épanouir. À cet égard, les paroles prophétiques de saint Jean-Paul II, reprises par le pape François dans Fratelli tutti, sont très pertinentes : « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne[5] ».
L’épuisement des ressources naturelles de base que la terre fournit, et l’eau en particulier, peut provoquer le déplacement temporaire ou permanent de familles et de communautés. « L’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu’il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour l’exercice des autres droits humains[6] ». La pénurie d’eau est un problème dans de nombreuses régions du monde, mais « spécialement en Afrique, où de grands secteurs de la population n’ont pas accès à une eau potable sûre, ou bien souffrent de sécheresses qui rendent difficile la production d’aliments. Dans certains pays, il y a des régions qui disposent de l’eau en abondance et en même temps d’autres qui souffrent de grave pénurie[7] ».
La crise a un impact disproportionné sur les groupes vulnérables, comme les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les peuples indigènes et les personnes vivant dans des zones rurales. Certains des « points chauds » géographiques qui seront les plus touchés par la crise climatique sont des régions deltaïques densément peuplées comme le Gange (le Bangladesh, en particulier), le Mékong et le Nil, les pays de la région du Sahel en Afrique du Nord, les petits États insulaires, les pays d’Amérique centrale particulièrement vulnérables aux ouragans, et les régions côtières et de faible altitude du monde entier.
La crise climatique conduit au déplacement
 La crise climatique peut provoquer des déplacements de population quand les maisons deviennent inhabitables ou les moyens de subsistance sont perdus. Les déplacements peuvent être dus soit à des déclencheurs à démarrage rapides, principalement des phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les tempêtes, les sécheresses et les feux de forêt, soit à des processus à développement lent, comme la désertification, l’épuisement des ressources naturelles, la pénurie d’eau, l’augmentation des températures et l’élévation du niveau de la mer. Nous devons également garder à l’esprit que des déplacements peuvent avoir de multiples causes.
La crise climatique peut provoquer des déplacements de population quand les maisons deviennent inhabitables ou les moyens de subsistance sont perdus. Les déplacements peuvent être dus soit à des déclencheurs à démarrage rapides, principalement des phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les tempêtes, les sécheresses et les feux de forêt, soit à des processus à développement lent, comme la désertification, l’épuisement des ressources naturelles, la pénurie d’eau, l’augmentation des températures et l’élévation du niveau de la mer. Nous devons également garder à l’esprit que des déplacements peuvent avoir de multiples causes.
La crise climatique entraîne et exacerbe déjà les mouvements de population dus aux catastrophes naturelles de courte et de longue durée. Au cours de la seule année 2019, il y eut plus de 33 millions de personnes nouvellement déplacées, portant le nombre total à près de 51 millions, le nombre le plus élevé jamais enregistré; et parmi celles-ci figurent 8,5 millions qui ont fui des conflits et des violences et 24,9 millions partis à cause de catastrophes naturelles[8]. Au cours du premier semestre 2020, 14,6 millions de nouveaux déplacés ont été enregistrés, dont 9,8 millions à la suite de catastrophes et 4,8 millions en raison de conflits et de violences[9]. On estime que plus de 253,7 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes naturelles entre 2008 et 2018[10], des catastrophes qui, selon la région concernée, ont déplacé trois à dix fois plus de personnes que les conflits armés dans le monde.
La crise climatique est également une cause de conflit dans le monde entier, ce qui peut être un autre facteur de déplacement. Le lien est réel, même s’il n’est pas toujours direct. Dans certaines situations, la crise climatique entraîne l’épuisement des ressources naturelles qui, à son tour, peut déclencher des conflits entre communautés et nations pour la possession de ressources rares. Le changement climatique peut être considéré comme un multiplicateur de menaces, intensifiant les conflits existants là où les ressources sont rares. Comme l’avertit le pape François dans Laudato si’, « il est prévisible que, face à l’épuisement de certaines ressources, se crée progressivement un scénario favorable à de nouvelles guerres, déguisées en revendications nobles[11] ».
Malheureusement, des formes de développement déséquilibrées peuvent aussi contribuer à l’augmentation de la pauvreté et des déplacements. Comme saint Paul VI en a averti il y a près d’un demi-siècle, « brusquement l’homme en prend conscience : par une exploitation inconsidérée de la nature il risque de la détruire et d’ire à son tour la victime de cette dégradation[12] ». Nos modèles économiques faussés y contribuent eux aussi. « Il existe des règles économiques qui se sont révélées efficaces pour la croissance, mais pas pour le développement humain intégral[13] ». La richesse a augmenté, mais en même temps que l’inégalité, avec pour résultat l’apparition de « nouvelles pauvretés[14] ».
Dans le cas des catastrophes naturelles comme des événements climatiques extrêmes, les victimes déplacées pourront peut-être revenir. Au contraire, le déplacement sera permanent pour la plupart des personnes dans le cas de catastrophes naturelles graves et face à des processus de longue durée comme l’élévation du niveau de la mer.
Le niveau de la mer continuera d’augmenter à mesure que notre climat se réchauffera, menaçant les villes ainsi que les terres agricoles et les pâturages dans le monde entier. À l’échelle mondiale, environ 145 millions de personnes vivent à moins d’un mètre au-dessus du niveau actuel de la mer, et près des deux tiers des villes de plus de cinq millions d’habitants sont situées dans des zones menacées par l’élévation du niveau de la mer. Près de 40 % de la population mondiale vit à moins de 100 km d’une côte[15].
Au milieu de ces réalités complexes, les plus vulnérables pourraient même ne pas être en mesure de se déplacer, quelles que soient les circonstances, en raison de la pauvreté ou pour d’autres raisons. Il est crucial de répondre aux besoins des populations immobiles ou incapables de se déplacer sur de longues distances.
Déplacements dus à la crise climatique
 Le réchauffement non maîtrisé fait planer le spectre d’un déplacement massif des populations. Avec un réchauffement de 1,5 °C, le niveau de la mer augmentera de 0,77 mètre d’ici à 2100[16]. L’augmentation serait bien plus importante dans le cadre de scénarios de réchauffement plus importants. Avec la trajectoire actuelle de réchauffement de 3 à 4°C d’ici 2100, il est de plus en plus probable que de grandes parties des calottes glaciaires de l’Antarctique et du Groenland s’effondreront, entraînant une hausse rapide du niveau de la mer[17].
Le réchauffement non maîtrisé fait planer le spectre d’un déplacement massif des populations. Avec un réchauffement de 1,5 °C, le niveau de la mer augmentera de 0,77 mètre d’ici à 2100[16]. L’augmentation serait bien plus importante dans le cadre de scénarios de réchauffement plus importants. Avec la trajectoire actuelle de réchauffement de 3 à 4°C d’ici 2100, il est de plus en plus probable que de grandes parties des calottes glaciaires de l’Antarctique et du Groenland s’effondreront, entraînant une hausse rapide du niveau de la mer[17].
Il est à craindre que cette élévation prévue du niveau de la mer ne provoque des déplacements et des migrations sans précédent à l’échelle mondiale. Certaines régions, comme les îles et les atolls de faible altitude, seront rendues totalement inhabitables. « Même selon les scénarios les plus optimistes, on estime que d’ici 2060, quelque 316 à 411 millions de personnes dans le monde seront vulnérables aux ondes de tempête et aux inondations côtières[18] ».
Il est difficile de prévoir le nombre de personnes qui pourraient être déplacées à l’avenir, étant donné les multiples facteurs de migration et la difficulté de démêler les motifs qui sous-tendent les mouvements humains. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2018[19] portant sur l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Amérique latine, en raison de la crise climatique, de 31 millions jusqu’à 143 millions de personnes (environ 2,8 % de la population mondiale) auront peut-être besoin de migrer dans leur propre pays d’ici 2050. Selon le même rapport, 50 % de la population d’Asie du Sud résidera dans des régions qui selon les projections deviendront d’ici 2050 des points chauds modérés à sévères pour les catastrophes liées au climat.
Réagir aux déplacements dus au climat
Le déplacement d’un nombre important de personnes entraîne une myriade de problèmes sociaux, politiques et humanitaires, en particulier quand les destinations d’accueil n’ont pas les ressources et les capacités nécessaires pour gérer des déplacements à grande échelle[20].
La protection internationale contre les déplacements dus au climat est limitée, fragmentaire et pas toujours juridiquement contraignante. En particulier, les DC ne sont pas toujours définis comme une catégorie ayant besoin de protection et ne sont pas explicitement reconnus par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Par conséquent, il existe souvent un vide en matière de protection pour les personnes déplacées à l’intérieur des frontières nationales et au-delà des frontières internationales. Toutefois, quel que soit leur statut juridique, tous les États sont tenus de protéger leurs droits fondamentaux. En outre, tous les DC ont droit à des soins et une assistance appropriés, en accord avec le droit international et les normes humanitaires en vigueur.
L’Église catholique aide déjà les personnes touchées et continuera à le faire à l’avenir. L’important Rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de 2018 a averti que le monde doit s’efforcer de réaliser des transitions « rapides et profondes » vers une économie faible en carbone dans les domaines de la terre, de l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, des transports et des villes, afin de maintenir le réchauffement climatique dans les limites du seuil crucial de 1,5°C. Nous devons intensifier nos efforts collectifs pour promouvoir les énergies renouvelables, l’énergie verte, le reboisement, l’agriculture durable et une économie circulaire, tout en freinant la déforestation et à la dégradation des écosystèmes, et en mettant l’accent sur des solutions basées sur la nature. Dans les pays en développement, nous avons besoin de projets inspirés par la protection de l’environnement ; nous avons besoin d’alternatives pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’Église catholique est préoccupée par ces défis et par l’impact de la crise climatique sur la dignité des êtres humains. Avec les gouvernements, les autres confessions chrétiennes, les autres traditions religieuses et les personnes de bonne volonté, l’Église vise à répondre à ces défis. Comme l’a demandé le pape Benoît XVI en 2010 : « Comment négliger le phénomène grandissant de ce qu’on appelle les “réfugiés de l’environnement” : ces personnes qui, à cause de la dégradation de l’environnement où elles vivent, doivent l’abandonner – souvent en même temps que leurs biens – pour affronter les dangers et les inconnues d’un déplacement forcé ?[21] »
Relever le défi de la CCD est aujourd’hui au cœur de la nécessité d’être une Église crédible qui témoigne, une communauté ecclésiale bienveillante et inclusive.
2. Promouvoir la sensibilisation et la diffusion d’information
Il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois (Jean 9,25).
La sensibilisation ouvrira les yeux des gens pour qu’ils voient les réalités de l’impact de la crise climatique sur l’existence humaine. La cécité à l’égard de ces questions est très répandue et ses causes sont principalement : a) l’ignorance pure et simple ; b) l’indifférence et l’égoïsme vis-à-vis des phénomènes qui mettent en danger le bien commun ; c) le déni délibéré de la réalité pour protéger des intérêts particuliers ; d) l’incompréhension.
Dieu donne les facultés pour voir, mais les êtres humains doivent être prêts à passer de la cécité à la conscience.
Défi
De nombreuses attitudes dominantes empêchent de relever efficacement les défis de la CCD : on note le déni, l’indifférence générale, la résignation nonchalante ainsi qu’une confiance excessive et mal placée dans les solutions techniques. Nous devons continuer à éviter la fausse polarisation entre, d’une part, le souci de la création et, d’autre part, le développement et l’économie.
Dans cette perspective, je désire rappeler mon « invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. […] Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent, [pour différents motifs qui] vont de la négation du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques » (LS 14)[22] .
Réponse
L’Église catholique est appelée à promouvoir une conversion écologique intégrale en relation avec la CCD, dans le respect total de l’environnement et du développement humain.
Avec raison, se fait sentir la nécessité d’une relation renouvelée et saine entre l’humanité et la création, la conviction que seule une vision de l’homme, authentique et intégrale, nous permettra de prendre mieux soin de notre planète au bénéfice de la génération présente et de celles à venir, car « il n’y a pas d’écologie sans anthropologie adéquate » (LS 118)[23].
Cela peut se faire par une planification stratégique à long terme, qui implique des actions telles que:
o Des campagnes d’information soulignant la gravité de la CCD, centrés sur le « visage humain » de la crise et la nécessité d’agir de toute urgence.
Il n’y aura pas d’écologie saine et durable, capable de transformer les choses, si les personnes ne changent pas, si on ne les encourage pas à choisir un autre style de vie, moins avide, plus serein, plus respectueux, moins anxieux, plus fraternel[24].
o Sensibiliser l’Église et la communauté à la façon dont notre mode de vie moderne de consommation ostentatoire contribue à la crise climatique, et encourager un sens des responsabilités conduisant à un changement ou à une adaptation du mode de vie.
La façon dont l’homme traite l’environnement influence les modalités avec lesquelles il se traite lui-même et réciproquement. C’est pourquoi la société actuelle doit réellement reconsidérer son style de vie qui, en de nombreuses régions du monde, est porté à l’hédonisme et au consumérisme, demeurant indifférente aux dommages qui en découlent. Un véritable changement de mentalité est nécessaire qui nous amène à adopter de nouveaux styles de vie[25].
o Élaborer des programmes d’éducation ciblant les paroisses et les écoles catholiques en particulier, visant à développer des attitudes responsables vis-à-vis du comportement personnel et du mode de vie.
La grande écologie inclut un aspect éducatif qui provoque le développement de nouvelles habitudes chez les personnes et les groupes humains[26].
o Améliorer la coordination entre les agences ecclésiastiques (tant au niveau local qu’international) et reconnaître le changement climatique comme une cause de migration.
o Diffuser les documents essentiels de l’Église, y compris les enseignements centraux de Laudato si’ : a) une économie durable, centrée sur la personne ; b) l’unité et la sainteté de toute la création ; c) l’obligation de l’humanité de gérer de manière responsable l’entretien de notre maison commune.
o Partager les meilleures pratiques de conversion écologique intégrale pour donner un témoignage concret de l’engagement de l’Église et accroître leur visibilité. Utiliser des études de cas du monde entier pour aider les gens à comprendre comment la lutte peut affecter les vies humaines et l’accès aux moyens de subsistance.
o Promouvoir des initiatives concrètes visant à éliminer les dysfonctionnements systémiques et institutionnels de l’économie mondiale qui ont un impact sur la CCD.
Une paix réelle et durable n’est possible qu’à partir d’une éthique globale de solidarité et de coopération au service d’un avenir façonné par l’interdépendance et la coresponsabilité au sein de toute la famille humaine[27].
o Promouvoir le dialogue et les réseaux œcuméniques et interreligieux pour coordonner ces efforts.
Une attitude de dialogue ouvert, reconnaissant aussi la multiplicité des interlocuteurs : les peuples autochtones, les riverains, les paysans et les afro-descendants, les autres Églises chrétiennes et dénominations religieuses, les organisations de la société civile, les mouvements sociaux populaires, l’État, enfin toutes les personnes de bonne volonté qui cherchent à défendre la vie, l’intégrité de la création, la paix et le bien commun[28].
o Établir une stratégie de communication plus étendue et cohérente qui utilise pleinement les médias sociaux et numériques.
Le nombre toujours croissant d’interconnexions et de communications qui enveloppent notre planète rend plus palpable la conscience de l’unité et du partage d’un destin commun entre les nations de la terre[29].
o Impliquer les jeunes comme protagonistes dans ces efforts et encourager des attitudes et un style de vie chrétiens qui mettent l’accent non seulement sur l’avenir, mais aussi sur l’éternel, c’est-à-dire le genre de conditions environnementales que les gens laisseront à leurs enfants et petits-enfants, ainsi que le fait de traiter la création comme un don de Dieu.
Nous ne devons pas imposer aux générations futures le fardeau d’assumer les problèmes causés par les problèmes précédents. Au lieu de cela, nous devrions leur donner l’occasion de se souvenir de notre génération comme de celle qui a renouvelé et mis en œuvre […] le besoin fondamental de collaborer afin de préserver et de cultiver notre foyer commun. Puissions-nous offrir à la prochaine génération des raisons concrètes d’espérer et de travailler pour un avenir bon et digne[30] !
o Puiser chez les populations locales, les communautés indigènes et d’autres ressources humaines, à la lumière de la Doctrine sociale de l’Église, pour la recherche de solutions ancrées dans une écologie intégrale.
Cela exige d’écouter, de reconnaître et de respecter les personnes et les populations locales comme des interlocuteurs valables. Elles maintiennent un lien direct avec la terre, elles connaissent ses temps ainsi que ses processus et connaissent, par conséquent, les effets catastrophiques qu’au nom du développement provoquent de nombreux projets[31].
3. Proposer des alternatives au déplacement
Il y aura une réserve de nourriture pour le pays en vue des sept années de famine qui suivront dans le pays d’Égypte, et la famine ne détruira pas le pays (Genèse 41,36).
Des alternatives viables au déplacement sont possibles lorsque les gouvernements, les dirigeants, les institutions et les organisations sont attentifs et prennent réellement en considération les intérêts primordiaux et les préoccupations de leur population, en particulier des plus vulnérables. Il peut toujours y avoir des « années de vaches maigres », mais Dieu peut nous éclairer avec la sagesse nécessaire pour trouver des moyens créatifs et durables de soulager la souffrance et des alternatives au traumatisme du déplacement.
Défi
La plupart du temps, le déplacement émerge de l’absence de moyens de subsistance alternatifs. Les gens se déplacent parfois parce qu’ils sont convaincus que la survie est – ou sera bientôt – impossible dans leur lieu d’origine, y compris pendant les crises climatiques.
Réponse
L’Église catholique est appelée à renforcer la résilience des personnes touchées par la crise climatique et à aider à trouver des alternatives au déplacement qui respectent le droit à la vie, ce qui inclut la possibilité de vivre une vie digne, dans la paix et en sécurité[32]. Personne ne devrait être forcé de fuir sa patrie.
Il n’y a pas pire aliénation que de faire l’expérience de ne pas avoir de racines, de n’appartenir à personne. Une terre sera féconde, un peuple portera des fruits et sera en mesure de générer l’avenir uniquement dans la mesure où il donne vie à des relations d’appartenance entre ses membres, dans la mesure où il crée des liens d’intégration entre les générations et les diverses communautés qui le composent[33].
Le développement de cette « résilience au climat » et de cette adaptation nécessite des approches à multiples facettes et l’engagement de toutes les parties concernées. L’Église catholique peut apporter son aide par des actions telles que :
o Diffuser des informations pertinentes, solides et fiables sur la crise climatique et les risques connexes concernant des territoires spécifiques et leurs habitants. Garantir l’utilisation des connaissances traditionnelles, autochtones et locales, en complément des connaissances scientifiques, dans l’évaluation des risques de catastrophes ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de plans adaptés à des secteurs, des localités et des contextes spécifiques, et adopter une approche intersectorielle.
En effet, il ne s’agit pas d’imposer d’en haut des programmes d’assistance, mais d’accomplir ensemble un chemin[34].
o Promouvoir l’adaptation in situ pour éviter les déplacements, en encourageant le maintien ou la reprise de modes traditionnels ou indigènes pertinents en rapport avec la terre, la nature et la vie durable sur terre.
Nous sommes attristés de voir les terres des peuples autochtones expropriées et leurs cultures piétinées par des schémas prédateurs et par de nouvelles formes de colonialisme, alimentées par la culture du gaspillage et du consumérisme[35].
o Promouvoir des programmes de développement créatifs et écologiques visant à soutenir les populations menacées de déplacement, protéger et renforcer les moyens de subsistance alternatifs tels que l’agro-écologie, la conservation communautaire, l’éducation, l’écotourisme et l’utilisation durable de la terre et de l’eau.
On peut trouver des alternatives d’élevage et d’agriculture durables, des énergies qui ne polluent pas, des sources de travail digne qui ne provoquent pas la destruction de l’environnement et des cultures[36].
o Promouvoir des investissements significatifs, éthiques et durables dans les infrastructures, les logements sûrs et la diversification des moyens de subsistance afin d’améliorer la résilience et la capacité d’adaptation des personnes menacées de déplacement.
Être unis pour défendre l’espérance signifie impulser et développer une écologie intégrale comme alternative à un modèle de développement déjà dépassé mais qui continue à engendrer de la dégradation humaine, sociale et environnementale[37].
o Établir des relations de solidarité et des filets de sécurité capables d’assurer la protection sociale des personnes menacées de déplacement.
o Développer l’autonomisation inclusive des personnes menacées de déplacement, en accordant une attention particulière aux jeunes et aux plus vulnérables.
Les pays traversés par les flux migratoires et ceux de la destination finale sont concernés, mais également les gouvernements et les Églises des États de provenance des migrants qui, avec le départ de tant de jeunes, voient leur avenir appauvri[38].
o Promouvoir et aider à coordonner les systèmes de migration planifiée et volontaire pour les populations à risque afin que la réinstallation puisse être gérée efficacement sur une période de temps.
o Œuvrer pour que, dans la mesure du possible, les personnes puissent continuer à rester chez elles et à mener une vie digne en atténuant les facteurs d’impulsion tels que les conflits et les dévastations naturelles provoqués par la crise climatique.
Certes, l’idéal serait d’éviter les migrations inutiles et pour y arriver, il faudrait créer dans les pays d’origine la possibilité effective de vivre et de grandir dans la dignité, de sorte que sur place les conditions pour le développement intégral de chacun puissent se réunir. Mais quand des progrès notables dans ce sens manquent, il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne[39].
4. Préparer les personnes au déplacement
Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à l’intérieur et à l’extérieur (Genèse 6,14).
Ceux pour qui le déplacement n’est pas une décision volontaire doivent affronter cette réalité avec courage et foi, en comptant sur l’accompagnement et le soutien de Dieu, sans tomber dans une acceptation fataliste du désespoir de ce voyage. Dieu, par la bienveillance de l’Église et de nombreuses personnes de bonne volonté, offre la possibilité de se préparer à faire face au défi du déplacement.
Défi
Quand le déplacement est incontestablement la seule option, les décisions sur le moment, le lieu et la manière de se déplacer sont souvent soit motivées par l’urgence, soit basées sur des informations douteuses ou des perceptions incorrectes. En outre, la plupart des personnes contraintes de se déplacer sont rarement préparées à faire face aux difficultés du déplacement, qu’il s’agisse de prendre la fuite, de trouver un abri et de s’adapter ensuite à leur nouvelle situation dans un lieu nouveau.
Réponse
Lorsque le déplacement climatique est une possibilité, l’Église catholique est appelée à s’engager de manière proactive dans la préparation des personnes au déplacement en fournissant des renseignements fiables et vérifiés. Cela peut aider leurs décisions relatives à la migration avant le départ et améliorer la préparation grâce à l’autonomisation personnelle et communautaire. Des actions telles que les suivantes, qui résultent de la coopération entre les organisations confessionnelles, les organisations de la société civile, les gouvernements et les agences internationales, seront importantes :
o Cartographier les territoires particulièrement touchés par la CCD et identifier les populations à risque, en tirant parti des outils disponibles tels que l’« Indice de risque d’information »[40].
o Cartographier la société et les ressources de la communauté d’accueil ainsi que de celle de la population déplacée.
o En vue du déplacement, aider à identifier et à préparer les sites d’installation ou de relocalisation appropriés pour des communautés particulières vulnérables aux catastrophes. Mettre en place des exercices de relocalisation planifiée et volontaire ainsi qu’une consultation et une participation accrues de toutes les catégories de personnes, afin de garantir que chacun – en particulier les personnes handicapées et les personnes âgées – soit inclus dans les décisions qui affectent leur vie.
o Recenser les organisations engagées dans la CCD et les services qu’elles offrent sur le plan de l’information et du renforcement des capacités en vue du déplacement.
o Plaider pour des processus de financement rationalisés pour le climat, afin de donner la priorité aux communautés les plus pauvres, et fournir aux communautés locales les moyens d’accéder au financement aussi rapidement que possible, avec des mesures appropriées de transparence et de responsabilité.
o Soutenir les autorités locales dans la diffusion effective d’informations pertinentes et fiables concernant les déplacements – y compris des programmes de sauvegarde – à toutes les populations à risque.
o Préconiser le développement de programmes qui favorisent les mécanismes d’adaptation et les compétences de survie des populations afin de les préparer au déplacement et à l’adaptation dans le nouveau lieu.
o Établir des réseaux de solidarité entre les communautés d’origine et les communautés d’accueil, promouvoir un lien de collaboration dans toutes les phases du déplacement et assurer un soutien pastoral suffisant à ces communautés à leur arrivée.
L’Église de provenance est donc exhortée à rester en contact avec ses membres qui, pour quelque motif que ce soit, s’installent ailleurs, tandis que l’Église d’arrivée doit assumer ses responsabilités envers ceux qui sont désormais devenus ses membres. Les deux Églises locales sont appelées à conserver leurs responsabilités pastorales spécifiques dans un esprit de communion actif et exprimé de façon pratique[41].
o Créer des programmes pour renforcer les capacités et la préparation des personnes à une intégration à long terme dans de nouvelles communautés quand le retour a peu de chances d’être une option viable.
5. Faciliter l’inclusion et l’intégration
De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l’arche un mâle et une femelle, pour qu’ils restent en vie avec toi (Genèse 6,19).
Un foyer commun qui accueille et soutient « tout être vivant » est le don unique de la création abondante de Dieu[42]. Travailler pour la création et pour un monde qui continue à embrasser la vie dans toutes ses belles expressions et formes, sans exclusion, c’est devenir co-créateur, poursuivre la mission du Dieu de la vie en abondance pour tous les êtres humains et tous les « êtres vivants ».
Défi
D’importants flux migratoires incontrôlés peuvent submerger les sociétés d’accueil, provoquant des tensions et des conflits. Souvent mal préparées et sans les compétences et ressources nécessaires, les sociétés locales ont besoin d’un soutien concret, mais aussi d’encouragement et de formation, si elles veulent relever les défis posés par la migration. De plus, si les diverses réactions au sein des communautés d’accueil – notamment l’indifférence, la peur, l’intolérance et la xénophobie – ne sont pas prises en compte, elles peuvent compromettre les efforts déployés pour accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les DC.
Réponse
L’Église catholique est appelée à engager la société ainsi qu’à préparer et encourager les personnes à être accueillantes, prêtes et désireuses d’étendre leur solidarité aux DC, en donnant à ces migrants un abri et des conditions de survie, en protégeant leurs droits et leur dignité, en favorisant leur développement humain intégral et en facilitant les processus d’intégration sociale, professionnelle et culturelle.
Cela peut se faire par des actions telles que :
o Mise en réseau avec les gouvernements pour la promotion et la réalisation de campagnes de sensibilisation, l’organisation de logements sûrs, l’accès aux soins sociaux, y compris les services médicaux, l’assistance juridique et les programmes de renforcement des capacités.
Il ne suffit pas … d’ouvrir ses portes … et de leur permettre d’entrer ; il faut aussi faciliter leur intégration dans la société qui les accueille. La solidarité doit devenir une expérience quotidienne d’assistance, de partage et de participation[43].
o Développer des campagnes de sensibilisation sur la CCD qui incluent et engagent la communauté d’accueil à tous les niveaux afin de créer un environnement favorable à l’accueil des DC, par exemple par la publication de livres pour enfants sur la CCD et l’utilisation des médias sociaux.
o Organiser des structures et des programmes d’hébergement sûrs pour les DC, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés et à l’inclusion des personnes vulnérables dans les communautés locales.
o Développer des programmes de mise à niveau des compétences et aider à trouver du travail, afin que les DC et d’autres personnes dans des situations vulnérables similaires soient mieux à même de s’intégrer dans les communautés locales.
o Investir dans des projets générateurs d’emplois, en accordant une attention particulière à l’agriculture (par exemple, l’agriculture à petite échelle et communautaire), et promouvoir l’entrepreneuriat innovant afin d’améliorer les possibilités d’emploi des DC.
Le primat du développement agricole […] signifie soutenir une véritable résilience en renforçant de façon spécifique la capacité des populations à faire face aux crises – naturelles ou provoquées par l’action de l’homme – et en prêtant attention aux différentes exigences[44].
o Habiliter les DC à maîtriser avec succès les fonctions sociales de base grâce à des programmes de renforcement des capacités comme le tutorat linguistique, l’éducation culturelle, les cours sur la citoyenneté active, et fournir des espaces d’écoute mutuelle et d’échange culturel, tout en engageant autant que possible les ressources disponibles localement (personnes/groupes) pour fournir ces programmes.
o Préparer les communautés d’accueil, grâce à des activités de renforcement des capacités qui sensibilisent et facilitent les processus d’intégration en douceur, à encourager l’inclusion des DC et à inclure les personnes vulnérables parmi la population locale.
J’insiste encore sur la nécessité de favoriser, dans tous les cas, la culture de la rencontre, en multipliant les opportunités d’échange interculturel, en documentant et en diffusant les « ‘bonnes pratiques’ » d’intégration et en développant des programmes visant à préparer les communautés locales aux processus d’intégration[45].
6. Exercer une influence positive sur l’élaboration des politiques
Mieux vaut la sagesse que la force. Et pourtant, la sagesse du pauvre est méprisée, sa parole n’est pas écoutée (Ecclésiaste 9,16).
La sagesse est avant tout un don de l’Esprit Saint, un don qui n’est pas seulement donné aux intelligents et aux savants, mais aussi aux marginaux et aux « rejetés ». L’accès au pouvoir, l’abondance des ressources, une grande énergie et même des compétences considérables pourraient devenir inutiles s’ils ne sont pas dirigés par la sagesse. Tout plan, politique ou stratégie qui ne reconnaît pas la sagesse qui vient des « pauvres » ignore la sagesse de l’Esprit présent en eux et échouera très probablement.
Défi
Les politiques et les programmes concernant la CCD sont souvent inadéquats, manquent de vision et influencés par des préoccupations économiques. Dans beaucoup de cas, l’intervention humaine peut nuire à l’environnement autant que la déréglementation fondée sur les principes du marché libre. Les personnes à risque, y compris les DC, sont rarement interrogées lors des consultations. Par conséquent, les intérêts de quelques-uns l’emportent généralement sur la sauvegarde du bien commun.
Beaucoup de ceux qui détiennent plus de ressources et de pouvoir économique ou politique semblent surtout s’évertuer à masquer les problèmes ou à occulter les symptômes, en essayant seulement de réduire certains impacts négatifs du changement climatique. Mais beaucoup de symptômes indiquent que ces effets ne cesseront pas d’empirer si nous maintenons les modèles actuels de production et de consommation[46].
Réponse
L’Église catholique est appelée à veiller à ce que les opinions des personnes vulnérables, comme les DC, soient entendues et prises en compte. Un dialogue fructueux avec les gouvernements et les décideurs est important pour inspirer de bons résultats politiques relatifs aux DC, et devrait se dérouler en accord avec les principes de la doctrine sociale catholique.
Voilà pourquoi il devient urgent et impérieux de développer des politiques pour que, les prochaines années, l’émission du dioxyde de carbone et d’autres gaz hautement polluants soit réduite de façon drastique, par exemple en remplaçant l’utilisation de combustibles fossiles et en accroissant des sources d’énergie renouvelable. Dans le monde, il y a un niveau d’accès réduit à des énergies propres et renouvelables. Il est encore nécessaire de développer des technologies adéquates d’accumulation[47].
Cela peut se faire par des actions de sensibilisation efficaces telles que :
o S’engager dans une véritable « conversion écologique », avec un grand dévouement et une action attentive à prendre soin de la maison commune et de ses membres les plus vulnérables, notamment en s’appuyant sur les aspects du Programme d’action d’Addis-Abeba, des Objectifs de développement durable et de l’Accord de Paris sur le climat, qui sont pertinents et en accord avec la doctrine sociale catholique.
Ils nous rappellent à l’urgence d’une conversion écologique, qui « doit être comprise de manière intégrale, comme une transformation des relations que nous entretenons avec nos sœurs et nos frères, avec les autres êtres vivants, avec la création dans sa très riche variété, avec le Créateur qui est l’origine de toute vie »[48].
o Veiller à ce que toutes les personnes, tant la population locale que les nouveaux arrivants comme les DC, aient un accès égal et permanent aux services publics de base[49] et reçoivent les documents appropriés. Ils doivent pouvoir participer à la formulation des politiques qui les concernent.
Il faut cesser de penser en termes d’ « interventions » sur l’environnement, pour élaborer des politiques conçues et discutées par toutes les parties intéressées. La participation requiert que tous soient convenablement informés sur les divers aspects ainsi que sur les différents risques et possibilités ; elle ne se limite pas à la décision initiale d’un projet, mais concerne aussi les actions de suivi et de surveillance constante[50].
o Alerter les gouvernements et les organisations humanitaires sur les soi-disant « populations invisibles » qui, ayant été confrontées à de multiples cas de dislocation dus à des circonstances indépendantes de leur volonté, sont particulièrement vulnérables.
Les gouvernants doivent faire tout le possible afin que tous puissent avoir les conditions matérielles et spirituelles minimum pour exercer leur dignité, comme pour fonder et entretenir une famille qui est la cellule de base de tout développement social. Ce minimum absolu a, sur le plan matériel, trois noms : toit, travail et terre ; et un nom sur le plan spirituel : la liberté de pensée, qui comprend la liberté religieuse, le droit à l’éducation et tous les autres droits civiques[51].
o Plaider pour la reconnaissance et la protection des personnes déplacées par les changements climatiques, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux et en leur apportant une aide humanitaire, conformément au droit international.
Un débat est en cours afin de déléguer certaines responsabilités à des agences qui s’occupent de politiques migratoires relatives aux migrations dues à des facteurs climatiques et à des migrations internes causées par des calamités naturelles. Ces personnes ont évidemment besoin de la protection de la communauté internationale[52].
o Partager des histoires humaines, des témoignages et des données concernant la réalité des changements climatiques et leur impact sur l’existence humaine et le monde naturel afin de sensibiliser les responsables politiques et de faciliter des mesures efficaces et de grande portée.
Cet accueil comporte une écoute attentive et un partage réciproque des histoires de la vie. Il requiert un cœur ouvert, la volonté de rendre sa propre vie visible à l’autre, un partage généreux de temps et de ressources[53].
o Exhorter les responsables politiques à adopter des outils existants destinés à renforcer la résilience des DC et des communautés qui les accueillent (par exemple, cela peut inclure certains principes du Cadre de Sendai sur la réduction des risques de catastrophe[54]) et, idéalement, à aller plus loin.
o Plaidoyer pour que les gouvernements envisagent de se joindre aux initiatives, cadres et actions existants, convenus au niveau international, qui sont conformes à la doctrine sociale catholique, et de les mettre en œuvre dans leurs cadres nationaux et régionaux.
Les obligations de respecter les droits et les devoirs dérivant d’instruments légaux internationaux, avec leurs propres standards, contribuent à la dignité de ceux qui fuient, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Un processus régulier, un procès juste et la jouissance des droits fondamentaux doivent être garantis, afin qu’ils puissent vivre une vie libre, digne et autosuffisante et qu’ils soient en mesure de construire leur nouvelle vie dans une autre société[55].
o Préconiser l’élaboration de politiques et de programmes d’aide à la réinstallation et au relogement des DC, en leur offrant des conditions de vie dignes, y compris un logement.
o Encourager une migration sûre, régulière et ordonnée pour les personnes à risque.
o Adopter une approche prospective qui prenne en considération les mesures visant à empêcher les pays en développement de connaître des situations de dégradation des terres et d’insécurité alimentaire combinées qui entraînent des migrations à grande échelle et le développement de mégapoles.
o Encourager et collaborer avec les gouvernements dans la création de systèmes d’éducation holistiques qui permettent à tous les enfants, y compris les enfants des DC, de réaliser et d’apprécier pleinement leur humanité commune, contribuant ainsi à un développement national pacifique et durable.
o Promouvoir la consultation des populations autochtones et locales avant le développement de projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’environnement et d’entraîner des déplacements.
7. Étendre le champ d’action de la pastorale
L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un israélite de souche, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu (Lévitique 19,34).
L’amour et la miséricorde de Dieu sont sans limites. Ils ne s’arrêtent pas aux frontières et ne font pas de distinction entre les citoyens et les étrangers, car Dieu prend soin de toute la famille humaine et de toute la création. L’extension de la pastorale implique d’être des témoins fidèles et inébranlables de cette grâce sans limites.
Défi
Confrontées à des différences ethniques, culturelles, linguistiques et rituelles et à des vulnérabilités particulières, les Églises locales ont souvent du mal à développer un ministère spécifique visant à prendre en charge les DC et à inclure ceux d’entre eux qui sont catholiques dans les paroisses locales.
Réponse
L’Église catholique est appelée à accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les DC, en mettant l’accent particulièrement sur une pastorale capable de répondre aux différents besoins des catholiques ainsi qu’à ceux de personnes d’autres religions et croyances.
Il est important que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et clairement le sens social de l’existence, la dimension fraternelle de la spiritualité, la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations pour aimer et accueillir tout le monde[56].
Cela peut se faire par des actions telles que :
o Créer des ministères pastoraux et engager des agents pastoraux là où la CCD est susceptible de se produire ou se produit déjà. Sinon, si les ressources ne sont pas disponibles, renforcer les ministères et aumôneries existants pour les migrants.
o Dans la mesure du possible, établir un bureau de coordination de la pastorale des DC au sein de la Conférence épiscopale, ou au niveau diocésain lorsque des conditions graves le justifient.
o Partout où les gouvernements disposent des ressources nécessaires pour aider les DC, envisager de collaborer et de proposer des projets communs. La contribution de l’Église consiste à présenter le « visage humain » de la crise climatique aux experts, afin de les aider à mieux comprendre la réalité au niveau local et à respecter la dignité humaine.
Nous sommes tous responsables du blessé qui est le peuple lui-même et tous les peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée, par cette attitude solidaire et attentive, l’attitude de proximité du bon Samaritain[57].
o Développer des programmes pastoraux qui intègrent l’aide humanitaire, l’éducation à la réconciliation, la protection efficace des droits et de la dignité, la prière et la liturgie, et le soutien spirituel et psychologique.
Il faut de l’espérance, du courage, de l’amour et de la créativité pour ranimer des vies. La priorité doit être accordée à un effort concerté, non seulement pour offrir à ces personnes une assistance logistique et humanitaire, mais davantage un soutien moral et spirituel. Les aspects spirituels et formatifs doivent être considérés comme une partie intégrante d’une « véritable culture de l’accueil »[58].
o Inclure les DC catholiques dans les programmes pastoraux des paroisses locales, en leur offrant un accompagnement spirituel qui les respecte et les valorise en tant que frères et sœurs avec leurs propres langues, traditions, coutumes et rites qu’ils chérissent, tout en les initiant aux traditions, coutumes et rites de la communauté d’accueil.
Le déplacement forcé de familles indigènes, paysannes, d’ascendance africaine et riveraines, expulsées de leurs territoires sous la pression ou par asphyxie faute d’opportunités, exige une pastorale commune dans la périphérie des centres urbains. Pour cela, il faudra créer des équipes missionnaires pour les accompagner, en coordonnant avec les paroisses et les autres institutions ecclésiales et extraecclésiales les conditions d’accueil, en offrant des liturgies inculturées et dans les langues des migrants ; en favorisant des espaces d’échanges culturels, en favorisant leur intégration dans la communauté et dans la ville et en les encourageant à y jouer un rôle actif[59].
o Responsabiliser et inclure efficacement les DC catholiques dans la mise en œuvre de programmes pastoraux répondant à leurs besoins.
Il sera aussi important de mener une action favorisant la connaissance mutuelle, en se servant de toutes les occasions données par le ministère pastoral ordinaire pour impliquer aussi les immigrés dans la vie des paroisses[60].
o Promouvoir des initiatives œcuméniques et interreligieuses répondant aux besoins matériels et spirituels de tous les DC.
L’action commune et la coopération avec les diverses Églises et Communautés ecclésiales, ainsi que les efforts conjoints avec ceux qui professent d’autres religions, pourraient donner lieu à la préparation d’appels toujours plus urgents en faveur des réfugiés et des autres personnes déplacées de force[61].
o Impliquer les jeunes dans le travail pastoral sur la CCD par l’élaboration de matériel créatif, y compris pour le catéchisme.
[Les jeunes] ont beaucoup à offrir avec leur enthousiasme, leur engagement et leur soif de vérité, à travers laquelle ils nous rappellent constamment le fait que l’espérance n’est pas une utopie et la paix un bien toujours possible. Nous l’avons vu dans la manière dont beaucoup de jeunes s’engagent pour sensibiliser les leaders politiques sur la question des changements climatiques[62].
8. Coopération en matière de planification et d’action stratégiques
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit (Éphésiens 4,4).
Tout en reconnaissant toujours qu’une pluralité d’idées et de plans d’action doit être conservée précieusement, il est essentiel de poursuivre ensemble le bien commun : une famille humaine créée par Dieu en tant que corps unique. La famille de l’Église ne doit jamais oublier que c’est l’Esprit Saint qui « suscite une grande richesse diversifiée de dons et en même temps construit une unité qui n’est jamais uniformité mais une harmonie multiforme qui attire[63] ».
Défi
La CCD pose des défis nouveaux et complexes, dont la réponse incombe aux différents acteurs religieux, sociaux et politiques. Des actions unilatérales et non coordonnées risquent de compromettre la rapidité et l’efficacité des réponses.
Réponse
L’Église catholique est appelée à promouvoir la coopération entre tous les acteurs catholiques dans la planification et l’action stratégique face à la CCD; à établir des partenariats avec d’autres groupes confessionnels et organisations de la société civile qui partagent la même vision et la même mission; et à s’engager dans une collaboration multipartite de façon à promouvoir une approche au déplacement climatique intégrée et centrée sur l’homme. Cela peut se faire par des actions telles que:
Pour affronter les problèmes de fond qui ne peuvent pas être résolus par les actions de pays isolés, un consensus mondial devient indispensable, qui conduirait, par exemple, à programmer une agriculture durable et diversifiée, à développer des formes d’énergies renouvelables et peu polluantes, à promouvoir un meilleur rendement énergétique, une gestion plus adéquate des ressources forestières et marines, à assurer l’accès à l’eau potable pour tous[64].
o Établir des réseaux actifs entre tous les acteurs catholiques engagés dans la CCD, coordonnés par les Conférences épiscopales aux niveaux national et régional, afin d’échanger des expériences positives, des leçons, des outils et des informations.
Pour une meilleure coordination de toutes les activités pastorales en faveur des immigrés, les Conférences épiscopales confieront cette mission à une Commission spécifique qui choisira un Directeur national avec la charge d’animer les différentes Commissions diocésaines[65].
o Promouvoir une coopération efficace en matière de planification et d’action stratégiques avec d’autres organisations confessionnelles et avec la société civile, aux niveaux national et régional, afin d’éviter le dédoublement et le gaspillage des ressources.
La coopération entre les diverses Églises chrétiennes et les diverses religions non chrétiennes dans cette action caritative permettra de réaliser de nouvelles avancées dans la recherche et la mise en œuvre d’une unité plus profonde de la famille humaine[66].
o Faciliter le dialogue collaboratif entre les organisations religieuses, les organisations de la société civile, les représentants des gouvernements et les agences internationales, afin de promouvoir la coopération nationale et régionale et la planification conjointe des mesures de contingence en prévision, pendant ou à la suite d’ unecatastrophe due à la crise climatique.
Cette coopération a montré que nous pouvons « obtenir des résultats importants qui permettent simultanément de préserver la Création, de favoriser le développement humain intégral et d’œuvrer pour le bien commun, dans un esprit de solidarité responsable et avec des retombées profondes et positives pour les générations présentes et futures »[67].
o Investir dans le partage des connaissances, la visibilité et la reproduction des meilleures pratiques et de la communication visant à proposer des réflexions et des modèles d’action innovants.
o Encourager la collaboration avec d’autres organisations confessionnelles et de la société civile.
Le phénomène du réchauffement global […] demande une réponse collective capable de faire prévaloir le bien commun sur les intérêts particuliers. […] Il faut donc que les leaders politiques s’efforcent de rétablir urgemment une culture du dialogue pour le bien commun et pour renforcer les institutions démocratiques et promouvoir le respect de l’état de droit, afin de prévenir des dérives anti-démocratiques, populistes et extrémistes[68].
o Encourager l’engagement actif de la communauté internationale par un soutien technique et une assistance financière aux nations les plus faibles qui subissent des déplacements climatiques.
Les pays pauvres doivent avoir comme priorité l’éradication de la misère et le développement social de leurs habitants. […] Ils doivent développer des formes moins polluantes de production d’énergie, mais pour cela ils doivent pouvoir compter sur l’aide des pays qui ont connu une forte croissance au prix de la pollution actuelle de la planète[69].
o Promouvoir, en collaboration avec tous les acteurs, le développement d’un système d’alerte et de réponse précoce, afin de suivre en temps réel le déplacement des populations et d’activer les réponses au niveau national ou régional.
9. Promouvoir la formation professionnelle en écologie intégrale
Les fidèles sont organisés […] pour que se construise le corps du Christ (Éphésiens 4,12).
Les talents et les dons reçus de Dieu ne doivent pas être cachés et dilapidés par peur, paresse, indifférence ou cupidité. Ils doivent être améliorés et affinés, afin que nous soyons bien équipés pour poursuivre le ministère qui nous a été confié : construire ensemble le Corps du Christ, unique et merveilleusement diversifié, être frères et sœurs dans la maison commune créée par Dieu.
Défi
L’ampleur et la complexité de la réponse aux défis posés par la CCD exigent des connaissances et une expertise professionnelles sur la question. Les coordinateurs et agents pastoraux ne peuvent pas se contenter d’improviser, car cela pourrait conduire à l’échec des initiatives.
Réponse
L’Église catholique est appelée à organiser et offrir une formation professionnelle en écologie intégrale aux agents pastoraux et autres praticiens qui partagent la même vision et la même mission. Ce type de formation doit avoir une large portée et être adapté aux divers besoins d’un vaste public, des personnes déplacées aux évêques. Cela peut se faire par des actions telles que :
o Organiser et proposer des cours, formels et informels, sur la CCD et l’écologie intégrale, en gardant toujours à l’esprit les implications de la dignité humaine et de l’écologie humaine, avec une perspective théologique claire.
Le droit à l’éducation – également pour les filles (exclues dans certaines régions) – […] est assuré en premier lieu par le respect et le renforcement du droit primordial de la famille à éduquer, et le droit des Églises comme des regroupements sociaux à soutenir et à collaborer avec les familles dans la formation de leurs filles et fils. L’éducation, ainsi conçue, est la base pour la réalisation de l’Agenda 2030 et pour sauver l’environnement[70].
o Produire des ressources documentaires (livres, films, etc.) qui intègrent les thèmes de la CCD pour les jeunes et les enfants .
Cette opportunité s’explicite dans un engagement exigeant mais hautement productif : repenser et mettre à jour l’intention et l’organisation des disciplines et des enseignements donnés dans les études ecclésiastiques, dans cette logique spécifique et selon cette intention spécifique. Aujourd’hui, en effet, « une évangélisation qui éclaire les nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu, avec les autres et avec l’environnement, et qui suscite les valeurs fondamentales devient nécessaire » (EG 74)[71].
o Inclure des éléments d’écologie intégrale et de conversion écologique dans tous les cours sur la doctrine sociale catholique : dans les séminaires, les programmes de formation des laïcs, les cours de formation des catéchistes, les cours de religion et d’éthique chrétienne.
Cette tâche considérable et qui ne peut pas être reportée demande, au niveau culturel de la formation universitaire et de la recherche scientifique, l’engagement généreux et convergent vers un changement radical de paradigme, et même – je me permets de le dire – vers une « révolution culturelle courageuse » (LS 114)[72].
o Améliorer la capacité de l’Église locale à collecter et à suivre les données concernant la CCD aux niveaux national et régional.
o Mettre régulièrement à jour les évaluations sur la CCD et les scénarios futurs, et les partager entre les partenaires afin de contribuer à y adapter la planification et l’action stratégiques.
o Améliorer la connaissance des accords pertinents tels que la Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-30, l’Agenda 2030 pour le développement durable, les Directives volontaires de la FAO sur la gouvernance responsable de la tenure et sur le droit à une alimentation adéquate.
10. Encourager la recherche universitaire sur la CCD
Un cœur intelligent veut acquérir la connaissance, l’oreille des sages la recherche (Proverbes 18,15).
Une personne sage et vraiment intelligente acquiert des connaissances grâce au travail minutieux et patient de recherche sur certaines questions, comme le déplacement, qui représentent des défis cruciaux que les chrétiens sont appelés à relever dans notre monde. La connaissance n’est pas recherchée seulement pour elle-même, mais elle sert à comprendre la réalité correctement afin d’agir de manière intelligente et selon la volonté aimante de Dieu pour tous les êtres humains.
Défi
Plusieurs institutions universitaires catholiques ont déjà mené des recherches scientifiques sur la CCD, mais les études sur le lien entre la CCD et les scénarios futurs sont rares.
Les études ecclésiastiques ne peuvent pas se limiter à transmettre des connaissances, des compétences, des expériences, aux hommes et aux femmes de notre temps désireux de grandir dans leur conscience chrétienne, mais elles doivent développer la tâche urgente d’élaborer des instruments intellectuels capables d’être proposés comme paradigmes d’action et de pensée, utiles à l’annonce dans un monde marqué par le pluralisme éthique et religieux[73].
Réponse
L’Église catholique est appelée à renforcer la recherche scientifique sur la CCD et à inviter les institutions universitaires et les universitaires catholiques à s’engager de manière proactive dans ce domaine d’étude. Cela peut se faire par des actions telles que:
o Soutenir le développement de programmes académiques traitant de la CCD, sur la base d’une collaboration entre les institutions académiques et les universitaires catholiques.
Ce ministère requiert clairement une formation appropriée pour tous ceux qui entendent ou ont la tâche de l’accomplir. Il est donc nécessaire que dès le début, dans les séminaires, la « formation spirituelle, théologique, juridique et pastorale […] soit sensibilisée aux problèmes soulevés dans le domaine de la pastorale de la mobilité »[74].
o Mettre en place des observatoires mondiaux et/ou régionaux pour le suivi constant, la collecte et l’encodage des données, et l’évaluation actualisée de la CCD.
o Promouvoir la recherche collaborative sur la CCD, par exemple sur la dimension humaine de la CCD, le développement agricole et rural, le développement urbain, la réduction de la pauvreté, la vulnérabilité particulière des femmes et des enfants, la nutrition et la sécurité alimentaire, les mécanismes de protection sociale pour les personnes déplacées, ou la résilience et l’adaptation.
[Il y a une] nécessité urgente de « faire réseau » entre les diverses institutions qui, partout dans le monde, cultivent et promeuvent les études ecclésiastiques, en activant avec détermination les synergies opportunes – y compris avec les institutions académiques des divers pays et avec celles qui s’inspirent des diverses traditions culturelles et religieuses[75].
o Documenter les meilleures pratiques en matière de résilience climatique, d’assistance aux personnes déplacées et d’inclusion sociale ; et élaborer des recommandations pour l’évaluation des risques, les stratégies d’adaptation au climat et les plans d’urgence.
[Il faut donner vie à] des centres spécialisés de recherche ayant pour fin l’étude des problèmes de notre époque qui assaillent aujourd’hui l’humanité, en arrivant à proposer d’opportunes et réalistes pistes de résolution[76].
o Promouvoir une compréhension académique plus large, intégrant la perspective spirituelle et étant en cohérence avec la Doctrine sociale catholique.
Cela demande non seulement une connaissance théologique approfondie, mais aussi la capacité de concevoir, indiquer et réaliser des systèmes de représentation de la religion chrétienne capables d’entrer profondément dans les différents systèmes culturels. Tout cela demande une amélioration de la qualité de la recherche scientifique et une évolution progressive du niveau des études théologiques et des sciences associées[77].
Nous espérons sincèrement que les lecteurs de cette brochure seront amenés à approfondir leur connaissance de la crise climatique, de ses causes, son évolution et ses conséquences ainsi que des perspectives pour l’atténuer et la gérer correctement, notamment en ce qui concerne la CCD.
Comment négliger le phénomène grandissant de ce qu’on appelle les «réfugiés de l’environnement»: ces personnes qui, à cause de la dégradation de l’environnement où elles vivent, doivent l’abandonner – souvent en même temps que leurs biens – pour affronter les dangers et les inconnues d’un déplacement forcé?[78]
La question se répond d’elle-même : « Non, nous ne pouvons pas ! » C’est pourquoi cette brochure est éminemment pastorale, comme l’indique le début de son titre, et éminemment pratique, comme le montrent les titres de ses dix sections.
« Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus[79] », parmi lesquelles figurent, dans ce cas, les souffrances de ceux que la crise climatique oblige à fuir.
Heureuse de la prise de conscience qui, par la grâce de Dieu, se développe parmi les habitants du globe, l’Église continuera à mettre en lumière le sort des personnes déplacées par la crise climatique et cherchera à accroître la sensibilisation à l’égard de leur détresse, et à nous encourager à agir efficacement.
Les OPDC veulent nous inciter « en commençant par le bas et le niveau initial, [à] lutter pour ce qui est le plus concret et le plus local, jusqu’à atteindre les confins de la patrie et du monde[80] » pour accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ceux que la crise climatique a dépouillés, blessés et abandonnés – tout comme le pauvre homme envers lequel le Bon Samaritain a fait preuve d’une si grande attention et préoccupation.
La Section M&R espère que les Églises locales et les organisations catholiques trouveront les OPDC utiles pour aborder la question des DC et les besoins concrets de nos frères et sœurs affectés. Lors de l’évaluation des programmes ou de la planification de nouveaux programmes, en faisant de la sensibilisation ou du plaidoyer, n’hésitez surtout pas à vous concentrer sur les réponses détaillées dans les OPDC qui semblent particulièrement pertinentes dans votre région, et à en ajouter d’autres basées sur la doctrine sociale de l’Église. Plus spécifiquement, la section suggère ceci :
1. Utiliser les OPDC dans les campagnes d’information et de sensibilisation et pour guider les efforts locaux visant à accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les DC.
2. Partager ce livret avec les ONG catholiques et les groupes de la société civile de votre pays – en particulier avec ceux qui s’occupent des DC et d’autres personnes vulnérables en déplacement – en les invitant à prendre part dans une action et défense commune.
3. Travailler avec les responsables gouvernementaux chargés des DC et engager un dialogue avec eux sur la base de ces OPDC.
La Section M&R souhaite recueillir les expériences des DC et de ceux qui les accompagnent. L’intention est de donner une visibilité particulière aux expériences positives, aux initiatives fructueuses et aux bonnes pratiques. La Section M&R souhaite également recevoir des informations sur la façon dont les OPDC adoptées au niveau pastoral, œcuménique, interreligieux et par les organisations de la société civile ; ainsi que sur les réponses des universités, des entreprises et des gouvernements. Veuillez envoyer ces nouvelles à info@migrants-refugees.va.
Pour accéder aux fichiers de cette brochure ou à ses documents, ou pour des mises à jour et des réflexions, prière de visiter le site web de la Section M&R : migrants-refugees.va.
Au nom de tous les DC et de ceux qui les accompagnent avec générosité et désintéressement, que Dieu bénisse tout effort de justice et toute œuvre de miséricorde pour « [réunir] les dispersés de Juda des quatre coins de la terre » (Isaïe 11,12).
__________________________
[1] Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Réchauffement planétaire de 1,5 °C. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, Genève, 2018, chap. 1
[2] Cf. BioScience 70/1, 2020.
[3] François, Message pour la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, Cité du Vatican, 2020.
[4] François, Adresse aux participants à la 41e session de la conférence de la Fao, Cité du Vatican, 2019.
[5] CA 31.
[6] LS 30.
[7] LS 28.
[8] Cf. Centre de suivi des déplacements internes (IDMC), Rapport mondial sur le déplacement interne (GRID) 2020, Geneva 2020. L’IDMC est une source d’information et d’analyse de premier plan grâce à son GRID annuelle : https ://www.internal-displacement.org. L’IDMC fait partie du Conseil norvégien pour les réfugiés : www.nrc.no.
[9] Cf. ibid.
[10] Cf. ibid.
[11] LS 57.
[12] Saint Paul VI, Apostolic Letter Octogesima Adveniens, Cité du Vatican, 1971
[13] Cf. Saint Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, Cité du Vatican, 1967 : AAS 59 (1967), 264.
[14] FT 21.
[15] Conférence des NAtions unies sur les océans, Factsheet : People and Oceans, 2017, https ://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/05/Ocean-fact-sheet-package.pdf.
[16] Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 C (2018), chapitre 3.
[17] Ibid.
[18] B. Neumann et al., « Future Coastal Population Growth and Exposure to Sea-Level Rise and Coastal Flooding : A Global Assessment », PloS One 10, n° 3, mars 2015.
[19] Cf. Banque mondiale, Groundswell : Se préparer aux migrations climatiques internes, Groupe de la Banque mondiale, 2018.
[20] Cf. M. Suárez-Orozco (éd.), Humanitarianism and Mass Migration : Confronting the World Crisis, 1ère édition, University of California Press, 2019.
[21] Benoît XVI, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 2010, Cité du Vatican, 2009.
[22] François, Message à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP-23), Bonn, 2017.
[23] François, Message pour la Journée mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, Cité du Vatican, 2018.
[24] QA 58.
[25] CIV 51.
[26] QA 58.
[27] FT 127.
[28] Synode des évêques Assemblée spéciale pour la région pan-amazonienne, Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale, Cité du Vatican, 2019, 23.
[29] François, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 2014, Cité du Vatican, 2013.
[30] François, Message aux participants à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, Cité du Vatican, 2019.
[31] François, Discours aux autorités civiles, à la société civile et au Corps diplomatique à Lima, Pérou 2018.
[32] Déclaration universelle des droits de l’homme, article 3.
[33] François, Discours aux autorités civiles, à la société civile et au Corps diplomatique à Tallinn, Estonie, 2018.
[34] FT 129.
[35]CCEE, FABC, FCBCO, COMECE, SECAM, Déclaration conjointe de 2018 des conférences épiscopales sur la justice climatique, Rome, 2018.
[36] QA 17.
[37] François, Discours aux autorités civiles, à la société civile et au Corps diplomatique à Lima, Pérou 2018.
[38] François, Discours aux évêques de la Méditerranée, Bari, 2020.
[39] FT 129.
[40] INFORM est une collaboration de l’équipe de travail sur la préparation et la résilience du Comité permanent interorganisations et de la Commission européenne. Cf. https ://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index.
[41] AJCR 93.
[42] Cf LS 1.
[43] Jean-Paul II, Discours aux participants au troisième congrès mondial sur la pastorale des migrants et des réfugiés, Cité du Vatican, 1991, 3.
[44] François, Discours aux participants à la 39e session de la FAO, Cité du Vatican, 2015.
[45] François, Message pour la 104ème Journée mondiale du Migrant et du Réfugié, Cité du Vatican, 2017.
[46] LS 26.
[47] LS 26.
[48] François, Discours aux membres du Corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège, Cité du Vatican, 2020.
[49] Cf Nations unies, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, 2018, 31.
[50] LS 183.
[51] François, Discours aux membres de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, New York 2015.
[52] AJCR Présentation.
[53] AJCR 83.
[54] Le Cadre de Sendai sur la réduction des risques de catastrophe est un outil élaboré par le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR) afin de prévenir les nouveaux risques de catastrophe et réduire les risques existants. Cf. UNDRR, Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.
[55] AJCR Présentation.
[56] FT 86.
[57] FT 79.
[58] AJCR 85.
[59] Synode des évêques Assemblée spéciale pour la région pan-amazonienne, Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale, Cité du Vatican, 2019, 29.
[60] EMCC 50.
[61] AJCR 110.
[62] François, Discours aux membres du Corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège, Cité du Vatican, 2020.
[63] EG 117.
[64] LS 164.
[65] EMCC 70.
[66] RCS 34.
[67] François, Discours aux participants à la XXXIe réunion des parties au Protocole de Montréal, Cité du Vatican, 2019.
[68] François, Discours aux membres du Corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège, Cité du Vatican, 2020.
[69] LS 172.
[70] François, Discours aux membres de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, New York 2015.
[71] VG 4.
[72] VG 3.
[73] VG 5.
[74] AJCR 101.
[75] VG 4.
[76] VG 4.
[77] VG 5.
[78] Benoît XVI, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 2010, Cité du Vatican, 2009.
[79] LS 13.
[80] FT 78.