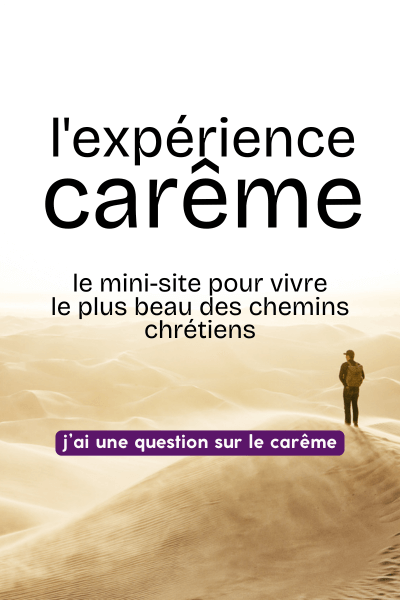Le Festival de Cannes 2025 et le Jury œcuménique (13 – 24 mai 2025)
Historique
Depuis 1952, chaque année un jury de professionnels cinéphiles et chrétiens est invité par le Festival de Cannes à visionner les films de la compétition officielle et à remettre un prix
Dans les premiers temps de l’après-guerre, le Prix OCIC (Office Catholique international du Cinéma) avait été créé pour « distinguer l’œuvre la plus capable de contribuer au relèvement spirituel et moral de l’humanité ». Depuis 1974, le Jury œcuménique remet un prix pour « encourager les films qui expriment des qualités humaines positives, sensibilisent aux dimensions spirituelles de la vie, illustrent les valeurs de l’Evangile ou interpellent nos choix et nos sociétés. »
Festival de Cannes 2025
L’édition 2025 a été marquée par un engagement fort du Festival aux côtés de l’Ukraine, avec une première journée spéciale (hors programme) dédiée par Thierry Frémaux, son délégué général, à trois documentaires, dont le film ZELENSKY, d’Ariane Chemin et Yves Jeuland. Il retrace l’incroyable parcours de celui qui, de clown et acteur, deviendra un président de la république et un chef de guerre à la popularité immense. Le film a été diffusé le soir même sur Arte et est encore disponible sur Arte.tv jusqu’au 11 décembre prochain. Juliette Binoche, présidente du Jury du Festival, a de son côté rendu un hommage appuyé à Fatima Hassouna, dite Fatem, jeune photographe palestinienne de 25 ans, qui aurait dû venir à Cannes présenter le film PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK. Mais, le 16 avril, elle et plusieurs membres de sa famille ont été tués par une bombe à Gaza. Ce film fort et émouvant, signé de l’iranienne Sepideh Farsi, sortira dans les salles de cinéma en France le 24 septembre prochain.
Jury œcuménique 2025
Nommés par SIGNIS, Association catholique mondiale pour la communication, et INTERFILM, Organisation protestante internationale du cinéma, les six membres du Jury œcuménique sont des chrétiens engagés dans le monde du cinéma (journalistes, réalisateurs, théologiens, enseignants…).
Prix du Jury œcuménique 2025
JEUNES MÈRES, de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Les deux frères réalisateurs grands habitués du Festival, remportent ici leur 1er Prix œcuménique cannois (ils avaient reçu une mention pour ROSETTA en 1999, une pour LE FILS en 2002, et le Prix spécial des 40 ans du Jury œcuménique en 2014 pour l’ensemble de leur œuvre).
Dans Jeunes mères, ils relatent le parcours de cinq adolescentes confrontées à une maternité précoce et accueillies dans une maison maternelle, à Liège en Belgique, où ils ont tourné l’intégralité de leurs films. Chacune incarne un parcours singulier, toutes marquées par des environnements familiaux et sociaux difficiles (pauvreté, toxicomanie, violence, pères absents ou mères défaillantes). Face à des choix aussi lourds à poser que garder son enfant ou le confier à l’adoption, ces jeunes filles cherchent la voie la meilleure pour leur enfant. Et avec l’aide d’un personnel encadrant bienveillant, elles tentent d’éviter les écueils de leur propre histoire.
Un film plein de lumière et d’espérance, qui a conquis le Jury œcuménique. Il a ainsi motivé son choix : « [Ce film] illustre une approche éthique, non pas par de grandes démonstrations, mais par des gestes bienveillants. C’est une histoire racontée avec douceur dans la meilleure tradition des auteurs qui, une fois de plus, sont capables d’apporter de la nouveauté à leur style épuré. Le film explore la première et essentielle relation de toute vie humaine : la maternité. Cela nous ramène à une vérité profonde : l’amour peut perdurer, même quand la famille — cette structure sociale fondamentale — est défaillante, quand les circonstances sont défavorables, quand le fardeau des responsabilités d’adultes pèse sur la jeunesse. Ce film nous révèle que même les petits gestes persistants d’affection et de soin, qu’ils proviennent de personnes ou d’institutions, peuvent guérir les blessures les plus profondes. »
Autre film marquant
SIRAT, d’Olivier Laxe (sortie le 10 septembre)
SYNOPSIS : Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers lancé à la recherche d’une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites. Un road-movie rude et radical, sur l’univers très particulier des rave-partys. Une succession d’évènements dramatiques va conduire ce père de famille à un dépouillement total qui passe aussi par un chemin de solidarité et de fraternité. A la fois métaphysique et aux allures pré-apocalyptiques, Sirat prend la forme d’une parabole moderne, âpre et saisissante.
Le réalisateur écrit :
« Dans les expériences ultimes, proches de la mort, il semblerait qu’un point de rupture puisse nous envahir et nous mettre en mouvement. Dans le bon sens. Ce sont des situations d’authenticité radicale, où la vie te saisit et te demande qui tu es vraiment ; où tu as le sentiment d’être jeté dans un vide sans filet. La vie te demande de fermer les yeux et de traverser un champ de mines. Dans ces moments-là, je suis convaincu que l’être humain peut faire surgir le meilleur de lui-même, une force intérieure liée à sa survie, mais aussi à son essence la plus profonde. » « Ce qui m’intéresse, c’est le sens courant du mot Sirāt, qu’on pourrait traduire par “chemin” ou “voie”. Un chemin à deux dimensions, l’une physique, l’autre métaphysique ou spirituelle. Sirāt pourrait être ce chemin intérieur qui te pousse à mourir avant de mourir, comme c’est le cas pour Luis, le personnage principal de ce film. On appelle aussi Sirāt le pont qui relie l’enfer et le paradis. »
Des films 2025 à retenir
UN SIMPLE ACCIDENT, de Jafar Panahi (Palme d’or – sortie le 1er octobre)
Dans le garage où il s’arrête faire réparer sa voiture, un homme croit reconnaitre à sa démarche boiteuse, son ancien tortionnaire. Après l’avoir enlevé et séquestré dans son van, il part à la recherche d’anciens codétenus pour s’assurer de son identité. Commence alors pour le petit groupe un périple, par moments cocasse et burlesque, qui les met face à des questions vertigineuses. Comment dépasser la tentation de vengeance ? Peut-on pardonner à son bourreau ? Comment rester humain et vivre en paix sans pouvoir oublier ?
Un film courageux, tourné clandestinement en Iran par un réalisateur plusieurs fois emprisonné et frappé d’interdiction de filmer et de sortie de territoire. Il était néanmoins présent sur la scène du Palais des Festivals pour présenter son film qui a obtenu une Palme d’or justifiée.
RENOIR, de Chie Hayakawa (sortie le 17 septembre)
Sur le thème du deuil, un film très lumineux, baigné de douceur et de poésie. Comme le peintre qui donne son titre au film, la réalisatrice japonaise brosse à petites touches impressionnistes, le portrait d’une jeune fille de 11 ans, face à un père hospitalisé en soins palliatifs et une mère indifférente aux sentiments qui la traversent. L’influence du maitre Hirokazu Kore-eda n’est jamais loin dans cette façon légère et grave de filmer la solitude de l’enfance et son imaginaire salvateur.
La réalisatrice déclare : « Peut-être que le fait d’avoir vécu auprès d’un père mourant a éveillé en moi un intérêt pour la manière dont chacun affronte la mort. Renoir est davantage un récit familial intime. C’est une histoire pour tous ceux qui se sentent seuls au sein même de leur famille – y compris moi, à une époque de ma vie. » « Le film se situe à la fin des années 1980, une période de transition où la société japonaise passait de l’après-guerre à une ère capitaliste. Les Japonais travaillaient sans relâche pour rattraper les pays occidentaux, et nourrissaient une grande admiration pour leur culture. »
DEUX PROCUREURS, de Sergei Loznitsa (sortie le 12 novembre) / LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE, de Tarik Saleh (sortie le 29 octobre) / L’AGENT SECRET, de Kleber Mendoça Filho (sortie le 14 janvier 2026)
A l’image de la Palme d’or (Un simple accident), d’autres films de la sélection avaient cette année pour toile de fonds des états totalitaires. Qu’ils arrivent de Russie, d’Égypte ou du Brésil, sous forme de film historique ou de thriller d’espionnage, ces trois fictions puissantes dénoncent des régimes autoritaires violents, aux conséquences individuelles et collectives dramatiques.
Valérie de Marnhac, coordinatrice du Jury œcuménique de Cannes pour SIGNIS