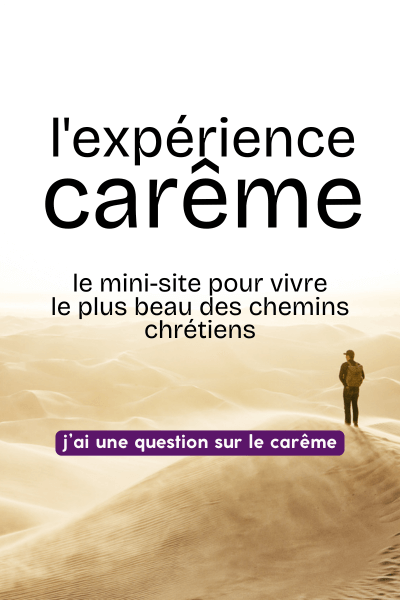20 ans d’Observatoire Foi et Culture à la Conférence des évêques de France
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 5 mars 2025 , OFC 2025, n°8 sur les 20 ans d’Observatoire Foi et Culture à la Conférence des évêques de France
L’Observatoire Foi et Culture est apparu comme une hypothèse au cours des débats de 2005 lors d’une réforme de la Conférence, qui a rendu une plus grande autonomie aux diocèses tout en assumant la nécessité d’alléger les services permanents et d’en libérer des prêtres disponibles, de plus en plus nécessaires au service de la pastorale ordinaire.
A l’époque, plusieurs évêques dont Claude Dagens et Maurice de Germiny firent savoir l’intérêt de maintenir une structure légère afin de poursuivre une veille de possibles dialogues, interpellations ou rencontres entre la foi et la culture, et ce dans la mesure où cet enjeu est par nature plus large que l’espace d’un diocèse. Il fut retenu que ce serait un simple observatoire, c’est-à-dire comme une tour de guet plutôt qu’une instance coordinatrice ou assurant une présence par le témoignage dans le dialogue. Et il fut décidé que, dans l’appellation, la foi serait nommée la première, comme motivation de l’intérêt des catholiques pour la culture, au sein de laquelle elle n’a pas à chercher à s’ajouter, s’introduire ou garder une place qu’elle a toujours eue dans les sociétés qu’elle imprègne.
Ainsi naît officiellement cet Observatoire en novembre 2006. Il est d’abord confié à Mgr Maurice de Germiny. On y convie les « trois têtes de pont » que sont Guy Coq, héritier spirituel d’Emmanuel Mounier et présent dans le réseau des équipes enseignantes, Jean Duchesne, cofondateur de l’édition française de la revue Communio, proche du cardinal Lustiger dont il deviendra l’exécuteur littéraire, et le P. Hugues Derycke, prêtre de la Mission de France, représentant du Service Incroyance et Foi, maintenu par Mgr Dagens (mais appelé à disparaitre dans la réforme).
L’Observatoire se donne un triple objectif (selon l’éditorial de Mgr de Germiny dans le premier numéro de la revue par laquelle il manifeste son existence et commence son travail) :
– Le dialogue avec les non-croyants et les nouvelles formes de croyances,
– L’attention aux courants contemporains de pensée et leurs liens avec le développement des sciences et des technologies,
– L’expression et la création artistique.
L’Observatoire se donnait alors trois moyens :
– Une réunion mensuelle, convoquée par l’évêque-président, au cours de laquelle les membres échangent librement sur les questions d’actualité culturelle, mais aussi sociale, politique et religieuse, et préparent les événements, manifestations et publications qu’il revient à l’Observatoire de proposer.
– Une revue trimestrielle Foi et culture. La revue cesse de publier en mars 2010 après 9 numéros. Nettement déficitaire, elle ne pouvait tenir que par le soutient personnel et discret de Mgr de Germiny.
– Et un site internet qui s’est progressivement développé et est accessible sur https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/culture/observatoire-foi-culture/
Aujourd’hui l’Observatoire s’est doté d’autres moyens :
– Un colloque annuel d’une journée entre fin novembre et début décembre à la Maison des évêques de France, dont les textes furent d’abord publiés et désormais sont disponibles sur le site de la conférence. Depuis deux ans, ce colloque peut être suivi à en visio à distance.
– Des fiches (un recto-verso avec une illustration) de lectures, ou sur des films ou spectacles, des événements musicaux ou des expositions, qui sont transmises régulièrement dans le courrier hebdomadaire des évêques, et qui sont ensuite également disponibles sur le site de la conférence, soit plus de 40 fiches par an. Le principe est d’attirer l’attention sur des faits culturels significatifs qui n’ont pas bénéficié de la couverture médiatique qu’ils mériteraient. Ces fiches sont préparées par un membre de l’Observatoire (le plus souvent spontanément, en fonction de compétences propres, mais aussi après discussion), et soumises à l’évêque-président, qui apprécie l’intérêt de la diffusion et fournit lui-même des contributions qui permettent de soutenir un rythme hebdomadaire.
– Les Mardis de l’Observatoire, depuis deux ans selon un rythme souple, de deux ou trois fois par an, de 18h30 à 20h00, dans les locaux de la conférence épiscopale. La soirée commence par une présentation du thème (lié à un débat d’actualité), et un échange, régulé par un animateur membre de l’Observatoire, s’instaure avec deux ou trois experts dont un évêque. L’accès aux Mardis est possible en visio, et on cherche à privilégier cette possibilité pour élargir l’audience de l’observatoire.
– Encore en recherche après un premier essai : des notes de conjoncture ou de débat, diffusées comme les fiches hebdomadaires.
À noter l’importance de pouvoir organiser ces rencontres dans les locaux de la Conférence épiscopale. Ceci permet de valoriser la participation de personnalités politiques, littéraires, universitaire, chercheurs, journalistes, acteurs, et plus largement « culturelles », qui apprécient de pouvoir entrer en dialogue avec l’Église dans son lieu de coordination nationale. L’expérience montre que cette forme d’ouverture symbolique confère un véritable attrait aux invitations lancées. Le site de l’avenue de Breteuil est un véritable atout pour valoriser le service et la mission de l’Observatoire. L’accueil par l’Observatoire sur le site de Breteuil de personnalités proches ou non de l’Église fait clairement apparaître l’ouverture culturelle inhérente au catholicisme.
Plusieurs évêques se sont succédés à la tête de l’Observatoire :
– Mgr Maurice de Germiny, évêque de Blois (2006-2010),
– Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers (2010-2016),
– Mgr Hubert Herbreteau, évêque d’Agen (2016-2022),
– Et de nouveau Mgr Pascal Wintzer (depuis 2022), devenu récemment (2024) archevêque de Sens-Auxerre.
Les membres de l’Observatoire sont cooptés de façon informelle sur proposition de l’un ou plusieurs d’entre eux, avec l’accord du président, sans engagement formel, et demeurent actifs à proportion de leur disponibilité, de leur intégration au groupe et des contributions qu’ils peuvent apporter.
Les membres réguliers en cette année 2025 sont :
Mmes Elisabeth Pelsez, Isabelle Richebé, Bertilie Walckenaer, MM. Vincent Aucante, Emmanuel Bellanger, Jean Duchesne, Hervé Lejeune, Benoît Pellistrandi, Fabien Vasseur, les PP. Hugues Derycke, Denis Dupont-Fauville, Éric Mouterde et Robert Scholtus, auxquels s’ajoutent un certain nombre de personnes qui restent attentives à cette démarche sans trouver le temps de se libérer pour les réunions, mais sont destinataires en préalable des fiches rédigés par les membres plus réguliers. L’Observatoire a aussi dans toute la France une quarantaine de « correspondants » informés de ses projets et activités et qui peuvent présenter des contributions.
L’Observatoire est accompagné par un secrétaire général adjoint de la conférence, le P. Éric Mouterde, et par un diacre permanent de Paris, M. Hervé Lejeune, qui assure le lien régulier avec les services de la Conférence. Dans ce cadre, nous bénéficions de la compétence et de la réactivité de Mme Mireille Alexandre.
Après avoir été rattaché à la Commission doctrinale, l’Observatoire est aujourd’hui intégré dans le pôle « Dialogue, bien commun et amitié sociale ».
Par ailleurs, la réforme actuelle de la Conférence manifeste l’intérêt pour ce type de structure souple, puisque d’autres observatoires sont nés depuis la création de l’Observatoire Foi et Culture : « Famille, éthique et vie », « Innovation et société », « Justice et paix », « Nouvelles Croyances » … La mission de l’Observatoire perdure. Elle peut être renouvelée dans sa définition au fil de l’expérience. Par essence, un observatoire ne peut être un lieu de gouvernement, ni même une instance dogmatique, mais a une fonction d’intelligence des mutations culturelles. Il lui faut garder une forme de sympathie de ces mutations. Ceci n’exclut pas la critique. Cependant, l’étonnement doit rester préalable. Il s’agit de traduire cette intelligence dans des débats, des éclairages croisés, des confrontations d’opinions, tout en manifestant la richesse de la tradition chrétienne et de son apport. Ce principe d’une ouverture de l’Église à la culture et à une possible confrontation avec la foi est ancien. Il est renouvelé face aux formes actuellement dégradées des débats de société. Il importe de garder le cap d’une ouverture où peut se risquer la foi chrétienne dans ce qui parfois peut lui paraitre le plus étranger ! La charité et l’universel catholique relèvent de cette exigence.
Les rencontres mensuelles de l’observatoire ont construit une réelle amitié qui dépasse des sensibilités chrétiennes différentes. Cette amitié se nourrit au fil des discussions et de la découverte de la variété des compétences disciplinaires de chaque membre. Ces rencontres sont joyeuses ce qui en favorise la fidélité de la participation.
Hugues Derycke, OFC