« Une enfance catholique » de Véronique Olmi (Le bar de la Sirène, Seuil, 2025)
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 04 février 2026, OFC 2026, n°8 sur Une enfance catholique de Véronique Olmi (Le bar de la Sirène, Seuil, 2025)
On apprécie les textes de Véronique Olmi ; beaucoup la connaissent certainement par le livre qu’elle consacra à celle qui deviendra sainte Josephine-Bakhita : Bakhita (Albin Michel, 2017).
Son nouveau livre a un tour autobiographique, il raconte comment son enfance et son adolescence ont été marquées par un catholicisme. J’écris « un » catholicisme, car ce qu’elle a vécu n’en est pas la seule forme possible, même pour des personnes nées au tournant des années 1960 (elle est née en 1962). Cependant, pour elle comme pour chacun, l’enfance demeure une période fondatrice et explique en bonne part les choix qui viendront ensuite. Lire cette Enfance catholique parle d’une situation singulière, d’une époque révolue, d’images de Dieu ordinairement absentes dans la catéchèse, quoique…, mais éveille avant tout les éducateurs et les adultes, non pour les rendre muets par crainte de déformer des consciences enfantines, mais vigilants et surtout requis à éclairer leur propre foi pour que celle-ci soit donnée au Dieu de Jésus Christ et non à des représentations éloignées de la Révélation biblique.
« LA RELIGION ETAIT TOUT. Contenait tout. Dirigeait tout. Elle était en nous, nous l’avions intégrée et Dieu, qui avait tout créé, était partout : il voyait tout. […]
La couleur de notre cœur, que nous noircissions à chacun de nos péchés, et qu’il fallait éclaircir en nous accusant en confession » p. 25.
« La religion n’était pas pour moi un recours ou un secours, elle était l’ambiance dans laquelle je vivais.
Je savais que Dieu n’était pas un vieux barbu sur un nuage. Il incarnait néanmoins le châtiment du père, un père vengeur envers qui nous avions tous, enfants comme adultes, une dette. Comment la rembourser était le travail de toute une vie. Il n’est pas question de faire semblant, d’être insouciant ou oublieux. Dieu ne relâchait pas sa surveillance et j’avais intégré une chose très simple :
Il me voit. Il me voit tout le temps.
Il me surveille. Il me surveille tout le temps. Il tient les comptes. Et il ne néglige rien » p. 61-62.
(Nous retrouvons le « Dieu du regard » des Mots de Jean-Paul Sartre ; le Dieu inquisitorial et surveillant.)
Le sentiment de culpabilité naît d’une telle pensée, d’un tel discours. La personne ne connaît jamais la paix, la joie ; elle peut aussi être conduite à cultiver des stratagèmes de dissimulation, qui peuvent jouer socialement, mais qui engendrent une mauvaise conscience permanente. « Il nous regardait vivre. Il nous avait créés et créés décevants.
Je savais qu’il aimait le sacrifice, le repentir, la souffrance, l’humilité, le respect, l’adoration, la contrition, la génuflexion, la supplication, la mortification. La soumission » p. 36.
Ceci n’est certes pas l’apanage du catholicisme ; les films d’Ingmar Bergman le déploient à l’envi au sujet du luthéranisme (et qui ne pratique même pas le sacrement de pénitence).
Les événements intimes de la vie de Véronique Olmi ont accentué cette forme de désespérance. Ses parents donnèrent naissance à une fille, Catherine, qui, mourant très vite, ne put être baptisée, seulement ondoyée, et, de ce fait, promise aux limbes. « Tant de générations de parents partout dans le monde et depuis si longtemps, ont vécu cette double peine de l’ondoiement. C’est au XIIème siècle que l’Eglise a mis cette pratique en place, quand la mortalité infantile était élevée et que les prêtres débordés, avaient délégué ce sous-pouvoir aux femmes. Elle n’a été que prudemment abolie par Benoît XVI en 2007, quand les théologiens du Vatican ont admis que les limbes n’existaient pas, mais restaient cependant ‘’une opinion théologique possible’’ et que l’on pouvait ‘’espérer’’ que les enfants morts sans baptême soient sauvés » p. 23.
C’est aussi le purgatoire qui est présenté comme ce lieu de peines et de tourments nécessaires pour que le chemin se poursuive. « Il y avait à l’entrée de chaque église des troncs pour les âmes du purgatoire, et ils étaient gris, si petits et si laids, que j’ai associé les âmes du purgatoire à cet état misérable, c’étaient des déclassés, des morts de seconde zone. Pourtant, les messes payantes et posthumes me perturbaient, je n’étais pas tranquille. Et si ce n’était pas assez ? Si leur nombre n’était pas suffisant ? Si elles étaient mal dites ? » p. 35.
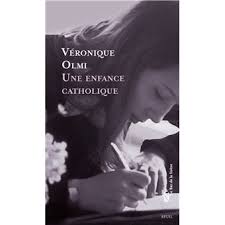
Il faut aussi souligner, ceci peut expliquer cela, que le grand-père de Véronique Olmi fut un des cadres des Croix-de-Feu. « Dans notre famille, la politique tenait une grande place. Le colonel de La Rocque, le président général des Croix-de-feu, mouvement créé par d’anciens combattants après le traumatisme de la Grande Guerre, avait été le parrain de ma mère et l’idole absolu de ma grand-mère. Il avait surtout été l’ami de mon grand-père qui avait créé la section Croix-de-feu du Havre et dirigé les sections de la Normandie et de l’Ile-de-France » p. 73-74.
Cette enfance conduisit Véronique Olmi à rejeter ce qui lui fut transmis ; Dieu, l’Eglise… mais pas Jésus Christ ! « Si je priais ce Dieu sans l’aimer, j’aimais son fils. Il était humain. Il était celui que je rêvais de rencontrer, celui dont chaque parole, chaque épisode de vie me faisait rêver. J’aimais l’imaginer. J’aimais à Pâques quand la télévision passait des films qui racontaient sa vie. J’étais émue de le voir entrer dans Jérusalem sur un petit âne » p. 63.
« L’Eglise a choisi d’oublier que Jésus a enfreint les lois patriarcales de son temps. Alors que les femmes étaient assignées à la sphère domestique et excluent de toute vie religieuse officielle, il les a accueillies comme disciples au même titre que les hommes, même si elles ont disparu des textes officiels de l’Evangile catholique. Et c’est à l’une d’elles que, ressuscité, il est apparu en premier, pour en faire ‘’l’apôtre des apôtres’’ » p. 48.
« Il y a tant de contradictions, au sein de l’Eglise catholique, que je me demande comment le Christ a pu, lui qui fut, comme le dit Pasolini, ce ‘’révolutionnaire sous-prolétaire, suivi par des sous-prolétaires’’, être à l’origine d’une telle institution patriarcale, puissante et si souvent maltraitante. Comment a-t-on pu, alors qu’il promettait la paix, faire tant de guerres en son nom ? Comment tant d’enfants, tant de femmes, laïques ou religieuses, peuvent-ils être agressés sexuellement, violés, maltraités, partout dans le monde au sein de cette Eglise, sans que cela ne fasse réellement scandale, sans que ne soit remis en cause son fonctionnement même, sans qu’il y ait une révolution qui abolisse cette violence systématique ? » p. 85.
On peut être las de ces textes qui ajoutent à des dénonciations déjà si nombreuses. Pourtant, ne sont-ils pas autant d’appels, de stimulations, pour vivre, personnellement et collectivement, les conversions qui rendent plus fidèles et proches du Nazaréen et du Père des miséricordes dont il est le témoin ?
« S’il y a blasphème, il n’est pas dans un film, un livre, une pièce de théâtre ou une caricature.
S’il y a blasphème, il est dans ce détournement du message christique.
Au milieu des prédateurs, il y a des êtres sincères, engagés et bons, de vrais apôtres, qui luttent pour que vive ce message tel qu’il a été donné aux hommes. Ce sont eux, les saints, ces héros du quotidien, sans apparat et sans triomphe. Ce sont eux les admirables, hommes et femmes de foi, hommes et femmes de l’ombre » p. 86.
Face à la culpabilité, à la mauvaise conscience, Véronique Olmi a fait le choix de la joie. Pour elle, ceci pris la forme d’un spectacle, à Aix-en-Provence, en 1974.
« La joie se décidait.
Elle était un contre-courant, une protestation, le refus de la peur, du morbide et du punitif. Le Christ pouvait l’incarner. Et c’est ce qui nous submergea lorsqu’en 1974, la comédie musicale Godspell, fut jouée à Aix par la troupe du Théâtre de la Porte Saint-Martin » p. 99.
« Nous sommes sortis du théâtre dépaysés et heureux. Je me sentais bien, je savais maintenant que nous ne naissions pas fautifs mais beaux, et qu’il y avait de quoi se réjouir de cette beauté-là, il y avait de quoi faire la fête. Le monde, loin de nous attendre au tournant, nous attendait avec impatience. Nous n’étions pas nés bossus et il ne fallait pas nous redresser mais au contraire nous regarder grandir et grandir exaltés, incohérents, aventuriers maladroits, dévorés par l’impatience. Notre venue au monde était la Bonne Nouvelle » p. 101.
Pascal Wintzer, OFC




