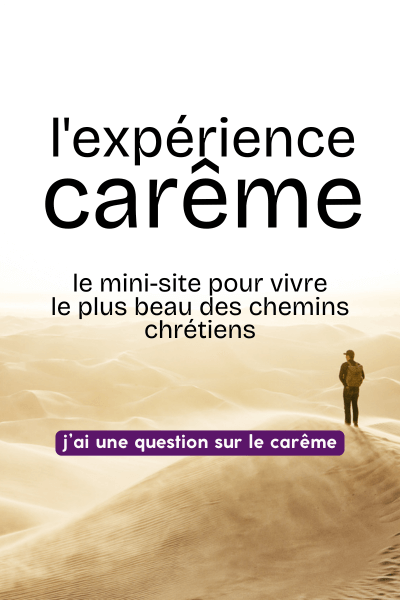« A l’assaut du réel » de Gérald Bronner (PUF, 2025)
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 24 septembre 2024, n°27 à propos de « A l’assaut du réel » de Gérald Bronner (PUF, 2025)
Gérard Bronner est sociologue, spécialiste des sciences cognitives. Une fiche de l’OFC lui a déjà été consacré. Le livre qu’il vient de publier veut alerter sur les dangers que court le réel et son respect. Selon certains courants de pensée, il n’existerait pas de réel, ou bien, s’il existe, quel qu’en soit le domaine, ce qui compte c’est que le désir de chacun puisse s’imposer et le modeler à sa guise.
Cette volonté d’avoir prise sur le réel a des origines récentes, en particulier ce qui s’est manifesté lors de Mai 68. « Les slogans de mai 68 – ‘’soyez réalistes, demandez l’impossible’’ – expriment tous la même chose ou presque : le réel n’a pas d’importance, seuls nos désirs priment, qui peuvent faire advenir un monde meilleur » p. 14. Mais Bronner souligne que cette forme de pensée a trouvé à s’exprimer de manière radicale dans le mouvement gnostique selon lequel le monde, tel qu’il est, œuvre du démiurge, doit être détruit pour que le monde « réel » puisse advenir. « Les gnostiques constituent la figure terminale de la pensée désirante, car le dernier obstacle à franchir est celui de nier radicalement l’existence de la réalité : non la contourner, non la corrompre, non l’hybrider avec des modèles imaginaires, non la ductuliser mais tout simplement : l’anéantir » p. 392. Le projet du livre se concentre cependant « sur la situation contemporaine des atteintes à la réalité » p. 13.
Sur cette question, comme sur d’autres, Hannah Arendt s’est montrée clairvoyante, annonçant ce qui se réalisera par la suite : « L’homme moderne a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence. En vouloir au fait même qu’il n’est pas son propre créateur, ni celui de l’univers. Dans ce ressentiment fondamental, il refuse de percevoir rime ni raison dans le monde donné. Toutes les lois simplement données à lui suscitent son ressentiment. Il pense ouvertement que tout est permis et croit secrètement que tout est possible » Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, p. 872 (cité p. 20).
Mai 68 a formulé, dans des slogans, cette volonté de dominer le réel ; les années qui suivent, dont les nôtres, manifestent que cette volonté est aujourd’hui à l’œuvre… le programme s’est réalisé. Gérald Bronner donne de nombreux exemples qui étayent sa thèse, pris dans le développement cognitif du petit enfant, la publicité, le développement technologique, spécialement dans le domaine de l’information. Il ne s’agit pas de comprendre ce livre comme dressant un tableau désespéré de notre temps, mais, pointant des risques, des dérives avérées et possibles, la lecture de d’A l’assaut du réel rend sensible à ceux-ci et stimule à des choix résolus.
Parmi les illustrations proposées par notre auteur, il y a la pensée éducative dominante en ce qu’elle a développé la pensée désirante, la volonté de plier le réel à ses désirs.
« L’éducation positive entérine le mouvement historique qui met l’enfant au centre de tout. Il convient d’être à son écoute à chaque instant, de décrypter ses besoins et d’y répondre à flux tendu. Le sujet est au cœur de notre propre enquête puisque la question qui nous occupe est de réfléchir à la façon dont nous régulons collectivement le désir. Il semble que l’enfant et son désir soit une sorte de primum mobile sacré pour les promoteurs de cette philosophie. L’éducation n’a plus pour objet de forger de caractère, les compétences et la personnalité des individus, mais de permettre de révéler le ‘’vrai moi’’ qui se logerait dans le corps de nos enfants » p. 95. « En affaiblissant les sanctions que le réel oppose au désir de l’enfant sous la forme affadie d’une négociation démocratique, elle insinue dès le plus jeune âge l’idée que le droit au bonheur est un impératif cardinal » p. 98.
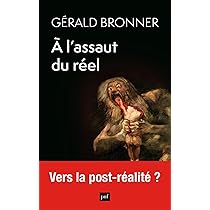
Le tableau de Goya choisi pour illustrer la couverture du livre exprime une des conséquences du triomphe de la pensée désirante. Puisque seul compte le désir personnel, toute référence au passé, et plus largement à ce que je ne maîtrise pas devient intolérable ; de même se projeter dans l’avenir n’est loisible qu’à la mesure où j’en demeure le maître. Il s’en suit que seul compte le présent, libéré de toute référence au passé et à l’avenir. Ainsi de Saturne qui émascula son père Uranus, coupant tout lien de dépendance, et dévorant ses propres enfants.
Lorsque le réel ou la vérité ne nous satisfont pas, il reste une chose à faire : nier le réel et créer une vérité indépendamment de toute objectivité. Bronner souligne qu’« en 2016, le dictionnaire d’Oxford fit du terme ‘’post-vérité’’ le mot de l’année. Non parce qu’il fut inventé cette année[1]là, mais parce que son usage avait augmenté de 2000% par rapport à 2015. Une inflation directement liée au référendum sur le Brexit au Royaume-Uni et à l’élection présidentielle aux États-Unis, qui vit Donald Trump l’emporter. Ces deux événements firent prendre conscience collectivement qu’il y avait dans les deux cas un problème avec l’expression de la vérité dans l’espace public » p. 255-256.
Le tableau ne serait pas complet sans référence aux écrans, réseaux et autre IA qui, désormais, permettent de « fabriquer » le réel, de le plier à aux désirs.
« La corruption du réel, par l’entremise de la dérégulation du marché cognitif, revêt aujourd’hui des atours inédits, et si puissants qu’elle offre peu à peu l’opportunité à chacun de vivre dans le confort d’un monde alternatif qui convient à ses désirs. C’est une façon particulièrement efficace de nous mettre à l’abri du réel et de faire valoir notre wishfull thinking que de transmuer les signes qu’il nous envoie en une langue qui travestit ses messages » p. 261.
« Sur Facebook, 1% des détenteurs de compte produisent 33% des posts émis […]. Sur toutes sortes de sujets : anti-vaccination, radicalité politique et conspirationnisme… sur chacun de ces thèmes, il est donc documenté qu’une minorité de profils exerce une forte influence dans la diffusion de fausses informations » p. 271. « L’idéologie transhumaniste tire ses racines de l’obsession californienne pour la technologie. On comprend sans mal comment cette passion technophile peut rejoindre les espoirs d’individus manifestant des troubles identitaires. Il reste que les deux communautés ont pour point commun de vouloir contrarier leur assignation biologique » p. 369.
Or, ceci n’en pas purement et simplement enfermé dans le domaine des idées, des imaginaires ; lorsque le réel, dans ce qu’il a de plus concret, doit et désormais peut devenir adaptable pour répondre aux attentes les plus diverses, en tout cas au désir de chacun, c’est la matière elle[1]même, entendons le vivant, que l’on va modeler selon son désir.
« L’idée que notre biologie puisse imposer certaine limite est perçue comme une menace pour l’idéal de transformation sociale. C’est pourquoi certains préfèrent penser que tout, y compris nos caractéristiques biologiques, est le produit d’une construction sociale. En étendant le champ du contingent et du malléable, ils augmentent les marges d’action pour remodeler le monde à leur guise […]. Ces courants de pensée commettent une confusion fondamentale entre l’être et le devoir-être. Car la réalité ne se laisse pas enfermer dans des catégories idéologiques : l’espèce humaine est un mélange indissociable de déterminismes biologiques et d’influences sociales. Nous sommes des êtres hybrides, façonnés à la fois par notre patrimoine génétique et par notre environnement » p. 326-327.
« La catégorie de gender fluid désigne l’angoisse très contemporaine d’être enfermé dans une catégorie sans pouvoir inventer son propre monde » p. 330-331.
Dans un monde où le réel est nié, voire fabriqué, c’est chacun qui se trouve confronté à un impératif profondément déstabilisant : lorsque tout peut être remis en cause, lorsque l’on peut se fabriquer une généalogie, un genre, lorsque l’on devient l’auteur de soi-même, comment ne pas être écrasé par de telles responsabilités qui font peser sur chacun un fardeau qu’il ne peut être que dans l’incapacité d’assumer et de réaliser.
« L’ouverture du possible met en crise notre système de décisions et d’actions. C’est quelque chose que nous avons tous expérimenté en réalité, ainsi au restaurant ou un menu trop généreux nous donnant envie de savoir ce que l’autre va prendre pour nous aider à choisir. Plus il y a d’opportunités, plus la crainte d’en perdre nous pétrifie » p. 363.
Pascal Wintzer, OFC
ca peut aussi vous intéresser
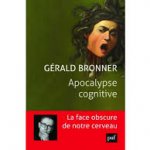
Gérald Bronner : « Apocalypse cognitive »
Fiche de l'Observatoire foi et Culture (OFC) du mercredi 24 avril 2021 à propos de l'ouvrage : "Que faire de notre temps de cerveau disponible ?"