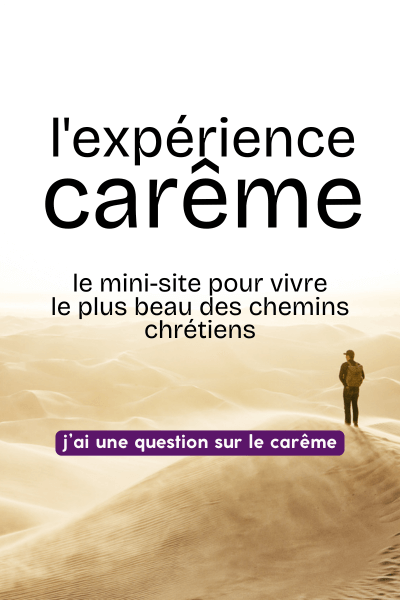« Vers la guerre ? La France face au réarmement du monde » de Sébastien Lecornu
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 08 janvier 2025, n°1 à propos de « Vers la guerre ? La France face au réarmement du monde » de Sébastien Lecornu (Plon)
Sébastien Lecornu est depuis le 20 mai 2022 ministre des Armées et des Anciens combattants. Il est né en 1986, a exercé des fonctions d’élu départemental dans l’Eure et municipal (maire de Vernon) ; il a été sénateur. Il a exercé des fonctions ministérielles : secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire ; ministre chargé des Collectivités territoriales ; ministre des Outre-mer. Selon les gouvernements, le ministre a pour titre ministre des Armées ou ministre de la Défense. En exergue des chapitres l’auteur cite le général de Gaulle ainsi que Pierre Mesmer (ministre des Armées de 1960 à 1969 donc pratiquement pendant presque toute la présidence de la République exercée par le général de Gaulle), mettant ainsi son action dans leur lignée.
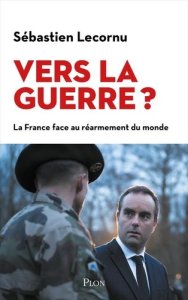 Ce livre comprend quatre parties. La première Notre armée se confond avec notre histoire nationale est consacrée à l’organisation de notre défense depuis 1945. Il y eut alors la prise de conscience des insuffisances en matériel ainsi qu’en organisation ayant conduit à la défaite de 1940. A cet égard, Sébastien Lecornu évoque sa dernière rencontre avec l’amiral Philippe de Gaulle : « Je vais bientôt mourir et il y a quelque chose que je ne m’explique toujours pas. Mais pourquoi a-t-on perdu en 1940 ? ». Il est aussi question, pour la période concernée, des guerres d’Indochine et d’Algérie, de la reconstruction de l’armée française, de sa réorganisation, et – bien sûr – des décisions et moyens concernant la dissuasion nucléaire mis en œuvre depuis les années cinquante. Le ministre partage les regrets des militaires que dans le cadre de la RGPP (révision générale des politiques publiques) les crédits de la défense aient souvent été la variable d’ajustement des lois de finances, notamment quand on a parlé dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, des dividendes de la paix. Concernant le service militaire, Sébastien Lecornu commente la décision de Jacques Chirac d’y mettre fin en février 1996 : les causes en étaient des raisons budgétaires et la prise de conscience que les conflits seraient l’affaire de militaires ayant une formation de qualité et non la levée en masse pratiquée dans le passé. Il est à noter que l’auteur écarte toute idée d’un rétablissement du service national, ne serait-ce qu’à cause des coûts de la construction d’infrastructures dédiées à l’accueil et l’entraînement des conscrits.
Ce livre comprend quatre parties. La première Notre armée se confond avec notre histoire nationale est consacrée à l’organisation de notre défense depuis 1945. Il y eut alors la prise de conscience des insuffisances en matériel ainsi qu’en organisation ayant conduit à la défaite de 1940. A cet égard, Sébastien Lecornu évoque sa dernière rencontre avec l’amiral Philippe de Gaulle : « Je vais bientôt mourir et il y a quelque chose que je ne m’explique toujours pas. Mais pourquoi a-t-on perdu en 1940 ? ». Il est aussi question, pour la période concernée, des guerres d’Indochine et d’Algérie, de la reconstruction de l’armée française, de sa réorganisation, et – bien sûr – des décisions et moyens concernant la dissuasion nucléaire mis en œuvre depuis les années cinquante. Le ministre partage les regrets des militaires que dans le cadre de la RGPP (révision générale des politiques publiques) les crédits de la défense aient souvent été la variable d’ajustement des lois de finances, notamment quand on a parlé dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, des dividendes de la paix. Concernant le service militaire, Sébastien Lecornu commente la décision de Jacques Chirac d’y mettre fin en février 1996 : les causes en étaient des raisons budgétaires et la prise de conscience que les conflits seraient l’affaire de militaires ayant une formation de qualité et non la levée en masse pratiquée dans le passé. Il est à noter que l’auteur écarte toute idée d’un rétablissement du service national, ne serait-ce qu’à cause des coûts de la construction d’infrastructures dédiées à l’accueil et l’entraînement des conscrits.
La deuxième partie Face à la réalité des menaces, les réponses qui s’imposent évoque la situation actuelle. La dissuasion reste la clé de voûte de défense de nos intérêts vitaux mais les menaces se diversifient. Ainsi elles ne proviennent pas toutes d’un Etat : il y a le terrorisme avec les attentats du Bataclan en novembre 2015, le cas des proxys (la guerre par procuration soit par un pays, soit par un groupe du type Wagner), la sécurité des routes maritimes mondiales… Au moment où nous écrivons ces lignes les médias signalent les coupures de deux câbles de télécommunication en mer Baltique et les actions des Houthis contre le trafic maritime en mer Rouge. Le ministre évoque la présence des forces militaires françaises Outre-Mer, les défis logistiques de fournitures de matériels et de renfort de personnels sur plusieurs dizaines de mil[1]liers de kilomètres. La militarisation de l’espace et le cybercombat, civil comme militaire, sont mentionnés avec l’évocation des attaques subies par des établissements hospitaliers vis-à-vis de leurs systèmes informatiques. La page consacrée à la Moldavie et à l’Arménie trouve son actualité quelques semaines après la propagande de l’Azerbaïdjan autour du dossier néo-calédonien et au moment où se termine la conférence de Bakou…
La troisième partie Sommes-nous prêts traite autant de l’état des bases de défense, longtemps délaissées pour des raisons budgétaires, que du renseignement, des industries d’armement et des interactions entre politique de défense et diplomatie. Si les marchés d’armement font partie de l’action diplomatique, ils contribuent aussi à limiter les coûts des matériels pour le budget de la Défense. Concernant le matériel, le numérique bouleverse les données de base : un drone coûtant 20000 ou 50000€ peut détruire un équipement d’une valeur sans commune mesure avec celle de l’engin destructeur. L’intelligence artificielle et l’informatique quantique constituent des ruptures dans la réflexion sur l’organisation de la défense. Ainsi, au sujet de la marine : ‘des essaims de drones, aériens ou marins, seront utilisés afin d’attaquer ou de protéger de plus grandes plateformes telles que les porte-avions, les porte-hélicoptères, les frégates, et seront dédiés à l’escorte d’avions de chasse ou de transport.’ D’une organisation homme-machine on passera à un couple machine-machines. Les progrès technologiques provoquent un changement radical dans les guerres modernes, c’est une des leçons du conflit en Ukraine.
La quatrième partie La défense nationale est une affaire politique rappelle l’articulation entre l’article 5 de la Constitution instituant le Président de la République chef des armées et l’article 21 faisant du Premier Ministre le responsable de la défense nationale. Le Parlement vote les crédits d’équipement et se tient informé de leur exécution. Progressivement les conseils de défense, tenus à l’Elysée, se sont élargis à d’autres questions de sécurité nationale (attentats, COVID). La diversité des sujets abordés par l’auteur couvre aussi bien la procédure de nomination des officiers généraux que la planification des équipements (objectif de 2% du PIB pour les dépenses militaires) ainsi que les enjeux résultant de la situation internationale ou la géopolitique dans le cadre du fonctionnement de l’OTAN et des relations entre les Etats-Unis et les autres pays de l’alliance.
Un sous-titre est la mort. Le ministre fait observer que l’ultime mission du soldat est de tuer avec en contrepartie le risque d’être tué. Il précise : ‘On ne prend pas la vie d’un militaire… il choisit de la donner pour son pays’. La mort au combat ne saurait être comparée à un accident du travail ; le militaire tombé au champ d’honneur n’est pas une victime mais un héros ayant rempli jusqu’au sacrifice ultime le contrat qu’il avait conclu avec la patrie. Sébastien Lecornu évoque, dans une France où il y a séparation de l’Eglise et de l’Etat, la mise en place de rites républicains rivalisant avec ceux des cultes (entretien des tombes par le Souvenir français – cérémonies aux monuments aux Morts, etc.). L’auteur ouvre sa conclusion par la phrase « Nous ne sommes plus en paix ». Il constate le manque d’effet de la diplomatie multilatérale, Nations-Unies en tête, et appelle à une prise de conscience du lecteur quant au danger de la guerre moderne, si différente de celles que nous avons connues, que nous risquons de pas y mettre les moyens nécessaires, financiers et moraux.
Antoine Virenque