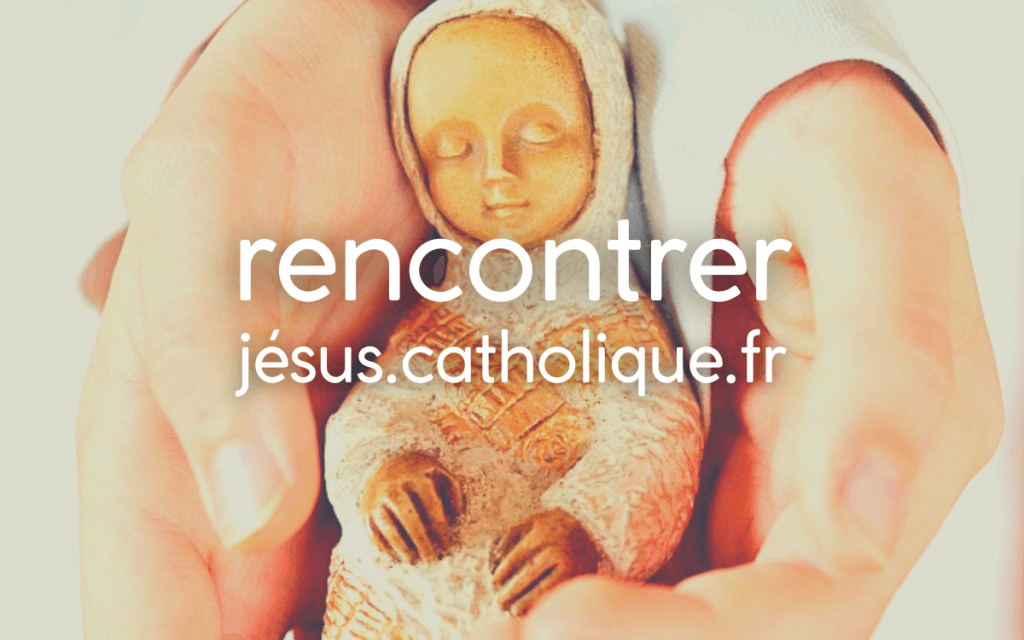Le sacrement des malades : précarité et liberté

Si l’homme est capable d’accomplir le mal, qui relève de sa conscience, de sa volonté et de sa liberté, il rencontre aussi des malheurs devant lesquels sa liberté n’est absolument pas concernée. Comment réagir devant le malheur dont nous ne sommes pas la cause ? Ce malheur, maladie ou accident, peut provoquer en nous des réactions contraires à la foi. Nous connaissons des gens qui ont quitté l’Église et sont partis révoltés parce qu’un membre de leur famille, un ami, était décédé dans un accident ou emporté par la maladie. À l’inverse, nous savons des malades enfouis dans une résignation et une passivité qui affligent aussi bien leur entourage que le corps médical.
Est-ce là des attitudes qui conviennent à un croyant ? La réponse se trouve dans ce sacrement, si peu connu, si mal pratiqué, qu’on appelait hier « l’extrême-onction », et qu’on appelle aujourd’hui, plus pudiquement, encore que la dénomination ne soit pas précise, « le sacrement des malades ». C’est le sacrement qui nous permet de réagir chrétiennement devant le malheur.
Disjoindre le péché du malheur
Malheureusement s’est répandu en Europe ce que l’historien Jacques Le Goff appelle « l’immobilisme angoissé du Moyen Âge » : c’est la hantise du péché qui a été première. Il en est résulté deux conséquences. La première fut l’addition de trois sacrements au moment où la vie est en péril : le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, le sacrement des malades et l’Eucharistie comme viatique. Comme ces sacrements étaient administrés au moment où la vie était en péril et que chacun ressentait l’angoisse de l’agonie, on a retardé de plus en plus la donation des sacrements. Jusqu’à retirer parfois au malade la capacité de répondre au sacrement et de faire que le sacrement, comme tout sacrement, le convertisse. C’est bien l’angoisse des derniers moments qui a fait transiter vers les ultimes secondes ces sacrements, dont le principal a pris le nom d’extrême-onction.
Seconde conséquence de cette position, l’opinion commune qui fait découler les malheurs du péché. D’où l’idée antique que si on pardonne le péché, normalement, la santé doit en résulter. Faire dépendre le malheur du péché, une réalité physique d’un mal moral, est le dernier avatar d’une explication quand l’intelligence bute sur l’incapacité à comprendre les causes du malheur. On doit affirmer clairement que l’ensemble de la Révélation biblique va à l’encontre de cette théorie. Le Christ lui-même, par trois fois dans l’Évangile, va disjoindre le péché du malheur : quand la tour de Siloé s’abat et écrase des gens (Lc 13, 4), quand Jésus dit : « On ne peut pas faire remonter le malheur de l’exécution des Samaritains à un péché qu’ils auraient commis » (Lc 13, 1-2), et enfin dans la parabole de l’aveugle-né (Jn 9, 3).
Au sujet de la Création, il n’est écrit nulle part dans la Bible que la Création fut parfaite. Elle est dite bonne, c’est déjà beaucoup. Si la Création était parfaite au départ nous n’aurions plus qu’à la subir. L’exercice de notre liberté serait réduit à l’acceptation pure et simple d’un idéal auquel nous n’aurions point participé. Pour un être libre, la perfection est à la fois donnée et accomplie par sa liberté. C’est tout le passage de l’homme image de Dieu à la ressemblance de Dieu, d’une Création bonne à l’état du Royaume qui, lui, sera parfait. L’histoire est le lieu où nous collaborons, par grâce, à la venue du Royaume.
La vulnérabilité m’apprend la confiance
Au point de départ, la précarité est inscrite dans mon corps. Je grandis, je vieillis, je décline et je meurs. Mon corps est l’endroit où ma finitude est inscrite, où je la constate ne serait-ce que par mon vieillissement, ma fatigue, la maladie, ma vulnérabilité… Ce corps vulnérable devient l’endroit d’un choix :
– Ou bien la vulnérabilité m’apprend la confiance. Parce que je suis précaire, ma raison de vie n’est pas en moi et ne peut-être que dans un autre, l’Esprit Créateur qui pénètre au fond de mes entrailles.
– Ou bien, au contraire, je vais refuser par résignation ou par révolte cette précarité. À ce moment là, l’absurde de la vie s’empare de moi pour soulever en moi le rejet de la foi.
C’est pourquoi le moment du face-à-face avec la mort, le moment de la maladie grave, est un moment dangereux pour la foi.
Comment vais-je réagir ? Il ne s’agit pas d’avoir peur ou de ne pas avoir peur. La peur est un sentiment qui se commande mal. On peut faire confiance et avoir peur. Il s’agit d’autre chose de plus profond que la peur ou l’angoisse : au moment où je touche ma précarité, ma vulnérabilité, est-ce que je vais être capable, dans un sursaut, de faire confiance à Dieu ? Nous ne pouvons pas le dire tout seul. Si nous le disons tout seul, ce serait peut-être encore un dernier acte de gloriole. C’est pourquoi il faut que le Christ, qui a connu notre précarité, notre vulnérabilité, notre non-nécessité humaine, vienne en nous, nous donner son acte d’offrande.
Le sacrement des malades est donc ce sacrement, quand la vie est en péril, où le Christ nous apprend à vivre son agonie, pour dire : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » C’est un acte éminemment trinitaire. Il n’a de sens que si je m’abandonne, comme l’Esprit du Fils le remet au Père et comme le Père donne l’Esprit à son Fils. C’est l’acte de foi et d’espérance le plus radical qu’une créature puisse faire envers le Père qui l’a créée. « Père, entre tes mains, je me remets tout entier. »
Mgr Albert Rouet
Archevêque de Poitiers
Article paru dans Catholiques en France, n°13 – Février 2006