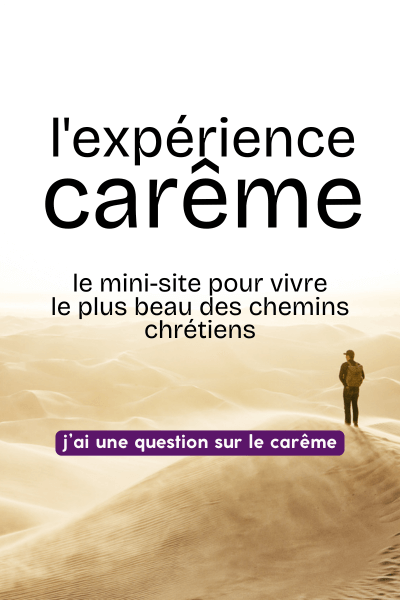Rapport 2025 de l’AED : la liberté religieuse n’est pas un privilège, mais un droit fondamental

L’Aide à l’Église en Détresse (AED) a publié son rapport 2025 sur la liberté religieuse dans le monde. Ce document de référence dresse un état des lieux préoccupant des persécutions et discriminations subies par les croyants, tous cultes confondus, dans 196 pays.
Le rapport 2025 de l’Aide à l’Église en détresse (AED) dresse un constat particulièrement préoccupant sur l’état de la liberté religieuse dans le monde. Publié le 21 octobre 2025, il révèle que près des deux tiers de l’humanité — soit plus de 5,4 milliards de personnes réparties dans 62 pays — vivent dans des nations où ce droit fondamental est bafoué.
Fondée en 1947, l’AED publie ce rapport depuis vingt-cinq ans. Ce document de référence rappelle que chaque individu a le droit à la liberté de religion, y compris celui de ne pas croire, mais aussi à la possibilité de vivre sa foi en privé comme en public. « Lorsque ce mode de vie n’interfère pas avec le droit d’autrui ou l’ordre public, il devient une contribution positive à la société dans son ensemble », souligne Amélie Berthelin, responsable de l’information de l’AED.
Unique en son genre, cette étude est la seule enquête mondiale produite par une organisation non gouvernementale (ONG) qui couvre toutes les religions. Publiée en six langues, elle analyse la période de janvier 2023 à décembre 2024 dans 196 pays. Pour chacun, quatre volets sont détaillés : les données statistiques, le cadre juridique et constitutionnel relatif à la liberté religieuse, les incidents recensés au cours des deux dernières années et enfin les perspectives d’évolution de ce droit. Ce travail s’appuie aussi sur l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui consacre la liberté religieuse comme un droit universel.
les menaces
-
-
- 24 pays connaissent une persécution grave, marquée par une répression sévère des croyants (Chine, Corée du Nord, Inde, Nigeria, Nicaragua, etc.), concernant environ 4,1 milliards de personnes.« Ces persécutions se déroulent bien souvent dans un climat d’impunité », souligne Benoît Blanpré, directeur de l’AED. « Leur nature varie selon les contextes : dans certains pays comme la Chine ou la Corée du Nord, elles relèvent d’un contrôle étatique autoritaire. Ailleurs, au Burkina Faso, au Mozambique ou en République démocratique du Congo, elles découlent de l’extrémisme religieux, l’un des principaux moteurs de la persécution dans le monde. Au Nigeria et au Pakistan, celles-ci résultent d’une combinaison entre autoritarisme politique et fanatisme religieux. En Inde ou en Birmanie, elles mêlent autoritarisme et nationalisme ethno-religieux. »
- 38 pays présentent des formes de discrimination religieuse, touchant plus de 1,3 milliard d’habitants. « C’est une menace légale, parfois plus discrète, mais tout aussi nuisible. Dans ces États, on observe des restrictions au culte, la censure de certains groupes religieux, l’interdiction de l’enseignement confessionnel, des obstacles bureaucratiques ou encore une inégalité juridique entre citoyens selon leur religion, qui entraîne une discrimination sociale », ajoute-t-il.
-
le rapport remis au pape Léon XIV
Dans 62 pays du monde, la liberté religieuse est gravement menacée. Cela concerne environ 5,4 milliards de personnes, soit près des deux tiers de la population mondiale exposée à la persécution ou à la discrimination en raison de sa foi. « Nous réaffirmons que la liberté religieuse est un droit fondamental, au fondement même de tous les droits humains. Porter atteinte à la liberté religieuse, c’est fragiliser l’ensemble des autres droits. Il est essentiel de dénoncer tous les lieux où ces atteintes se produisent. »
Le pape Léon XIV a reçu il y a quelques jours au Vatican le rapport sur la liberté religieuse. Il a remercié l’équipe pour son travail, rappelant que la liberté de religion constitue le fondement même de la paix mondiale. « Sans liberté, il ne peut y avoir de véritable dialogue entre les confessions, et donc pas de paix », a conclu le directeur du rapport.
Chaque être humain porte dans son cœur une aspiration profonde à la vérité, au sens et à la communion avec les autres et avec Dieu. Cette aspiration naît des profondeurs de notre être. C’est pourquoi le droit à la liberté religieuse n’est pas facultatif mais essentiel.
extrait du discours du pape Léon XIV à la délégation de l’AED,
le 10 octobre 2025
ça peut aussi vous intéresser

« Persécutés et oubliés ? », le rapport annuel de l’Aide à l’Église en détresse sur la situation des chrétiens opprimés pour leur foi
L'Aide à l’Église en détresse (AED) a publié le 22 octobre 2024 le rapport "Persécutés et oubliés ? ". L'étude réalisée dans dix-huit pays dans le monde alerte sur les violations de la liberté religieuse à l'encontre des[...]