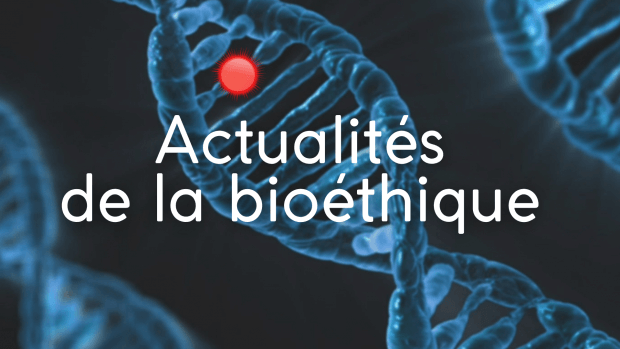Église et bioéthique : Mgr Pontier réaffirme devant le CCNE la valeur de toute personne
Mgr Georges Pontier, Archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, accompagné du Père Bruno Saintôt, sj. a été reçu, jeudi 26 avril, par le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) dans le cadre des auditions sur la révision des lois de bioéthique. Cette rencontre a été l’occasion de rappeler les points suivants :
 Prendre soin les uns des autres en considérant l’autre dans sa dimension transcendante est la perspective dans laquelle je me placerai. Cette perspective articule la valeur unique et absolue de toute personne avec le projet d’une société hospitalière. En effet, « l’Église qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d’aucune manière avec la communauté politique et n’est liée à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. »[1] Cela passe par une réflexion éthique sur laquelle je m’arrêterai un instant.
Prendre soin les uns des autres en considérant l’autre dans sa dimension transcendante est la perspective dans laquelle je me placerai. Cette perspective articule la valeur unique et absolue de toute personne avec le projet d’une société hospitalière. En effet, « l’Église qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d’aucune manière avec la communauté politique et n’est liée à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. »[1] Cela passe par une réflexion éthique sur laquelle je m’arrêterai un instant.
1. L’éthique
L’éthique promeut un discours de raison qui, selon Paul Ricœur, vise à trouver ensemble le bien de la personne, le bien du groupe auquel celle-ci appartient et le bien des institutions, c’est-à-dire leur justice. Elle le fait à partir d’une vision anthropologique qui ne se réduit pas à la sociologie ni aux sciences humaines. La recherche d’une signification qui fasse sens pour tout homme et pour tout l’homme guide les actions de l’homme afin que celles-ci soient bienfaisantes. Cette signification induit des limites en-deçà desquelles l’action est malfaisante.
L’éthique s’élabore donc en fonction du triple bien visé ET des limites énoncées comme des interdits fondateurs des civilisations. Elle se traduit dans notre droit par le principe de l’indisponibilité du corps humain, c’est-à-dire en terme juridique de la « personne ». Ici, la summa divisio dans notre droit est essentielle. Elle induit le principe de non marchandisation (ou de gratuité) qui s’applique à tout élément du corps humain, quel qu’il soit. Ce principe devrait être davantage mis en lumière pour se garder des tentations du marché, ce qui risquerait d’arriver dans le cas où l’ouverture de la PMA à toutes les femmes serait légalisée étant donnée la pénurie des gamètes disponibles.
D’autres situations montrent que ce principe est un guide éthique sûr pour préserver la « personne ». Faut-il par exemple parler d’indemnisation pour don d’ovocytes ou d’indemnisation pour les démarches nécessaires au don d’ovocytes ? Faut-il accepter les contrats qui visent à considérer l’enfant comme un bien monnayable, ou la femme avec son corps comme un bien utilisable ?
Dans sa réflexion sur la nouvelle responsabilité suscitée par l’utilisation des technologies, Hans Jonas formule un impératif : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre »[2]2. La « révolution culturelle »[3], que laisse deviner l’avènement de « l’intelligence artificielle », appelle un surcroît de réflexion pour penser cette « permanence » comme cela s’est fait à chaque changement civilisationnel dans l’histoire. Sans doute est-il nécessaire et urgent de réfléchir à une conception partagée d’une « vie authentiquement humaine ».
Par exemple, est-elle « authentiquement humaine » en étant augmentée grâce à la technique génétique ? En étant organisée sans pouvoir avoir de père ? Le Code civil (16-4) garantit la « préservation de l’espèce humaine » et la Convention d’Oviedo affirme « que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures » (Préambule, alinéa 12). Notre droit nous rend ainsi attentifs à la « permanence d’une vie authentiquement humaine ». Il nous invite à la prudence.
L’éthique se préoccupe de discerner la juste limite aux désirs individuels en les resituant dans la relation et l’interdépendance qui caractérisent l’être humain puisque sa dimension sociale lui est essentielle. Le désir ne concerne pas seulement l’individu qui désire, mais la société tout entière, et ceci d’autant plus que cet individu demande à la société de satisfaire son désir. Le CCNE ne devrait-il pas réfléchir à une éthique de la liberté à partir d’une éthique du consentement à la limite et d’une éthique de la responsabilité qui engage vis-à-vis d’autrui ? La liberté n’est jamais purement individuelle car elle est celle d’un être humain en relation.
L’éthique se doit donc d’intégrer le désir en lui donnant un sens de telle sorte qu’elle ne soit pas une liste de réponses diverses à des demandes individuelles grâce aux pouvoirs des techniques. Elle a une visée éducative en faisant œuvre de raison, ce qui permet d’orienter ces désirs et d’utiliser les techniques selon la sagesse, c’est-à-dire en étant au service de la personne en sa totalité et de toutes les personnes. Ici, intervient la justice : l’institution est juste quand elle vise le « bien commun » et non les cas particuliers.
L’homme subit une tentation technologique qui le pousse à vouloir tout maîtriser en utilisant tous les pouvoirs que lui procure la technique. Ses désirs de maîtrise ou de domination se traduisent en « droits » dont la liste s’agrandit indéfiniment (par exemple, la résolution de l’Assemblée nationale qui appelle l’IVG un « droit fondamental », ce qui est un non-sens juridique puisque l’IVG continue à être définie en dérogation à l’article 16 du code civil). La volonté, le plus souvent non consciente, de tout dominer le conduit dans l’illusion vis-à-vis de lui-même. Il est dans une fuite en avant selon la logique de l’auto-justification qui l’oblige à appeler « droits » ses désirs, fuite en avant dont on ne voit pas l’issue puisque les possibilités techniques exacerbent les désirs et rendent possible leur satisfaction immédiate.
Le CCNE n’aurait-il pas à réfléchir sur la notion de « droits de l’homme » et de « droit fondamental », en les distinguant du droit positif et des demandes sociétales exprimées en termes de « droits » ?
Enfin, l’éthique est située dans une histoire et une actualité, ici celles de la France, en Europe et dans le contexte de la mondialisation. L’histoire nous instruit sur la provenance de certains concepts qui ont force symbolique dans notre pays. Les mettre en évidence de façon claire et pédagogique contribue à élaborer une éthique qui soit éducative de nos contemporains en visant le « bien commun », c’est-à-dire les conditions qui permettent à chacun et à chaque groupe de trouver plus facilement leur épanouissement vers le bonheur. Pour cela, selon la pensée de Jürgen Habermas[4], la laïcité n’interdit pas d’avoir recours à des mythes issus de la religion qui peuvent avoir force de sens dans le langage séculier adapté à une société plurielle en quête de sens pour tous. Par exemple, l’interdit « tu ne tueras pas » ou le récit du « bon Samaritain » expriment une compréhension du vivre ensemble humain dans une société.
L’éthique s’appuie sur une « loi non écrite » qui demeure inscrite au fond de l’être humain, quelle que soit sa culture ou sa tradition religieuse. Cette « loi » devrait être mise au jour comme des points de convergence entre diverses traditions de pensée. Cette mise au jour est nécessaire pour considérer l’être humain dans sa vérité et sa totalité. Pour cela, plus que la discussion, le « dialogue » est recherche menée ensemble pour exprimer rationnellement cette « loi non écrite » sans qu’aucun partenaire prétende la posséder ou la confisquer[5]. Il est éclairé par la recherche désintéressée de la vérité, c’est-à-dire du juste bien de la personne, de toutes les personnes et des institutions.
De multiples regards convergent sur l’être humain pour en attester la transcendance : l’être humain se reçoit, infiniment plus qu’il ne se domine. On l’a dit : l’homme passe infiniment l’homme. Le langage commun pour formuler cette transcendance ne peut faire l’économie d’une recherche dans le « dialogue » de la vérité des termes employés. L’écoute attentive des personnes en précarité contribue à ouvrir les yeux sur cette transcendance.
Grâce au « dialogue », cette « loi » apparaît avec la force d’une transcendance ou d’un « visage », pour reprendre l’expression d’Emmanuel Lévinas. Ne pas la recevoir (ou refuser de la recevoir) en raison des désirs exacerbés, c’est s’obliger à masquer ce « visage » en modifiant les énoncés de la loi afin que ceux-ci lui paraissent adéquats à ce « visage » bien que de façon fausse ou artificielle.
Par exemple, on passe des « mères porteuses » (ce qui contredit le non-utilitarisme de Kant) à l’altruisme signifié par la « gestation pour autrui » ; on va jusqu’à écrire, dans le rapport du CESE[6], que sur l’acte de décès provoqué par une « sédation explicitement létale » (ce qui déjà contredit le sens de l’expression « sédation » dans le langage des soins), il sera écrit « décès naturel »[7]. Comment pourrait-il être éthique de masquer la véritable nature d’un acte ? Comment le droit pourrait-il dire ce qui est juste s’il qualifie explicitement de façon mensongère la nature d’un acte ?
2. Le principe de précaution
La loi du 7 juillet 2011 a fait preuve de « prudence »[8]. Le temps de l’éthique est plus long que celui de la science. La précipitation n’est jamais bonne conseillère, surtout quand elle provient de pressions sociétales ou politiques qui somment l’éthique de se prononcer. La vertu de « prudence » a ses lettres de noblesse dans le discours éthique. Elle est une vertu du politique. Elle devrait être mise en exergue par la CCNE grâce à une réflexion approfondie sur la « prudence » dans le vaste patrimoine philosophique des différentes cultures.
Cette « prudence » vis-à-vis d’une avancée scientifique est en elle-même appelée par une autre science. Par exemple, l’homme augmenté promu par la science informatique est en vérité un « homme simplifié »[9] et faible. La science biologique montre que la force de l’homme réside dans sa vulnérabilité biologique puisque l’épigénétique le rend capable de s’adapter aux situations changeantes qu’il rencontre dans son environnement[10].
Aujourd’hui, devant les avancées des techniques et face aux désirs des scientifiques, il semble urgent d’être « prudent ». Le principe de précaution – qui est constitutionnel pour l’environnement – devrait rentrer dans le champ de la bioéthique. Il exigerait une concertation permanente entre les différentes branches scientifiques afin que les savoirs ne demeurent pas éparpillés et juxtaposés comme des spécialités, mais se rencontrent et s’équilibrent mutuellement dans une sorte d’écosystème des savoirs, qui approcherait plus adéquatement de ce qu’est l’être humain avec son désir de bonheur, car c’est lui le sujet et l’objet véritables de l’éthique.
Ce principe de précaution oblige à des études d’impact sérieuses avant d’entreprendre tout changement de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 et de la loi sur la fin de vie du 2 février 2016. Or, par exemple, aucune étude sérieuse sur les enfants nés par dons de gamètes depuis les années 80 n’a été faite. Pourtant il semble bien que la vraie question ne soit pas celle de l’anonymat qui a été mise en place de façon très pragmatique dès les années 1970 pour devenir un principe législatif en 1994, mais plutôt celle du don de gamètes. On a réfléchi sur le principe de l’anonymat pour le préserver à chaque révision de la loi. Mais on n’a jamais vraiment réfléchi sur l’éthique du don de gamètes à la lumière de la considération « primordiale » de l’intérêt de l’enfant. Cette réflexion pourrait être favorisée par la comparaison avec d’autres pays. Par exemple, le législateur italien a procédé à l’inverse : le don de gamètes lui a semblé problématique jusqu’en 2015 et il n’a pas réfléchi à l’anonymat.
Au titre du principe de précaution et de la considération « primordiale » de l’intérêt de l’enfant, le CCNE devrait se pencher sur l’éthique du don de gamètes en raison de trois circonstances majeures : les banques de données d’analyses génétiques permettent aujourd’hui de retrouver plus facilement le père biologique ; la biologie montre que le lien gestationnel ne peut être passé par pertes et profits dans la construction de l’identité de l’enfant à naître et né ; les logiciels d’« intelligence artificielle » utilisés pour le tri des gamètes ou des embryons vont imposer leur « sélection » selon l’algorithme choisi, au moment du choix des gamètes ou de l’embryon à implanter.
3. Le droit de l’enfant
La Convention internationale des droits de l’enfant stipule que la considération de l’intérêt de l’enfant est « primordiale » (Article 3, §1). Il s’agit donc de faire passer cet intérêt de l’enfant avant toute autre considération. Face à un conflit de droits, c’est le droit de l’enfant qui prime. Le CCNE a justement précisé que le « droit à l’enfant » n’existait pas, mais il serait urgent de fonder par l’éthique cette primauté de l’intérêt et du droit de l’enfant.
Le CCNE ne pourrait-il pas s’emparer de cet article de la Convention pour en approfondir le sens et en préciser les conséquences, puisque cette Convention s’impose aux législateurs français ?
Faire passer le droit des adultes avant celui de l’enfant est donc en soi une injustice. Il est contraire à l’éthique de promouvoir une institution injuste. Cette injustice se manifeste de plusieurs manières : décider entre adultes qu’un enfant non encore conçu ne pourra pas connaître l’origine biologique de son père, ou bien sera sans père ou sans mère, tandis que d’autres enfants auront père et mère. Comme le souligne Platon, l’injustice est une aporie de l’esprit humain. Créer une telle injustice ne peut qu’engendrer de la violence à plus ou moins longue échéance.
L’usage non raisonné du principe de non-discrimination est tellement prégnant que la création délibérée d’enfants sans père sera automatiquement suivie de la création délibérée d’enfants sans mère, puisque l’autorisation donnée à un couple de femmes d’avoir un enfant aura pour conséquence la « légitime » demande des couples d’hommes d’avoir la même autorisation.
Le CCNE ne devrait-il pas réfléchir à ce principe de non-discrimination (qui en soi a une faible portée éthique car il ne dit pas d’emblée le bien juste) en élaborant une réflexion éthique sur l’égalité : ce qui est différent ne constitue pas une inégalité, comme l’a statué la Cour européenne des droits de l’homme vis-à-vis d’une requête d’un couple de femmes quand cette Cour a précisé que la position de ce couple n’était pas identique à un couple hétérosexuel et qu’à ce titre il ne pouvait prétendre être traité comme le couple hétérosexuel[11].
Certains États aux États Unis ont imaginé que la convention de mères porteuses établisse sous forme de contrat que les parents d’intention sont effectivement et de plein droit les parents effectifs de l’enfant qui naîtra de la mère porteuse, avant même que l’enfant naisse : cela signifie que, selon ces contrats, l’état civil américain efface totalement l’existence de la mère porteuse, c’est-à-dire de la femme qui accouche, qui, selon notre droit, est la mère.
Au moment de l’inscription à l’état civil français, que fera l’État français s’il s’agit d’adultes français revenant en France avec « leur » enfant ? Ne sera-t-il pas obligé de consacrer l’absence totale de la mère ? Quelle serait la valeur éthique d’un tel effacement par l’État ?
Il faudrait réfléchir à ce paradoxe étonnant : l’autonomie du désir est tellement revendiquée comme un « droit » par l’homme ou par la femme qu’elle finit par exclure une figure fondamentale de l’existence : le père ou la mère. Or, l’être humain sexué est précisément vulnérable en tant qu’il vit l’incomplétude comme le lui montre le fait même d’être sexué. L’autonomie n’est juste que quand elle est relationnelle, comme nous l’avons écrit[12].
Un des piliers de la loi de bioéthique est la gratuité au sens du prix à payer. Comment imaginer que cette gratuité pour le don de gamètes puisse se maintenir en ouvrant la PMA à toutes les femmes ? On ouvrirait ainsi la procréation au marché. Comment arriver à penser rationnellement que le don de la vie humaine ait un prix monnayable ?
Comment penser que l’être humain dès sa conception n’est pas un « bien marchand » alors que le prix à payer pour le concevoir est livré aux lois du marché, même de façon encadrée ? Ceux qui penseront seront-ils des adultes qui admettront le principe kantien selon lequel l’homme ne peut jamais être utilisé comme un moyen mais toujours être considéré comme une fin en soi ? Comment appliqueront-ils ce raisonnement à l’ensemble des êtres humains, c’est-à-dire aux enfants désirés qui seront conçus grâce aux lois du marché, sans parler de l’exploitation en raison d’injustices diverses des contrats ?
Ces questions sont trop graves pour que le principe de précaution ne soit pas mis en œuvre juridiquement dans les prochaines lois de bioéthique.
4. Le critère de la violence
Emmanuel Kant nous rappelle que la personne ne peut jamais être utilisée comme un moyen mais toujours comme une fin, en raison de sa « dignité » qui lui est intrinsèque, inaliénable et inviolable. Ainsi, ni l’utilitarisme ni le conséquentialisme ne peuvent suffire à élaborer une éthique du respect de l’être humain en vue de préserver une « vie authentiquement humaine ». A la lumière de ce principe éthique intrinsèque, il est possible de discerner l’argument éthique contingent mis en œuvre dans l’avis 126 du CCNE.
Cet avis met en œuvre une distinction pour discerner sur la GPA et sur l’ouverture de la PMA aux femmes : la violence et le risque de violence. Quand il y a violence, alors il faut interdire par la loi. C’est le cas pour la GPA. Quand il y a risque de violence, alors il faut encadrer par la loi. C’est le cas pour l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. Ce principe paraît arbitraire.
En effet, il n’est pas assuré que faire naître un enfant sans père soit seulement un risque de violence, ni que la naissance par le procédé des « mères porteuses » soit toujours une violence.
Si on se place du côté du droit de l’enfant, alors il y a violence dans les deux cas : pour la GPA, c’est une violence pour l’enfant de subir l’abandon de la femme avec laquelle il est lié par le lien gestationnel ; pour la PMA, c’est une violence de naître sans lignée paternelle, sans parler de l’impossibilité de connaître l’origine biologique.
Il n’est pas éthique de réfléchir à partir de cette distinction entre violence et risque de violence, car ces deux réalités sont contingentes et ne s’appuient pas sur des repères anthropologiques stables.
L’Avis 126 met en lumière des « points de butée ». Mais il ne s’efforce pas de les résoudre par la réflexion éthique, comme si ces « points de butée » étaient des impasses sur le chemin rationnel. Plusieurs ont relevé l’incohérence de cet Avis dans son deuxième chapitre : listant des contradictions mises en lumière par l’Avis, celui-ci estime quand même que l’ouverture de la PMA à toutes les femmes est un bien, moyennant un encadrement.
L’éthique peut-elle se satisfaire de ces contradictions majeures ? Si elle assume certaines tensions, l’éthique refuse les contradictions internes majeures car la raison est guidée par le principe de non-contradiction. Pour cela, devant les contradictions de droits individuels, la protection du plus vulnérable doit être « primordiale », selon l’adjectif de la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant.
5. La médecine et la solidarité sociale
Le serment d’Hippocrate demeure une norme déontologique. Est-elle pertinente, oui ou non ? Si oui, ne faut-il pas en tirer toutes les conséquences ? À l’occasion de son dernier avis, le CESE a écrit que ce serment pourrait être modifié. Est-il alors juste de demander à la médecine d’accomplir des actes qui ne soient pas thérapeutiques et qui veulent répondre à des désirs transformés en « droits » ? Si le serment d’Hippocrate cesse d’être la norme déontologique de la médecine, il y aurait un basculement sévère dans notre société. Quelle serait alors la norme déontologique de la médecine, dans la variété de ses professionnels et de ses disciplines ?
Actuellement, la loi du 7 juillet 2011 a été prudente en gardant la visée thérapeutique à toute utilisation des techniques de procréation. Si cette visée ne guide plus le législateur, quelle autre visée pourra-t-il se donner ? Ce serait sans doute la « demande sociétale », comme cela est écrit. Mais alors, l’éthique serait-elle sommée de se taire et le CCNE aurait-il encore une raison d’être sinon de proposer un encadrement à toute demande sociétale. Mais qui ou quelle réflexion guiderait cet encadrement ? Et qu’est-ce qu’une « demande sociétale » ? Comment la définir objectivement ? Suffit-il d’une pétition signée par 227.000 citoyens (ce fut le cas pour la demande de légalisation de l’aide médicale à mourir faite au CESE) pour qu’elle exprime une « demande sociétale » ? Quand le CCNE se saisit de « demandes sociétales », a-t-il des critères objectifs ?
La médecine a une responsabilité éthique spécifique. Il est essentiel que la société reconnaisse le rôle des professionnels de santé, parce qu’elle leur confie ses membres malades. La médecine est « gardienne du seuil d’humanité », selon la pensée de Claude Bruaire[13], car c’est bien aux professionnels de santé qu’est confié l’être humain dans ses plus extrêmes vulnérabilités, l’être humain qui manifeste ainsi l’essence même de ce qu’il est : vulnérable et relationnel.
Il est nécessaire d’honorer le rôle de la médecine : « gardienne », ce qui est aussi beau que nécessaire. Si la médecine n’a plus cette mission, qui, dans notre société, sera le gardien de l’humanité ? Le récit Biblique évoque avec une force dramatique ce rôle de l’homme comme « gardien de son frère ». Le récit du « bon Samaritain » en est une illustration éloquente. Il est essentiel que la médecine se voie confier ce rôle par la société, c’est-à-dire par le législateur. L’Église soutiendra toujours la vocation d’être « gardien de son frère ».
N’est-ce pas ce qu’a voulu faire la Suisse en confiant à des associations la charge d’assister les personnes dans leur suicide, et non à la médecine ? Cela pose un problème grave : la société se voit confier par le législateur la charge de s’aider ensemble à provoquer la mort, ce qui manifeste que le désir individuel devient un acte social[14]. Quelle est donc alors la signification de la société, sinon celle de la « désolation » ?
Il est alors nécessaire de s’interroger sur la solidarité sociale mise en œuvre dans notre pays pour la santé en considérant les priorités de santé et la médecine prédictive avec ses conséquences dans la procréation.
- a) Les priorités de santé
Les « biens communs » de santé, c’est-à-dire les ressources nécessairement partagées de santé, ont besoin d’une régulation démocratique selon des critères connus et approuvés puisque les ressources médicales et économiques ne sont pas indéfiniment extensibles. Établir des priorités, c’est évaluer des souffrances plus grandes ou des nécessités vitales et sociales plus urgentes. Si nous refusons de faire de ces choix des enjeux démocratiques, nous ne saurons pas réguler les dépenses de santé. Nous ne pourrons pas, par exemple, limiter l’usage de médicaments innovants et très chers au profit d’urgences de santé relevant des « biens communs » de santé comme les soins de base et l’accompagnement des personnes âgées. Nous serons fascinés par la médecine de performance et nous délaisserons l’humble et nécessaire médecine des soins de base et de l’accompagnement humanisant. Nous réclamerons pour nous-mêmes les soins les plus coûteux et nous serons incapables de consentir à limiter cette demande en considérant le « bien du ‘nous-tous’ ». Qu’est-ce qui empêcherait de faire de ces nécessaires arbitrages une « chose publique » de telle sorte que l’institution de santé soit juste pour tous ?
- b) Le rapport à l’utilisation des techniques de prédiction médicale
La médecine prédictive appuyée sur des analyses génétiques est pleine de promesses. Mais que ferons-nous des prédictions données par les tests génétiques s’ils sont en vente libre et si leur interprétation n’est pas régulée par de véritables compétences médicales dans le dialogue avec les patients ? Le désir de savoir et de prévoir nous conduira-t-il à généraliser également les tests préconceptionnels pour anticiper de possibles maladies chez les enfants ? Et que faire si l’intelligence artificielle vient opérer elle-même la sélection en déchargeant en apparence la société et les médecins de leur responsabilité ?
Les sociétés américaines qui commercialisent des tests génétiques sur Internet (par exemple 23andMe) prennent appui sur nos désirs de savoir mais que ferons-nous de ce savoir s’il n’est pas accompagné par des possibilités thérapeutiques et des projets de soin ? Que ferons-nous de probabilités de déclenchement de telle ou telle maladie ? Ces probabilités nous conduiront-elles à changer de style de vie ou à sombrer dans des formes de désespoir ? Qui pourra accompagner ces prédictions qui apparaîtront à la plupart comme de nouveaux oracles déterminant l’avenir[15] ? Qui aura intérêt à utiliser ces désirs de savoir et ces angoisses collectives et pour quels buts ?
Il sera important de pouvoir garder les critères de la validation médicale des tests (utilité, fiabilité, thérapeutique disponible), de l’annonce médicale des résultats et de l’accompagnement médical qui la suivra. Sinon, qui prendra en charge les angoisses et les désespoirs des personnes ? Qui sera capable de les replacer dans la justesse du savoir médical et dans l’ajustement du dialogue ? Comment maintenir le « pacte de confiance » (Paul Ricœur) inhérent à l’éthique du soin ?
- c) Le rapport à la définition collective des vies acceptables
La procréation est devenue un enjeu éthique et politique important parce qu’elle devient, par les moyens des tests de dépistage et de diagnostic, une manière de sélectionner préalablement des personnes. La sélection des personnes à naître ne résulte pas uniquement de conjonctions de décisions personnelles ; elle est un acte politique puisque les actes sont accomplis avec l’appui des institutions médicales dont les pratiques sont régulées par la loi démocratique. La sélection anténatale appuyée sur des dispositifs contrôlés par l’institution démocratique est le premier acte de la formation démocratique du citoyen. Comment donc ne pas y voir un enjeu démocratique ?
Certes, il y a du tragique dans certains cas de diagnostic de maladies très graves, et il faut l’assumer comme tel, mais l’extension prévisible des critères de sélection pose un problème politique majeur.
Les tests génétiques et les techniques de dépistage et de diagnostic doivent rester au service du bien des personnes elles-mêmes et non pas de l’élimination des personnes dont les caractéristiques sont jugées par beaucoup indésirables. L’eugénisme libéral[16] reposant sur la conjonction de décisions individuelles est une vraie tentation déjà à l’œuvre dans nos sociétés. C’est un enjeu démocratique et pas seulement médical parce que l’eugénisme, même s’il n’est pas étatique mais libéral, est une manière de dire que certains citoyens ne sont pas bienvenus. Or la démocratie repose sur la reconnaissance mutuelle des personnes sur la base de la commune humanité. Elle ne peut être l’organisation collective de discriminations en fonction de caractéristiques sociales, morales, physiologiques, psychologiques, intellectuelles prédéfinies. Il n’y a pas de démocratie sans une éthique et une politique de l’hospitalité. C’est pourquoi il est opportun, instructif et révélateur d’entendre des personnes porteuses de handicap et leur famille pour percevoir la fécondité humanisante possible de la fragilité pourvu qu’elle soit vécue dans un environnement relationnel riche de respect, de solidarité et d’amour.
- d) Le rapport à « l’intelligence artificielle »
L’« intelligence artificielle »[17], ou plutôt l’automatisation informatique et l’aide informatique à la décision grâce à une prodigieuse puissance de calcul, sont l’objet d’attentes bénéfiques et aussi de craintes multiples, voire de fantasmes.
Dans un cadre démocratique, l’enjeu est de « garder la main »[18] sur les techniques, c’est-à-dire de faire des choix issus de délibérations collectives et d’endosser la responsabilité de ces choix. La démocratie pourrait-elle devenir un gouvernement des algorithmes dont la conception et la régulation ne serait pas une « chose publique » mais une « chose réservée » à la décision d’une minorité soucieuse d’agir sans « principe de publicité », pour reprendre une exigence kantienne, c’est-à-dire sans favoriser l’usage public de la raison ? L’enjeu démocratique est donc d’interroger collectivement les critères éthiques mis en œuvre dans les « boîtes noires » des programmes informatiques.
Il serait important de prolonger cette interrogation pour que l’« intelligence artificielle » soit asservie à la nôtre et non l’inverse, pour que nous n’abdiquions pas notre responsabilité, pour que l’« intelligence artificielle » ne soit pas une nouvelle machine à exclure bien plus subtile que celles mises en œuvre dans la première période d’industrialisation. Le récent rapport du député Cédric Villani prend bien acte de ce défi en en affirmant : « L’intelligence artificielle ne peut pas être une nouvelle machine à exclure. C’est une exigence démocratique dans un contexte où ces technologies sont en passe de devenir une des clés du monde à venir » ou encore : « Face à l’ampleur des transformations à venir par l’IA, il est de notre responsabilité collective de s’assurer que personne ne soit mis de côté »[19]. Ainsi, il apparaît clairement que la bioéthique est indissociable d’une éthique sociale et politique.
6. La fuite en avant
Dans divers débats organisés par les Espaces éthiques régionaux, des questions diverses se sont fait entendre en interrogeant le principe même de la révision périodique des lois de bioéthique et de fin de vie. Chaque révision n’est-elle pas l’occasion d’aller plus loin dans la fragilisation, voire la suppression, des interdits fondamentaux ? Cette interrogation fait naître un scepticisme désabusé chez bon nombre de concitoyens.
Ne faudrait-il pas mettre en place un moratoire ?
Faut-il se laisser dicter ces révisions par des impératifs financiers dus à la concurrence internationale dans le domaine de la recherche, par des transgressions d’interdits majeurs mises en place dans d’autres pays, par des demandes sociétales où s’expriment des désirs exacerbés en raison d’un individualisme grandissant et de possibilités techniques ?
En vérité, le pouvoir politique est durablement fragilisé en se laissant guider par les demandes sociétales et les concurrences internationales. Plus qu’on ne le croit, la désaffection des citoyens pour la politique semble due, dans un non-dit permanent car on ne s’autorise plus à la parole, pour une bonne part à un scepticisme grandissant en raison du traitement qu’elle fait des questions sociétales. N’ayant pas de boussole anthropologique stable et claire, le politique apparaît comme une girouette tournant aux moindres souffles des lobbies successifs et contradictoires colportés ou amplifiés par les médias. Ces lobbies sont souvent minoritaires, alors même que les sondages semblent dire le contraire. Une analyse des sondages portant sur des questions éthiques mériterait d’être faite de façon approfondie. Le Rapport de 2011 de l’Observatoire national sur la fin de vie est très critique sur ces sondages car ils pratiquent « l’amalgame » et la « peur ».
Dans le fond, l’interdit « tu ne tueras pas », la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant, la vocation intangible de la médecine, le respect de l’inviolable dignité humaine, la non-patrimonialité du corps humain, la considération pour la vulnérabilité de l’être humain, la primauté de l’éthique sur le financier, la supériorité du principe de précaution sur les applications de la science, devraient constituer un axe politique fort dans une société démocratique qui trouverait son unité dans les symboles exprimant ces évidences. La réflexion éthique s’inspirerait de ces principes pour s’élaborer de façon stable dans les circonstances changeantes des découvertes scientifiques et de ses applications techniques. C’est d’ailleurs pour cette raison du nécessaire maintien des principes éthiques et juridiques fondamentaux que le Conseil d’État concluait ainsi sa liste de propositions dans son rapport de 2009 : « 27. Ne pas prévoir un réexamen des lois de bioéthique au bout de cinq ans. »[20]0
En revisitant la pertinence de ces principes éthiques et juridiques fondamentaux, les États généraux de la bioéthique pourraient être ainsi l’occasion de réaffirmer la valeur absolue de toute personne, en reformulant une éthique de la dignité, et de renouveler le projet d’une société solidaire soucieuse de la « fraternité », d’une « République sociale »[21], en développant une éthique et une politique de l’hospitalité.
————————————————————————–
[1] Vatican II, Constitution Gaudium et spes, n. 76,2 ; 7 décembre 1965
[2] Hans Jonas, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, trad. Jean Greisch, Paris, Cerf, 1992, p. 30
[3] Selon le CESE lors de la communication de son avis en date du 10 avril 2018
[4] Jürgen Habermas, « Retour sur la religion dans l’espace public. Une réponse à Paolo Flores d’Arcais », Le Débat, 2008/5, n. 152, p. 27-31
[5] Voir Mgr Pierre d’Ornellas (dir.), Bioéthique, questions pour un discernement, Lethielleux/DDB, 2009, p. 10-11.
[6] CESE, Fin de vie : la France à l’heure des choix, 10 avril 2018
[7] « L’acte de décès devrait porter la mention, comme cela se pratique dans la plupart des pays ayant légalisé l’aide à mourir, de décès naturel. » (CESE, ibidem, p. 47)
[8]Voir Jean-René Binet, Le droit de la bioéthique, LGDJ, 2017, p. 46-47.
[9] En référence à l’ouvrage de Jean-Michel Besnier, L’Homme simplifié. Le syndrome de la touche étoile, Fayard, 2012
[10] Voir Thierry Magnin, Penser l’humain au temps de l’homme augmenté, Albin Michel, 2017.
[11] Cour de cassation, Avis n. 15003 du 7 mars 2018 – première chambre civile.
[12] Mgr Pierre d’Ornellas (dir.), Fin de vie, un enjeu de fraternité, Salvator 2015.
[13] Claude Bruaire, Une éthique pour la médecine, Fayard, 1978, p. 35
[14] Sur la fin de vie, les 118 évêques de France ont signé une Déclaration Fin de vie : oui à l’urgence de la fraternité, 22 mars 2018
[15] Sur ces questions, voir les réflexions fondées et équilibrées de : Arnold Munnich, Programmé mais libre. Les malentendus de la génétique, Paris, Plon, 2016, 144 p.
[16] « L’eugénisme peut être désigné comme l’ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l’espèce humaine. Il peut être le fruit d’une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Il peut aussi être le résultat collectif d’une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents, dans une société où primerait la recherche de l’ »enfant parfait », ou du moins indemne de nombreuses affections graves. » (Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique. Étude adoptée par l’assemblée générale plénière le 9 avril 2009, La Documentation française, 2009, p. 40)
[17] Il serait légitime de s’interroger sur la pertinence d’une telle expression. L’intelligence n’est jamais artificielle quand elle s’investit dans la recherche de ce qui est vrai, bon et juste. Ce qui est artificiel n’est jamais intelligent ! Voir Jean-Gabriel Ganascia, Le mythe de la singularité, faut-il craindre l’intelligence artificielle ? Seuil, 2017.
[18] L’expression est empruntée au rapport : Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), Comment permettre à l’homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, décembre 2017.
[19] Cédric Villani (dir.), « Donner un sens à l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne », Rapport de la mission parlementaire sur l’intelligence artificielle, Mars 2018, p. 22 et 23.
[20] Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique. Étude adoptée par l’assemblée générale plénière le 9 avril 2009, La Documentation française, 2009, p. 144.
[21] 21 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » (Constitution de la République française, 4 octobre 1958, article 1). Cette formulation présente dans la Constitution de 1946 est issue de l’ambition du Conseil national de la Résistance de fonder une véritable politique de la solidarité y compris dans le soin