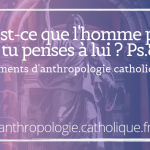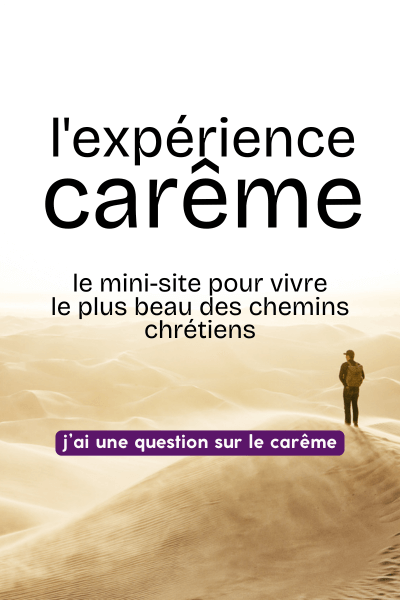« La réserve Pudeur, ressources et résistance par temps de crise » de Laure Borgomano, (Labor et Fides, Le champ éthique, 2025)
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 11 septembre 2025, n° 25 à propos de La réserve Pudeur, ressources et résistance par temps de crise de Laure Borgomano, (Labor et Fides, Le champ éthique, 2025)
La période estivale est propice à la lecture… de polars, mais aussi de livres plus exigeants. Les fiches de l’OFC reprenant en septembre, elles risquent de se heurter à un agenda bien occupé, alors qu’elles veulent encourager la lecture. Quoi qu’il en soit, il serait dommage de passer à côté d’excellents livres, tel celui que signe Laure Borgomano, La réserve. Dans une époque où « la montre », la mise en scène de soi, les émotions non régulées sont la règle, il est heureux de voir encouragés des chemins de maîtrise de soi.
Dans la préface, le professeur Ghislain Waterlot, de l’Université de Genève, situe l’objet de ce livre : « L’héroïsme et la sainteté sont rares, même exceptionnels, non exigibles, ils ne peuvent constituer une perspective éthique ordinaire. Mais n’y a-t-il d’autres choix que d’être un saint ou une âme veule ? Une héroïne ou une complice du pire ? À quelles conditions, sans être héroïque ou saint, peut-on garder une boussole morale, une attitude éthique malgré des temps sombres et difficiles ? » (p. 9-10).
L’auteur précise alors son projet : « Je souhaite faire de la notion de réserve une clef d’interprétation qui permette de comprendre à quelles conditions une attitude éthique reste possible dans les sombres temps ; pour cela, j’explore trois territoires de la réserve :
– une attitude – la pudeur, l’intime, la honte…
– des ressources – la culture, le souvenir, l’archive…
– et enfin une expérience de médiations » p. 16. « Je pense qu’il y a dans la réserve une puissance d’écart par rapport à une situation donnée, quelque chose qui relève immédiatement d’une forme de résistance : résistance à l’oppression, à la domination, à l’exercice de la violence comme à sa séduction. Résistance au désespoir, à la compromission, au consentement veule, à l’indifférence. Résistance au fantasme de toute[1]puissance, à l’impatience d’agir et d’achever l’histoire dès ici-bas. Peut-être éthique, cette puissance de résistance doit pouvoir s’exercer au double niveau individuel et collectif. Existe[1]t-il par ailleurs une ressource éthique qui resterait en réserve et qui rendrait compte du sursaut des ‘’refusants’’ ? » p. 20-21.
Laure Borgomano mène son travail en donnant la parole à des témoins qui ont vécu des situations d’extrême violence, qui ont connu l’univers concentrationnaire, nazi et soviétique. Dans les camps, tout était fait pour détruire l’humanité des détenus, en particulier en attentant à leur pudeur, à l’image d’eux-mêmes.
« Faire du supplice un spectacle auquel doivent assister tous les autres détenus est propre à la stratégie nazie : démontrer que la race des seigneurs a pouvoir de vie et de mort ; convaincre les détenus impuissants qu’ils sont vils ; empêcher toute résistance. Le supplice doit assurer la mise à mort de la victime et l’anéantissement psychique du témoin en tant qu’homme.
La victime meurt effectivement sous les coups. Le témoin est écrasé de douleur, honteux de sa propre faiblesse. Mais c’est alors que la honte ressentie devant la faute commise par autrui révèle au témoin la commune humanité qui les relie tous les trois, victime, témoin et bourreau. Car le bourreau est ici victime de sa propre folie : il peut bien se croire de race supérieure et seule humaine parce qu’il règne sur une troupe d’esclaves. Il n’est qu’un roi de circonstances » p. 85-86.
A cela, elle oppose la pudeur qui, loin d’être une attitude surannée, exprime le plus grand respect pour l’être humain, soi-même et l’autre. « L’être réservé tente de se soustraire aux regards impudiques. Mais le pudique est aussi celui qui se retient de regarder un spectacle inconvenant. En effet, le regard est déjà une effraction possible, une violation de l’intimité. Être regardé de façon impudique blesse la pudeur en introduisant un trouble dans l’âme. Mais celui qui regarde un spectacle honteux se voit regardant ce spectacle et devient alors honteux à ses propres yeux. Ce trouble témoigne de la honte de devenir soi-même à soi-même un spectacle inconvenant » p. 33. Chacun verra quelle référence évangélique il peut mettre en regard de ces lignes.
« Ce ne sont pas seulement des corps humains qui ont été blessés dans les camps d’extermination, mais la parole. Au Lager, les SS ne se contentent pas d’interdire aux détenus de leur adresser la parole : ils leur dénient l’usage même de la parole. Le détenu ne doit pas parler car il ne partage aucun monde commun avec le SS » p. 101.
A côté d’actes de résistance héroïques, et l’on nommera le Père Kolbe, combien d’actes de résistance discrets par lesquels les détenus tenaient dans cette humanité qui, pourtant, leur était déniée. Pour certains, la culture, la remémoration des œuvres, même la pauvre interprétation d’un acte d’une pièce de théâtre, au fond du baraquement, étaient ces moments, volés, où leur humanité, les liens sociaux, pouvaient s’exprimer.
« La mémoire des œuvres culturelles est liée aux divers moments, de l’enfance à l’âge adulte, durant lesquelles elles ont été découvertes, lues,
appréhendées, reçues d’autrui et parfois aussi transmises à d’autres. Mais ces œuvres portent également en elles la mémoire de ceux qui les ont composées comme de tous ceux qui les ont connues, aimées et nous les ont transmises. La remémoration des œuvres culturelles réalise comme une série d’enchâssement temporels portant témoignage de la légitimité de mon existence : inclusion de la mémoire individuelle dans une mémoire collective ; entrelac du passé de l’œuvre dans un temps transcendant passé, présent et futur ; introduction de la mémoire individuelle puis de l’action singulière dans une communauté lisante, selon l’expression de Paul Ricoeur.
Cette présence d’un temps commun dans le souvenir des œuvres culturelles est précisément ce qui contribue à la possibilité d’une résistance tant individuelle que collective » p. 139-140. « Dans le monde profondément non éthique et non démocratique du camp, ces moments de mise en commun de la culture rompent la temporalité mortifère de la déportation, créent l’espace-temps d’une vie éthique et politique au sens plein du terme […]. La culture et plus encore le partage de culture, savante, populaire, voire scientifique, ont joué un rôle singulier de réserve dans les camps » p. 152.
Le livre est truffé de citations des écrits des détenus des camps nazis et de la Kolyma. Chacun, dans ces lieux de l’anéantissement, exprime une espérance, malgré tout. Et tel est bien le projet de notre auteur. Loin des grandes affirmations et de l’héroïsme, qui demeurent l’exception, elle se veut témoin de l’humble et ordinaire espérance qui peut être ouverte à chacun.
« Pour Gabriel Marcel, l’espérance ne porte pas sur un ‘’objet’’ à atteindre mais sur un processus de transformation intérieure du sujet » p. 220.
« Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait s’imaginer que c’était à nous de donner un sens à la vie, chaque, à chaque heure » Victor E. Frankl, Découvrir un sens à sa vie, Editions de l’Homme, 2006, p. 83 (cité p. 221).
« L’espérance ne dit pas ‘’j’espère que’’ mais ‘’j’espère’’, et en cela elle est proche de la foi qui distingue ‘’je crois que’’ et ‘’je crois’’. Elle n’est jamais autant nécessaire que dans les situations désespérées et désespérantes. ‘’S’il n’espère pas l’inespérable, il ne le découvrira pas, étant inexplorable et sans voie d’accès’’, prévient Héraclite dans son Fragment 18 » p. 222.
La dernière partie du livre est consacrée à l’image, à la représentation, singulièrement dans le cinéma. Il est spécialement question d’Andrei Tarkovski. La réserve constitue pour ceux qui maîtrisent l’art de l’image un signal, une limite. « Au-delà de sa fonction de représentation, il y a dans l’image une puissance redoutable de production du réel dont témoignent les violents combats dont elle a été et est toujours la cause : qui contrôle les images contrôle la pensée des hommes et leur destin […]. Pour rester puissance de résistance éthique, l’image doit alors préserver, en son cœur, l’altérité des regards qui la contemplent » p.250-251. « Le Christ n’est pas dans l’icône, l’icône est vers le Christ qui ne cesse de se retirer. Images et icônes sont deux substances distinctes et différentes, l’icône tire son pouvoir du manque, de l’absence, dans la représentation de ce qui est représenté » p. 252.
Enfin, alors que notre actualité exalte la puissance, en particulier celle de leaders et de chefs d’Etat qui font fi de tout droit international, au risque que les simples citoyens pensent que, pour eux aussi, à leur niveau, seule la puissance serait l’attitude à adopter, l’attitude de réserve dit le primat de l’humilité, de l’écoute et la défense du petit, l’impérieuse nécessité de la douceur. Il sera toujours plus moral d’être du côté des humiliés et des vaincus – on peut être soi-même de ceux-là. Les Béatitudes évangéliques demeurent le chemin, en contradiction, sans doute de plus en plus manifeste, avec l’esprit du monde.
« Je m’aperçois d’une chose : au fond ce que j’aime, ce qui me touche, c’est la beauté non reconnue, c’est la faiblesse d’arguments, c’est la modestie. Ceux qui n’ont pas la parole, c’est à ceux-là que je veux la donner. Voilà où ma position politique et ma position esthétique se rejoignent. Rabaisser les puissants m’intéresse moins que glorifier les humbles. Les humbles : le galet, l’ouvrier, la crevette, le tronc d’arbre, et tout le monde inanimé, tous ceux qui ne parlent pas » Francis Ponge, ‘’Je suis un susciteur’’, poème inédit (1942), in Nouveau Nouveau Recueil, tome I, Gallimard, 1992, p. 187 (cité p. 260).
Pascal Wintzer, OFC