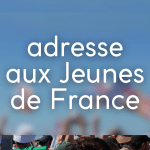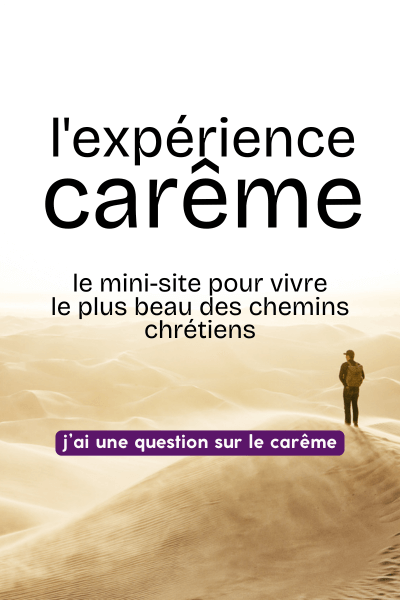« Explosive modernité Malaise dans la vie intérieure » d’Eva Illouz (Gallimard, Connaissances, 2025)
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 3 septembre 2025, n°24 à propos de « Explosive modernité Malaise dans la vie intérieure « d’Eva Illouz (Gallimard, Connaissances, 2025)
Les éditions Gallimard ont lancé au printemps dernier une nouvelle collection d’essais, « Connaissances ». Le premier numéro de cette collection est signé Eva Illouz ; il offre une excellente analyse des émotions qui sont une part essentielle de l’existence humaine. Avant tout Eva Illouz plaide pour que chacun déjoue le déni qui peut conduire à ne pas laisser venir les émotions à la conscience.
Ceci peut particulièrement être avéré dans les mondes religieux. En effet, une mauvaise théologie du péché, la poursuite d’un idéal qui projette hors de l’humanité réelle, l’illusion de vivre déjà dans le Royaume de Dieu – nombre de communautés, souvent nouvelles ont versé dans ces graves travers – tout ceci entretient les phénomènes de déni qui privent de la conscience de soi et d’une juste capacité à agir.
« Les émotions sont fondamentalement sociales, mais elles peuvent être étouffées par un excès de socialité qui brouille la conscience individuelle. Lorsque cela se produit, nos émotions en tant qu’instruments de navigation dans le monde social sont émoussées et la navigation ne peut plus nous aider à trouver notre propre voie et voix » p. 434.
« Pouvoir nommer les émotions, c’est parfois générer des révolutions, privées ou collectives. […] La conscience de soi doit à la fois comprendre ces déterminations sociales et leur échapper. Nous y parvenons en saisissant pleinement nos émotions, et en les transformant en une vision politique » p. 435.
De manière significative, Eva Illouz ouvre son livre par un premier chapitre qui n’est pas consacré à une émotion mais à une vertu : l’espérance. Cette réflexion est bienvenue en cette année jubilaire qui place l’espérance au cœur de son processus. Illouz s’interroge sur la difficulté de nos cultures, occidentales avant tout, à oser espérer. Elle en dit pourtant la force qui nous serait plus que nécessaire.
« L’espérance porte la véritable vertu chrétienne en ceci qu’elle fait le lien entre le visible et l’invisible, entre l’humain et le divin. Elle transcende le présent et accomplit la foi en la bonté ultime de Dieu » p. 49.
« L’espérance nous donne un sens du possible. Elle ouvre une brèche dans la fatalité, nous propulse vers l’avant. Mélodie de l’âme sans raison ni justification elle se passe de mots. Elle ne demande pas de miettes parce qu’elle ne réclame pas de preuves. L’espérance affirme la croyance irrationnelle en un avenir meilleur, et c’est ce qui rend son chant particulièrement ‘’suave’’ dans la tempête » p. 51.
Le choix d’ouvrir le livre par l’espérance a pour logique de voir dans les émotions qui vont ensuite être abordées des obstacles à l’espérance, ici envisagée comme une nécessaire énergie vitale. Non qu’il s’agisse de faire taire les émotions, mais plutôt d’en comprendre les mécanismes.
Le premier frein à l’espérance, et qui peut conduire à leur dénier tout aspect positif, c’est la déception. Par crainte de l’éprouver, voire d’être confronté à un échec, l’échec devient alors une illusion dont il faut se défaire.
Il est ensuite question de l’envie, cette émotion que le marché capitaliste a institutionnalisé en tant qu’il est un des moteurs de la consommation : l’autre devient un objet de comparaison par rapport auquel je dois montrer ma valeur.
« La société de consommation, l’éducation supérieure de masse et les entreprises modernes donnent lieu à une culture de la comparaison. En se comparant continuellement les uns aux autres, les acteurs éprouvent une envie qui peut conduire au ressentiment » p. 150…151.
Cette émotion, comme la colère, a une dimension bien évidemment sociale ; elle s’appuie sur ce fait, heureux, que les êtres humains sont en interaction les uns par rapport aux autres, mais, tant l’envie que la colère, plutôt que de contribuer à des relations harmonieuses, développent les antagonismes.
« De toute les émotions négatives, la colère est celle qui contribue le plus au vote populiste. Elle est au cœur des ‘’histoires’’ que les partisans des formations populistes se racontent et à partir desquelles se met en place un récit politique et émotionnel. […] Le populisme est plus une émotion qu’une idéologie, l’émotion qu’il sollicite, c’est la colère » p. 194-195.
« Si la colère s’est propagée à ce point, c’est parce qu’elle est devenue plus légitime. L’indignation est même devenue un signe de moralité [On se rappelle l’étonnant succès de l’opuscule de Stéphane Hessel, Indignez-vous !] » p. 208. Il faut ajouter que les réseaux sociaux, non soumis aux règles de déontologie, et ignorant toute forme de nuance, contribuent à l’exacerbation des colères.
On pourra lire ensuite un chapitre consacré à la peur, en tant celle-ci peut devenir un instrument aux mains de régimes politiques pour assoir leurs choix et leurs pratiques.
D’intéressants développements sont consacrés à la nostalgie. Cette émotion est spécialement vécue par les populations migrantes, déracinées de leur terre, de leur culture. Mais elle est aussi partagée par des natifs en tant qu’elle exprime un sentiment de perte d’un monde, de modes de vie, désormais révolus, mais qui paraissent ou sont présentés comme un monde meilleur auquel on aurait été arraché.
« Le sentiment de perte du monde nous rappelle à quel point notre identité dépend de nos institutions politiques et à quel point l’imaginaire social d’appartenance, construit par les régimes politiques, nous donne le sentiment d’avoir une maison. […] Le sentiment d’avoir perdu son foyer est donc une forme de deuil face au changement, En d’autres termes, le changement en lui-même induit un sentiment de désorientation » p. 290-291. « Pour Edgar Quinet, le véritable exil n’est pas d’être arraché à son pays, c’est d’y vivre et de n’y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer » p. 293.
« La modernité transforme les paysages moraux et matériels à un rythme soutenu, et elle fait de la nostalgie un trait caractéristique de la politique restauratrice, qui promet de réparer les pertes. Plus que toute autre émotion, la nostalgie projette les individus et les communautés vers leur propre noyau imaginaire et menacent dangereusement de faire du passé – bien plus que du présent ou du futur – le seul et unique objet de la politique » p. 308.
Même si les émotions ont toutes un caractère social, certaines appartiennent davantage à la sphère intime, elles affectent l’image que l’on a de soi, ainsi le sentiment de honte qui atteint la valeur et l’estime. Eva Illouz souligne aussi la pratique extrêmement néfaste qui conduit certains à jeter l’opprobre sur d’autres, avec cette raison que, tel propos, telle attitude serait contraire aux bonnes manières de se comporter, là encore nous revenons aux réseaux sociaux ; il s’agit du shaming. La désignation publique des auteurs de délits ou de crime, « le shaming est vécu comme une manière d’affirmer sa propre vertu morale. Mais quand l’indignation morale tourne à la surveillance collective et à un système punitif, elle ne corrige pas le tissu social : elle le déchire » p. 337.
« Les technologies actuelles permettent de conserver indéfiniment les traces de l’infamie, de la honte, de la souillure et de la diffamation. Alors que de nombreuses cultures pratiquent des rituels d’expiation et de pardon dans le but d’atténuer ou d’effacer la honte, cela est impossible dans une société où la technologie grave le moindre faux pas dans l’éternité. Chose plus grave encore : même lorsque l’intéressé est innocent, le shaming électronique lui coud sur la poitrine la lettre d’infamie, dès lors inscrite sur lui à jamais » p. 338.
Il sera ensuite question de la fierté, nécessaire et dangereuse, lorsqu’elle verse dans l’affirmation identitaire ; de la jalousie, essentiellement expression du droit de propriété des hommes sur les femmes. Et parle aussi de l’amour, en tant que cette émotion bouleverse des relations envisagées comme soumise à un ordre social et patriarcal. « L’amour entretient une relation singulièrement étroite avec la modernité. Émotion transgressive, il menace l’ordre social traditionnel et réduit à néant les projets parentaux. L’amour fait fi des intérêts économiques, il ignore les règles communautaires de l’endogamie qui stimule ainsi, pour ainsi dire, l’individualisme moral » p. 392.
Développant de fines analyses des émotions, leur caractère ambivalent, Eva Illouz fait œuvre salutaire en aidant son lecteur, sa lectrice, à mieux percevoir ce qui agite son esprit et son cœur. Elle permet que nous fuyions le déni cet « art de truquer la réalité, de transformer des faits concrets en images vagues et floues qui perdent leur signification et leur pouvoir émotionnel » p. 429.
« Les émotions ne sont pas seulement au centre de notre existence, elles en sont le centre même, car ce n’est qu’à travers les émotions que nous savons à quoi nous tenons vraiment. Ne pas connaître ses émotions, c’est de pas savoir ce qui compte pour soi. Et ne pas savoir ce qui compte pour soi, c’est laisser les autres s’en charger. C’est ne jamais découvrir la matière même de notre rapport au monde » p. 417.
+ Pascal Wintzer, OFC