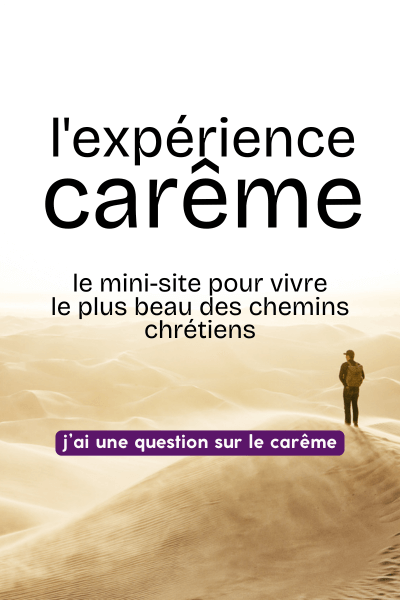« La vie des spectres » de Patrice Jean
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 13 novembre 2024, OFC 2024, n°38 sur La vie des spectres de Patrice Jean (Le Cherche Midi, 2024).
Richesses et limites de la lecture
A propos du roman de Patrice Jean, La vie des spectres.
La précédente fiche de l’OFC parlait de littérature, soulignant, à l’écoute de la lettre du pape François de juillet dernier, son importance dans la formation, en particulier des séminaristes. La fiche présente peut offrir un complément ou un contre-point à cette précédente fiche. Ici, il s’agit d’un roman, donc une œuvre littéraire, mais, s’il y a une intrigue – il s’agit d’un journaliste, de sa vie professionnelle et familiale – ce roman de Patrice Jean, La vie des spectres, a aussi une portée philosophique et sociale, très précisément il se veut critique de la société contemporaine, pointant aussi ce risque de faire de la littérature un refuge, un Aventin dispensant de vivre et de s’engager. Romancier, amoureux des lettres, Patrice Jean met en pratique cette pensée critique chère à Adorno et exprimée dans le beau titre du livre de Nathan Devers (Albin Michel, 2024) : Penser contre soi-même. En effet, l’amour des lettres peut confiner en une sorte de retrait du monde, pour mieux le surplomber au lieu d’y investir.
Patrice Jean, en tout cas son « héros », exprime ce constat désabusé que faute de savoir s’étonner, s’émerveiller, on devient insensible. « Je suis arrivé à cet âge (quarante-neuf ans) où l’on devine les répliques de ses contemporains sans qu’ils aient à les formuler, où l’on entrevoit ce qu’ils vont faire avant qu’ils le fassent, comme si la surprise et l’inattendu avaient déserté l’existence. Je ne m’exclus pas de ce constat. Les idées viennent avec l’air qu’on respire et chacun, se croyant original (ou bien s’en foutant royalement), les expire à longueur de journées et d’années. Et d’articles, et de livres, et de colloques. […] Peut-être que l’on meurt du grand âge faute d’un geste qui vous surprenne ou d’une parole inattendue ? » p. 13-14.
N’attendant rien des autres ni de la vie, voilà à quoi on est conduit : « J’ignore si la vie a un sens, mais la mienne n’en a pas. Si je n’étais pas né, le monde n’aurait pas été différent. Et si je ne suis rien pour le monde, m’en voudra-t-on de le considérer avec indifférence ? » p. 24.
Cherchant un remède, il va le trouver dans la lecture. « Un esprit privé de livre finit par s’étioler aussi sûrement qu’une plante meurt de n’être pas régulièrement arrosée, mais à quoi bon ? L’époque est plus forte que moi. Lire exige un effort que beaucoup entendent éviter. Dans un monde où tout est facilité, où, en balayant du doigt l’écran d’un portable, on commande son repas du soir, un partenaire sexuel, une paire de chaussettes, on tue un dragon, dans ce monde, donc, on méprise, en dehors des études et du travail, l’effort intellectuel » p. 32-33.
Permettez-moi de rapporter ce passage, sans doute secondaire dans le roman, mais qui pourra, nous évêques, nous marquer davantage. Le personnage principal, journaliste culturel dans un journal nantais, est chargé de dresser le portrait de personnalités de cette ville. A l’approche de Noël, il propose de faire celui de… l’évêque de Nantes, et d’entendre son rédacteur en chef lui dire : « Nous, au journal, on s’intéresse à la culture vivante, au spectacle, aux nouvelles tendances, à la mode, à la vie de l’esprit, pas au christianisme, quoi ! » p. 67.
Sur le fond, Patrice Jean parle d’une société douloureuse. En tout cas, c’est ainsi qu’il la perçoit. La cause, pour son personnage, d’un tel sentiment, ne sont-ce pas ces livres, qu’il chérit pourtant, mais, qui, peu à peu, plutôt que de le relier à la vie et aux vivants l’en éloignent ? Pour notre héros, la lecture l’a rendu critique au sujet du monde, ce qui, en soi, est heureux, mais au risque de n’être plus l’objet que de rejet. En effet, ce « rabat-joie », cet homme du papier et des auteurs du passé, finit par lasser ses contemporains. De plus, il s’éloigne d’autant de ce qui les passionne et motive leurs existences.
« J’ai trop lu. Je me suis éloigné de la rive, de notre époque et de ses vivants.
Les écrivains sont de mauvaises fréquentations, on ne les pratique pas sans danger. A hanter les livres du passé, on quitte le présent. […] Tout ce que je dis et j’écris, tout finit par choquer. Ou par être rejeté. Je ne suis plus à la bonne distance. Mon seul viatique est de transformer mes contemporains en ectoplasmes : je suis réel, ils sont irréels » p. 132.
« Le monde est malade, tout suffoque de rage, de vengeance, de bonne conscience. Il ne reste que mon bureau, mes livres. Qu’on me les retire, je suis perdu » p. 154.
En même temps, il lit, en même temps, il s’en estime coupable : « Le mieux, vraiment, était de rester avec les livres, de passer mes soirées avec Pascal, avec Flaubert, avec Schopenhauer, avec Marx, avec Léautaud. Au-delà de cinquante ans, me disais-je, il ne sert plus à rien de fréquenter ses semblables. Doriane avait raison, je tournais vieux con » p. 403.

La seconde partie du livre, ouverte par cette citation de Novalis : « Là où il n’y a plus de dieux, règnent les spectres » (cité p. 223), raconte l’irruption d’une nouvelle pandémie, dont les symptômes sont des irruptions cutanées et des démangeaisons. Après moulte paroles d’experts, mais aussi de complotistes de divers ordres, un traitement est trouvé… la lecture des grands auteurs !
Alors que la lecture a peu à peu éloigné le héros des autres, ce sont eux qui, désormais, s’emparent des livres pour y trouver un remède à leur maladie.
« Je conserve un souvenir ahuri et attendri de cette période. D’un côté, mon existence partait à vau-l’eau, entre mon divorce, ma solitude et mes dégoûts, et, de l’autre côté, me réjouissait la vie française dévolue à la lecture de Valéry ou de Montherlant » p. 397.
« Dans toute la France, et partout dans le monde, les journaux, les chaînes de télévision, les cinémas, les aires de loisirs, toute l’industrie de l’information et du divertissement eut à souffrir de cette ferveur soudaine pour la littérature » p. 399.
Alors, faut-il lire ? Et pourquoi le faire ? On reviendra à la précédente fiche de l’OFC pour y revoir les multiples motifs. Mais, sans pour autant négliger les avertissements de Patrice Jean dans La vie des spectres. Oui, le meilleur peut conduire au pire ; tant les livres peuvent aiguiser la sensibilité, ouvrir à des relations plus ajustées, tant ils peuvent entretenir la misanthropie et l’éloignement de la vie. « De pénétrer dans une librairie, gonflée des romans de la rentrée littéraire ou des livres dont on parle, m’avait toujours déprimé. À quoi bon, pensais-je, ajouter un volume de plus à cette frénésie commerciale ? J’avais aimé, dans les livres, le retrait du monde, le pas de côté, l’absence. Les libraires applaudissaient les stars du roman, la foule, la présence. C’est normal, ils avaient, pour survivre, l’obligation de vendre. Que le livre fût un produit me foutait le bourdon : ce n’était donc que ça ? Au mieux, un médicament pour l’âme, au pire, un passe-temps qu’on emportait à la plage, ou dans un train, par peur de rester seul avec soi ? Le livre, un divertissement ? Vraiment ? Je songeais que la littérature se trouvait plus sûrement au milieu d’une lande déserte, dans le vent, le sable, la nuit : la disparition » p. 289.
+ Pascal Wintzer, OFC