« La piste du vieil homme », d’Antonin Varenne
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 10 juillet 2024, OFC 2024, n°26 sur , Gallimard, La Noire, 2025.
Chacun trouve, durant son été, les activités qui le distrairont de l’ordinaire. Pour certains, 2024 sera l’année du sport et des jeux olympiques et paralympiques… derrière un écran de télé. Pour d’autres, fidèles à Churchill, ce sera no sport, et peut-être des romans policiers. Je leur conseille le dernier roman d’Antonin Varenne, La piste du vieil homme.
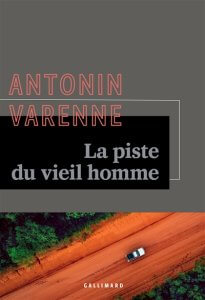
Il s’agit d’un roman noir où compte moins l’intrigue, l’énigme à résoudre – il n’y en a pas ici – que les personnages, l’ambiance, le cadre dans lequel se déroule le récit.
Le héros, qui n’en est pas un, est un homme, usé, revenu de tout, d’une bonne soixantaine, qui a monté une petite, très petite, agence de tourisme à Madagascar. A bord de son buggy il véhicule des touristes peu craintifs, désireux de découvrir de l’authentique.
Il apprend que son fils avec lequel les relations sont au froid est aussi à Madagascar et qu’il pourrait avoir besoin d’aide. Ceux qui sont allés à Madagascar retrouveront ce pays qui aurait tout pour connaître un certain développement, ce n’étaient ses gouvernants et ceux qui l’exploitent, désormais la Chine.
Ce qui est dit du train pourrait l’être de toutes les structures du pays : « Lorsque l’Etat a vendu aux plus offrants, on s’est aperçu que le Réseau national des chemins de fer malagasy avait – depuis combien de temps, personne ne l’a dit – six PDG différents, recevant simultanément six salaires de ministre » p. 35.
Ceci m’évoque cette anecdote : quelqu’un, me montrant tel édifice religieux, me disait qu’il avait été financé au moins trois fois son coût… par une conférence épiscopale (pas la française). Non que les pierres coutassent plus cher, mais des intermédiaires ont su en profiter.
« Les flics font payer tous les gens qui travaillent sur les routes, pas seulement les vasahs [les européens blancs]. La taxe varie à la tête du client et les vasahs paient le plus, mais tout le monde y passe […]. Un gendarme de bord de route, avec sa chaise sous son arbre, n’est jamais seul. Il paie lui-même une taxe sur ce qu’il vole à un ou plusieurs de ses supérieurs, qui versent aussi quelque chose à un ou plusieurs de ses supérieurs, qui verse aussi quelque chose à un officiel plus haut placé. La petite corruption de rue n’est possible que sous un large parasol de complicités » p. 55.
Au long de son périple qui va le conduire à retrouver son fils, Simon va croiser des trafiquants de drogue, des villageois, des voleurs de zébu, et une religieuse française. Comme tout bon auteur de polar, Antonin Varenne est anar, il prend le parti des laissés pour compte ; la critique sociale fait partie de ce genre littéraire.
« Qu’en France on trouve les bonnes sœurs anachroniques, sorties du film La grande vadrouille, c’est compréhensible. Elles y sont en voie d’extinction. En Afrique et dans le tiers-monde en général, elles sont moins insolites. Les Eglises et sectes de toutes branches y pullulent – on ne peut pas non plus vouloir que la pauvreté et le désespoir se passent des béquilles que la richesse et la sécurité rendent obsolètes » p. 62. « L’évangélisation, c’est pas mon truc. Même s’il ne faut pas oublier qu’ici les bonnes sœurs font partie des pauvres. Si elles bourrent le crâne des gamins avec leurs âneries, elles passent aussi leur temps à aider les autres » p. 64.
L’économie, la religion… l’éducation aussi fait partie des thèmes déclinés dans notre roman. Le ton est grinçant comme il se doit, mais il manifeste un refus de se résigner face aux injustices. « On comprend facilement pourquoi l’éducation n’est jamais une priorité des pays contrôlés par des élites corrompues : quand quelqu’un a appris à s’exprimer, les stratégies de contrôle desdites élites sont vite énoncées » p. 117.
Simon va retrouver son fils, Guillaume, au bout d’une route qui n’en est pas vraiment une, quoique qu’elle se nomme RN1 ; beaucoup connaissent ces « routes ». Dans un village isolé, Guillaume a créé une école pour les enfants du lieu. « Eduquer, dans un endroit où il n’y a aucune éducation, c’est tout changer. C’est compliquer la tâche de ceux qui contrôlent la situation. Le bandit a besoin que les éleveurs soient pauvres et ne puissent pas se défendre. Que la piste soit impraticable pour que les autorités ne puissent pas le capturer que les troupeaux se déplacent lentement » p. 133.
« Quand je vois les pubs de l’UNICEF, avec des écoles toutes jolies au milieu de la brousse, des enfants qui rigolent et des institutrices noires qui prennent dans leurs bras des bienfaiteurs blancs, en toute amitié et toute reconnaissance, moi, ça me fait le même effet qu’une pub pour une banque qui se termine par un repas de famille, avec trois générations d’endettés rigolards, devant un grand écran et un match de foot » p. 171-172.
Derrière la critique acerbe on sent chez l’auteur un amour pour Madagascar et sa population qui survit malgré tout. « C’est l’avantage de Madagascar. Si sur une piste on a toujours cent problèmes de plus que ce qu’on a prévu, il y a aussi des tas de choses sans importance. Comme l’heure ou le jour où on arrivera. On s’en fout, on a le temps » p. 231.
Pascal Wintzer, OFC




