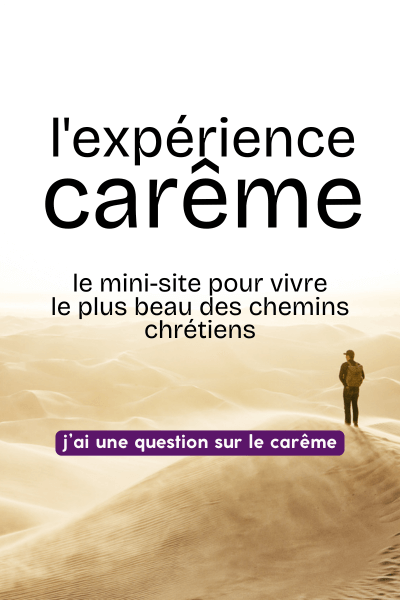Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon – Ma nuit au musée – Stock, 2022
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 7 décembre 2022, n° 39 à propos de Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon – Ma nuit au musée – Stock, 2022
Le dernier livre de Lola Lafon appartient à une collection dans le projet est d’inviter un écrivain à écrire son expérience d’avoir passé, seul, une nuit, dans un musée.
Lola Lafon a choisi que cette nuit soit au Musée Anne Frank à Amsterdam. Juive, ayant une généalogie traversée des absences et des ruptures dues aux pogroms et à la Shoah, elle vit avec intensité cette nuit au musée, cette nuit avec Anne Frank.
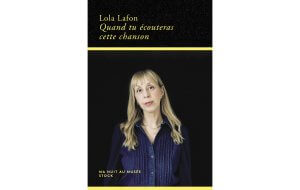 En exergue, elle cite George Steiner : « Les hommes sont complices de ce qui les laisse insensibles ». Bien entendu, on lit ceci à la lumière de la Shoah, des silences, des regards détournés de tous ceux qui n’ont pas voulu voir. Un tel constat peut s’entendre de bien d’autres situations où l’insensibilité a prévalu et prévaut, conduisant à détourner les yeux du migrant, du SDF comme des victimes d’agressions sexuelles.
En exergue, elle cite George Steiner : « Les hommes sont complices de ce qui les laisse insensibles ». Bien entendu, on lit ceci à la lumière de la Shoah, des silences, des regards détournés de tous ceux qui n’ont pas voulu voir. Un tel constat peut s’entendre de bien d’autres situations où l’insensibilité a prévalu et prévaut, conduisant à détourner les yeux du migrant, du SDF comme des victimes d’agressions sexuelles.
Ceci résonne avec ce qu’écrit, ce que vit Lola Lafon. Elle a voulu détourner les yeux de tout ce qui parlait de la Shoah, ici, non par insensibilité mais par très grande sensibilité.
« Je suis celle qui, depuis l’adolescence, détourne les yeux ; celle qui ne regarde pas de documentaire sur la Shoah. Celle qui n’a lu que peu de livres à ce sujet. Celle qui est sortie de la salle pendant la projection de La liste de Schindler, qui a eu la nausée pendant celle de La vie est belle, de Benigni, celle pour laquelle la romantisation de l’Holocauste est insupportable […]. J’affirme que je n’ai pas besoin de voir, de lire : je sais cette histoire […]. Je sais l’histoire de ces familles élevées dans l’amour d’une France de fiction, celle d’Hugo, de Jaurès et de la Déclaration des droits de l’homme. Je sais que, loin du havre qu’ils espéraient y trouver, ils ont été humiliés, pourchassés, déportés ; Plutôt que savoir, il faudrait dire que je connais cette histoire, qui est aussi celle de ma famille. Savoir impliquerait qu’on me l’ait racontée, transmise. Mais une histoire à laquelle il manque des paragraphes entiers ne peut être racontée. Et l’histoire que je connais est un récit troué de silences, dont la troisième génération après la Shoah, la mienne, a hérité » p. 41-42.
Je sais qu’il est perçu comme illégitime de prendre la Shoah comme référence d’autres faits historiques, la Shoah est et conserve un caractère absolument unique. Je m’autorise cependant à franchir ce pas, que ceux qui jugent ceci insupportable me le pardonnent, s’ils le veulent. « De victimes à témoins », c’est sous ce titre que la CIASE a choisi de « relier » les paroles des personnes victimes de crimes et de délits sexuels de la part de personnes, évêques, prêtres, religieux, laïcs, placées sous l’autorité de l’Eglise catholique. Leurs paroles interdisent de minimiser les crimes, ou bien de trop vite passer à autre chose. Sans malice, mais avec beaucoup de naïveté, et surtout sans prise en compte des victimes, les « professionnels de l’espérance et du pardon », dont je suis, ont pu et peuvent minimiser le poids du mal, de ce mal extraordinaire ou ordinaire qui corrompt et contamine s’il n’est reconnu et combattu.
Cet extrait du Journal d’Anne Frank, que cite Lola Lafon, redit le poids du mal, son emprise. Les premières éditions du Journal qui voulaient surtout retenir l’itinéraire d’une jeune-fille ont supprimé ce passage ; en effet, il met en cause les discours à l’eau de rose sur l’espérance et les happy end dont l’on peut se contenter lorsque le souci des réconciliations ou des pardons trop rapides passe sur le lent et douloureux travail qui est à mener.
Anne Frank écrivit ceci le 3 mai 1944. « On ne me fera pas croire que la guerre n’est provoquée que par les grands hommes, les gouvernants et les capitalistes, oh non, les petites gens aiment la faire au moins autant, sinon les peuples se seraient révoltés contre elle depuis longtemps ! Il y a tout simplement chez les hommes un besoin de ravager, un besoin de frapper à mort, d’assassiner et de s’enivrer de violence, et tant que l’humanité entière, sans exception n’aura pas subi une grande métamorphose, la guerre fera rage, tout ce qui a été construit, cultivé, tout ce qui s’est développé sera tranché et anéanti, pour recommencer ensuite ! » Cité p. 123.
Lola Lafon cite également (p. 129) cette parole de Bruno Bettelheim, survivant de Dachau et de Buchenwald : « Si tous les hommes sont bons, Auschwitz n’a pas existé. » Lorsque le mal n’est pas reconnu tel, lorsque l’on passe trop vite à un au-delà du mal, on se prive de se donner les moyens de le combattre. Mais, reconnaissons-le, il faut souvent être percuté par ceux qui le subissent pour que l’on accepte sa réalité. « La mémoire est un lieu dans lequel se succèdent des portes à entrouvrir ou à ignorer ; la mémoire, écrit Louise Bourgeois, ‘’ne vaut rien si on la sollicite, il faut attendre qu’elle nous assaille’’ » p. 53.
Le poids du mal subi ne sera sans doute jamais éradiqué du cœur, de l’esprit, des « trippes » des personnes qui en ont été les victimes. Certes, il y aura des résiliences, des reconstructions, parfois même des pardons, mais « les survivants et les exilés ne sont pas des héros. Ce sont des épuisés qui font comme si » p.156.
+ Pascal Wintzer Archevêque de Poitiers