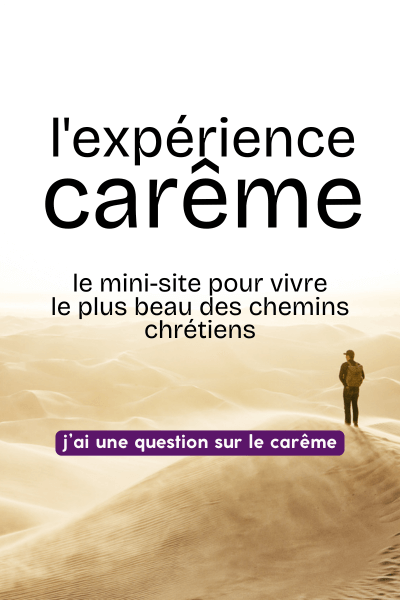« Une Nuit au cap de la Chèvre » de François Cheng
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 9 avril 2025, OFC 2025, n°12 sur « Une Nuit au cap de la Chèvre » de François Cheng (Albin Michel, 2025).
 Pourquoi une fiche de lecture OFC sur un ouvrage récent d’un académicien, quand toutes les bonnes gazettes et suppléments littéraires en ont déjà fait la recension et la promotion ? La question est pertinente. Et le fait d’avoir eu quelques moments d’intimité avec l’auteur bientôt centenaire ne justifie pas ce choix de recenser un bel ouvrage de 70 pages. Mais il s’agit simplement mettre en évidence la singularité et la pertinence actuelle de la confession de foi de ce jeune homme à l’écriture alerte qui témoigne de ses émois culturels à 15 ans.
Pourquoi une fiche de lecture OFC sur un ouvrage récent d’un académicien, quand toutes les bonnes gazettes et suppléments littéraires en ont déjà fait la recension et la promotion ? La question est pertinente. Et le fait d’avoir eu quelques moments d’intimité avec l’auteur bientôt centenaire ne justifie pas ce choix de recenser un bel ouvrage de 70 pages. Mais il s’agit simplement mettre en évidence la singularité et la pertinence actuelle de la confession de foi de ce jeune homme à l’écriture alerte qui témoigne de ses émois culturels à 15 ans.
« Au sein de l’humanité, un jour, Quelqu’un a accompli le geste absolu et indépassable, le geste décisif qui a changé la nature et le sens de la Mort. En se laissant clouer sur la Croix, il a affronté le mal – non seulement le mal de ses bourreaux mais le Mal en soi, Le Mal radical Et dans le même temps, il a affirmé l’Amour inconditionnel, puisque, sur la Croix, s’adressant au Père, il a dit : “Pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu’ils font”. Cette parole faisait écho à ce qu’il avait déjà proféré : “Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis”. »
Faut-il souligner que cet ouvrage est dédié à son épouse Micheline Benoit dont François Cheng assure le deuil récent avec la pudeur d’une confession intime qui se livre dans les mots et les silences de la poésie ?
Le texte se poursuit : « D’un geste unique, il a tenu les deux bouts de la Vérité : il a vaincu le Mal radical par l’Amour absolu qu’il incarne. Sa mort ouvre la Voie de la Vie qui ne périra plus ; le lien entre l’ordre humain et l’ordre divin est rétabli. Plus précisément, il nous est permis de dire qu’une relation filiale est renouée. Nous sommes les héritiers à qui incombe le devoir d’assurer la marche de la Vie ».
Ici la dogmatique théologique se communique dans la précision suggestive des mots de la poésie. N’en déplaise à ceux qu’hérissent les majuscules, elles ont ici tous leur portée au sens musical du terme : celle des notes plus graves de la partition.
Enfin, un dernier paragraphe clôt la page : « Ici je crois entendre la lointaine prédiction du Tao : “Celui qui cède à l’amour en se donnant au monde ; à lui sera confié le monde” » (p. 28).
Car l’ouvrage porte sa part de confession et livre l’articulation entre la jeunesse chinoise de l’auteur, son implantation en France, sa rigueur d’acquisition de la langue, et plus encore la « cohérence » pour lui d’un vaste continent indo-européen. Il est né à une extrémité et il mourra à une autre.
Le cadre romanesque de l’ouvrage tient dans son titre : Une Nuit au cap de la chèvre. Un vieil homme se réfugie seul pour méditer dans une maison isolée donnant sur l’Atlantique. Le Cap de la chèvre est la pointe la plus avancée au sud de la presqu’ile du Crozon. Le vaste océan est à ses pieds, de la baie de Douarnenez jusqu’au golfe de Gascogne au sud, et à l’ouest il est ouvert jusqu’aux côtes de l’Amérique. À son âge les nuits sont courtes et parfois vite interrompu par la mélancolie.
Minuit ouvre la réflexion, celle que provoque la situation d’être « enveloppé dans les ténèbres. » La contemplation de la nuit en une belle insomnie s’ouvre à plusieurs résonnances de majuscules. La frayeur fait face à la contemplation et déjà à une sensation de bercement. Le Cosmos, l’Univers, la Vie, l’Être, le Mal déjà évoqué et la Mort introduite comme un « Ouvert » : « La Mort est un Ouvert ; elle donne accès à la transformation » (p. 27).
La méditation nocturne conduit une prose poétique qui ouvre la porte d’une cosmologie accueillante de notre propre passage dans la mort. On peut confier ces pages à tous ceux qui abordent la foi chrétienne en s’interrogeant librement sur l’au-delà, déplaçant alors vers l’univers l’imagerie première du « ciel », cette formulation consolatrice de notre enfance. L’universel de la Mission vise l’unité du genre humain tout autant que ce dont peut nous instruire la connaissance des origines de la vie dans le vaste mouvement astronomique de l’univers !
La seconde partie débute par ce basculement de la voûte céleste vers les premières lueurs qui annoncent l’inéluctable fin de la nuit. « La lune décline. La Voie lactée se voile de brume. Elle va, comme d’habitude, esquisser un geste plein de consentement pour accueillir l’aube qui vient ».
« Je suis toujours là, immobile, aux confins du Finistère qui est au bout de la terre d’Occident. Je sais que ce mouvement circulaire est valable aussi à l’échelle individuelle. Depuis ce point de l’Extrême-Occident, si j’avance vers l’océan, toujours en continuant, je finirai par arriver en Extrême-Orient, d’où, un jour bien lointain, j’étais venu, la boucle de mon destin aura été bouclée » (p. 43).
La prose poétique s’efface pour laisser place à une « confession » inédite de l’enfance chinoise du jeune Cheng. Ces pages d’autobiographie me semblent uniques dans une œuvre tout en retenue (y compris les épisodes de son arrivée en France et son désir de rester dans ce pays et d’en accueillir la langue et la culture). L’éveil à la poésie saisit l’auteur en Chine dont le désordre épargne l’adolescent de 15 ans : « Chante et tu seras sauvé, et tout sera sauvé » (p. 49). Nous connaissons ces témoignages troublants de la découverte mystique et poétique du beau au cœur de l’immonde des guerres et des outrances, Ici celle d’un chant cristallin. L’envie me prend d’interroger l’auteur pour savoir si ce chant ne serait pas un peu christique ! Cependant, ce ne serait pas respecter François Cheng qui ose cet acte de foi sans nommer le Christ, mais en lui rendant sa vérité – voire plus haut : « cette part invisible et transfigurante qui se prolonge au-delà de la mort ».
« Le poète créateur reçoit mission non seulement de dire, mais d’encourager toutes les âmes par son chant. Il ne doute pas que si les humains sont reconnaissants au Créateur de les avoir créés, le Créateur, lui, sait gré aux humains de prendre en charge les épreuves que comporte l’aventure de la Vie » (p. 50).
La confession ouvre la mémoire de celui qui vient « d’un pays héritier d’une poésie ininterrompue depuis trois mille ans » et découvre en « Occident latin la grande tradition orphique inaugurée par Dante » (le mythe d’Orphée qui chante l’amour au-delà de la mort de l’être aimée, au point de chercher à la rejoindre dans cet au-delà.) Cette découverte, une fois maîtrisée la langue française, retourne l’auteur vers la Chine ! Un éclair de cohérence surgit : « La voie du Tao et la voie orphique ne font qu’une en moi » (p. 61).
La prose s’éteint alors pour laisser la poésie livrer sur plusieurs pages de « purs poèmes », certains inédits !
Il reste à la confession de s’exprimer librement : « J’avoue que je suis un être labouré de remords … C’est l’Être même qui en détient le don (de l’amour absolu) seul capable de tout racheter. » .
Le jeune Chinois est devenu un vieux sage. Il est surtout en cette aube, redevenu dans la foi, le fils prodigue de l’Évangile !
La nuit s’achève, le flux de la vie remonte de la marée : « Il suffit qu’une seule âme demeure fidèle à sa mémoire, pour que rien ne soit perdu ». Puis l’auteur glisse dans l’élégance d’une ultime citation d’un autre, un adjectif pour qualifier cette mémoire : « dans l’immarcessible espace constellé du cœur. »
(J’ai consulté le dictionnaire). Immarcessible : qui ne peut de flétrir : De ces fleurs, comme des étincelles d’étoiles, qu’on offre à l’être aimée qui ne peut disparaitre de nos mémoires car, pour de tels amants, « l’éternité n’est pas de trop. »
En ce jours du printemps, 20 mars 2025, face à la Mer du Nord,
Hugues Derycke, membre de l’OFC