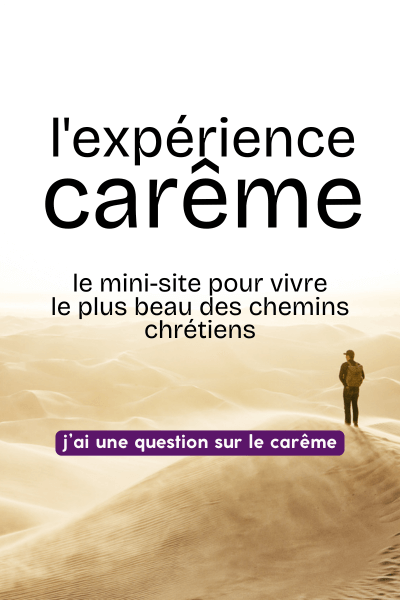Si petite de Frédéric Boyer
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 20 novembre 2024, n°39 à propos du livre Si petite de Frédéric Boyer (Gallimard 2024)
Voici un beau livre, court, juste, émouvant. Il y est question d’un infanticide et de la douleur des animaux ; il y est question de la délicatesse qui peut nous fuir ou bien par laquelle nous nous laissons émouvoir et agissons. Il y est question d’Ecommoy, dans la Sarthe, qui dispose tout à la fois d’un champ de courses, et de cette maison où souffrit une petite fille. Il y est question du mal, de ce qui fait mal, de ce qui terrasse et sidère, davantage que d’un sujet de réflexion.
Frédéric Boyer met en dialogue la « si petite », un cheval blessé, ses propres questions face au mal et le pouvoir de l’écriture. « Vaincu, je t’ai concédé, à toi qui es moi, que l’écriture était souvent pour moi cette forme de confession, peut-être complaisante, de ma douloureuse sensibilité et de mon impuissance devant le mal commis » p. 115. « J’ai voulu poser une voix sur le mal, ta voix d’enfant, en pensant que c’était peut-être le seul recours que m’offrait à moi la littérature. Et que le mal n’a d’autre poids pour finir que celui des mots qui l’interrogent » p. 117.
C’est bien le destin, si bref, si tragique de la « si petite » qui est au cœur de ces pages, que je reconstruis ici, mais qui ont leur poids et leur prix dans l’intrication des sujets et des questions. « Après l’avoir abandonnée à la naissance, sa mère s’est ravisée un mois plus tard, comme la loi l’y autorisait. Elle a dit qu’elle voulait bien finalement vivre avec le bébé pour leur donner à elle et lui une seconde chance. Qu’elle ne l’abandonnerait plus » p. 49.
« Entre avril et mai 2009, cette petite fille avait passé cinq semaines à l’hôpital du Mans. Elle ne grandissait pas ou mal. Manifestait ce qu’on a diagnostiqué paresseusement comme des retards » p. 57. « La petite a quitté l’hôpital au bout de cinq semaines d’un étrange repos, occupé de soins et d’examens qui n’auront jamais conclu à un diagnostic certain, pour finir par rentrer chez elle où elle eut à souffrir encore davantage » p. 58. « Des problèmes de croissance. Rien de préoccupant. Les services sociaux ont écrit noir sur blanc, dans des rapports qui seront, des mois plus tard, lus au procès des parents, qu’ils n’avaient décelé aucun danger immédiat dans l’entourage » p. 63-64.
« Après avoir battu à mort leur petite fille âgée de huit ans, avoir enfermé son corps inanimé dans le congélateur de la cave, le père l’a transporté jusqu’à un entrepôt de la banlieue du Mans, l‘a placé dans un conteneur de déménagement, et puis a coulé plusieurs kilos de béton pour l’ensevelir. Enfin, ils ont emmené le lendemain ses quatre frères et sœurs visiter la baie du Mont-Saint-Michel, comme promis, et manger des moules et des crêpes dans un petit restaurant animé et bon marché de bord de route.
Le soir en rentrant, alors qu’un ciel d’août étoilé et brillant venait d’être jeté sur les épaules du monde, les parents ont prévenu les gendarmes de la disparition de la petite » p. 111-112.
« On se sent toujours coupable lorsque nos chers parents ne nous ont pas transmis dans notre enfance la certitude non seulement d’être aimés mais aussi de notre bon droit à l’être […].
La plus jeune sœur de la petite a confié au juge qu’elle attendait certains soirs que le croque[1]mitaine s’endorme pour descendre l’escalier noir de la cave où l’on envoyait dormir sa sœur, et apporter à la petite la peluche à laquelle elle n’avait pas eu droit pour la nuit, qu’elle passait là, seule sur un matelas dans la cave de la maison, près du congélateur » p. 69-70.
« Les parents n’ont pas su expliquer pourquoi elle était devenue leur souffre-douleur, si ce n’est, ont-ils répété, que la petite avait souvent faim » p. 78.
Au fil des pages, l’auteur formule ses interrogations au sujet du mal dont ce crime est une expression affreuse et révoltante. Mais, le faisant, cherchant à comprendre le mal, ne risque-t-on pas de lui trouver des raisons, voire des justifications ? « Quelqu’un m’a expliqué récemment, et je t’ai demandé d’y réfléchir, qu’il était peut-être préférable de ne pas tenter de comprendre le mal parce que cela signifiait sinon l’affronter du moins reconnaître et admettre sa présence, non seulement parmi nous mais en nous […]. Si l’on veut bien admettre que toute compréhension mobilise en nous une forme d’empathie, de participation à la chose comprise » p. 40.
Pourtant, ne rien dire, ne pas chercher, c’est là où l’on entre dans une forme d’acceptation, encore plus intolérable. « J’aurais aimé me penser comme celui que le mal n’atteignait pas. Tu m’as dit le mal est ; c’est ce qui est là. Et il est ce qu’il est parce que nous sommes. Chacun d’entre nous et collectivement. C’est déjà beaucoup d’admettre que sans nous le mal ne serait pas. Qu’il ne serait pas là. Il n’y a pas d’autre mal que là où nous sommes ; pas d’autre mal que celui que nous faisons aux autres et à nous-même, ou que nous laissons faire. Je n’en suis toujours pas certain. Est-ce que le mal n’est pas une force qui nous préexiste ? Qui viendrait d’où ? Me demandes-tu. Ou n’est-ce que l’encombrant bagage que l’humanité trimbale avec elle depuis ses commencements obscurs. Depuis qu’elle est là. Chacun d’entre nous, tout au fond de lui, en porterait sa part » p. 17-18.
« Nous participons au mal de différentes et parfois d’invisibles façons. Et parfois même (et surtout ?) en ne faisant rien, en ne bougeant pas, en refusant d’accepter ou d’entériner la franchise terrifiante de l’acte. Et aussi en n’y pensant pas, jamais. Par oubli et par omission. Par peur. Par ignorance ceci. Je me suis dit ça se joue parfois à des détails si minuscules. Je me demandais à partir de quand ou de quoi devient-on complice. Et si être complice était aussi grave que de commettre l’acte lui-même, sur une échelle de jugement que je ne pouvais établir » p. 19.
« Il faudrait écrire avec le plus de douceur possible que cette vie abominable de la si petite a été une vie humaine qui, comme toutes les vies humaines, a réclamé notre attention. Une vie qui n’est pas la nôtre et ne le sera jamais, mais qui pourtant est devenue nôtre. Parce que renoncer à cette égalité-là, des vies humaines entre elles, ce serait renoncer à la dignité d’être en vie les uns parmi les autres » p. 106.
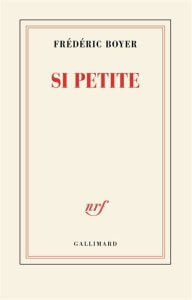
Dans le destin d’une personne, ici, fragile, presque invisible, se joue le destin de l’univers. Etre insensible à une chose, c’est l’être à tout. Et Frédéric Boyer, s’il ouvre son livre par la mort d’un cheval sur un champ de courses, nous interroge sur ces aveuglements, et même ces hiérarchies entre ce qui aurait plus ou moins d’importance, qui, sous prétexte qu’elles sont, entretiennent en nous des aveuglements et des surdités coupables. « Je t’ai demandé pourquoi je tenais tant à revenir là-dessus aujourd’hui. Depuis j’ai lu avec le même effroi tant d’autres histoires similaires. Mais tout se passait comme si cette histoire-là, de la petite, m’avait été adressée personnellement. Est-ce qu’il y a un sens à tout cela ? » p. 23.
« Avant la course, tous les chevaux ont la même grimace humaine étroite qui leur fait montrer les dents jusqu’aux gencives. Une hilarité tragique. Les plus jeunes paraissent vieux. Les plus doux sauvages. Et les plus forts si faibles. Ils doivent éviter le moindre contact avec les autres chevaux. Autour d’eux, les hommes y veillent avec un soin jaloux. Les chevaux sentent la nervosité et l’excitation des hommes qui les ont fait naître et qui les sont élevés et dressés pour se battre en courant » p. 101.
Alors, silence de Dieu ? Absence ? Impuissance ? « L’absence du Dieu, c’est depuis longtemps l’absence dans laquelle nous abandonnons les autres. Pour les entendre, il faut déposer sa voix sur leur silence. Pour les entendre, il faut que nos larmes ceignent leur silence comme un châle transparent qui fait apparaître la voix inaudible de leur souffrance. C’est ainsi que Dieu répond aux larmes d’Agar » p. 119-120
Pascal Wintzer, OFC
ca peut aussi vous intéresser

Nul amour entre tes griffes à propos de Triste tigre de Neige Sinno (POL, 2023)
Fiche de l'Observatoire Foi et Culture du 25 octobre 2023, n°40 à propos du livre Triste tigre de Neige Sinno (POL, 2023)