Maurice Bellet, Dieu, personne ne l’a jamais vu
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture (OFC) du mercredi 7 mars 2018 : Maurice Bellet, Dieu ne l’a jamais vu suivi de : Essai sur la violence absolue.
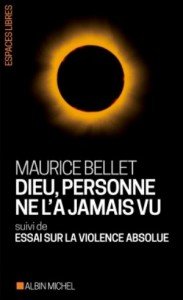 On pourrait croire que cet essai vient d’être écrit à la lumière de l’état présent du monde. Maurice Bellet y explore la place centrale, dans la civilisation et dans le christianisme, de ce qu’il nomme la violence absolue. C’est une suite et une amplification d’un essai très remarqué, Le dieu pervers.
On pourrait croire que cet essai vient d’être écrit à la lumière de l’état présent du monde. Maurice Bellet y explore la place centrale, dans la civilisation et dans le christianisme, de ce qu’il nomme la violence absolue. C’est une suite et une amplification d’un essai très remarqué, Le dieu pervers.
L’analyse des rapports entre le christianisme et la violence s’encadre ici dans une réflexion globale sur la violence destructrice de soi-même comme menace mortelle pour l’humanité : le destin de l’humanité est d’être un animal qui a transgressé la condition animale, abandonné une régulation inscrite en lui. Du coup, « l’être humain doit créer ce qui lui permet de se supporter d’exister ». Car il est exposé « au risque d’un déchaînement pulsionnel incontrôlé ».
Pendant très longtemps, l’humanité fut protégée de cet excès par ce que l’auteur appelle « un humus humain ». Celui-ci est menacé et la conséquence est la possibilité d’une violence formidable. Maurice Bellet décrit deux formes solidaires de la violence. D’un côté, il y a la violence pure qu’on peut définir, non comme contenu, mais comme relation : « c’est qu’une relation humaine est, en même temps, ténèbres de l’inhumain ». De plus, cette relation destructrice est « volonté de destruction qui devient jouissance de la destructibilité de l’autre ». Dans cette relation, l’autre n’existe plus.
Cette violence peut devenir absolue. Alors celui qui exerce la violence n’en est pas conscient – c’est possible. Il se croit bon père, bon éducateur. Un degré de plus et « la victime peut ignorer qu’elle l’est » car les séducteurs font du bien. Cette violence absolue, au nom même de la vie, donne la mort. Elle « prétend protéger de la violence ». Elle vise à se confondre avec « ce qui donne l’assurance première ». Elle est difficile à démasquer car elle est comme « un virus mutant » capable de se transformer et ainsi de réussir à faire que cela même qui lutte contre la violence est contaminé par elle : l’amour universel devient justification de l’horreur invisible à ceux qui la subissent2.
À ce point de l’analyse vient une question très légitime : en quoi le christianisme est-il concerné par la violence absolue ? À l’opposé des chrétiens qui se demandent comment introduire le Christ dans notre monde, Maurice Bellet nous invite à un constat : en fait, à travers la culture et l’histoire, le christianisme est pesamment présent dans notre monde, il s’agit de reconnaître comment, et de voir les relations qui existent entre la figure du Christ et la violence.
Sans nier, au contraire, la présence de la violence dans l’histoire religieuse, Maurice Bellet développe l’idée que dans l’inconscient historique qui nous habite, le Christ est la figure même de l’insoutenable car il dévoile la présence en l’humanité de la violence absolue. Or, cette présence, nous ne voulons pas la voir.
« C’est comme si cet homme-là, si loin de nous, si proche, avait osé ôter la dalle qui recouvrait le puits, cette dalle que toutes les sagesses ont précieusement gardée et préservée parce qu’en dessous est la Violence infinie, terreur des humains. Il a ôté cette pierre et il est lui-même descendu – en bas » (p. 147).
Cette vérité est proprement insoutenable, impossible de reconnaître qu’il y a, en l’homme cette violence et que l’homme en soit l’auteur. Du coup pour refuser cette origine en elle-même, l’humanité va l’attribuer au
Christ lui-même. C’est le christianisme lui-même, pas seulement ses formes perverties, qui est donc désigné comme origine de la violence absolue. L’image est inscrite dans notre culture : « Le Christ est l’apparition de la violence absolue » (p. 157). Celui qui soulève la dalle mettant au jour l’humanité comme origine de la violence absolue suscite contre lui-même une telle haine, que non seulement on lui attribue ce qu’il dévoile, mais qu’il faut le mettre à mort.
Bref, celui qui vient ouvrir l’abîme de cet instinct de mort suscite une fureur terrifiante, fureur tournée vers lui et qui veut sa mort. Réduire le Christ à cela, n’est-ce pas un terrible contresens ? Notons ici la spécificité du récit développé par Maurice Bellet ; à l’opposé d’une analyse répandue, il n’attribue pas la résistance de notre monde au message évangélique à des obstacles sociaux ou culturels qui conditionneraient les personnes contre la foi. Il lit le rejet du Christ comme lié au sens de son message. Mais on situera ici le tournant majeur du récit : « le sens du récit qui nous donne accès à ce qu’est le Christ, est-il possible de le réduire à cette figure de la violence absolue ? » « N’est-ce pas un contresens fondamental que de confondre le lieu d’enfer où le Christ ose descendre et ce qu’il y fait ? »
Pour réduire ce contresens Maurice Bellet nous invite à faire retour vers le récit lui-même. Celui-ci dit que le Christ vient pour libérer l’humanité de l’emprise de la violence absolue. Pour accomplir cette mission, il
affronte la violence en allant au coeur même de la violence. Du coup, il révèle et réveille l’ampleur de cette violence : « l’en bas est réveillé » apparaît la possibilité « d’une ténèbre originelle » qui voue l’homme à n’être que terreur, « fureur d’être né » (p. 183). La présence du Christ révèle son contraire, comme si elle faisait vivre la violence… mais c’est pour la vaincre.
Or, en ce lieu, au coeur de la violence absolue, se produit précisément l’événement qui met fin à sa puissance. C’est un retournement que l’auteur décrit avec force. Par-delà la violence absolue advient : « le Logos de vérité, Logos devenu chair, capable d’ôter en toute raison ou sagesse l’œuvre du virus de mort » (p. 183). « C’est comme une implosion… ». L’horreur du sacrifice a fondu dans l’unité du Père et du Fils ; « le fond de Dieu, à travers l’impensable Nuit traversée, est une pure présence de miséricorde » (p. 184). Agapè règne là où c’était la violence absolue.
À partir de ce moment du récit, l’auteur voit une décision inévitable : ou bien, aujourd’hui, dans notre monde, ce récit n’a plus rien à nous dire ; ou bien, nous devons chercher quel peut être le sens de « l’implosion » dans notre monde, lieu manifeste de la violence absolue. L’auteur se hasarde alors à formuler un sens pour nous. Qu’en est-il du Christ pour nous ? On est renvoyé à une décision : « le primordial et ultime interdit est celui de la Violence » (p. 195). Et ce choix « coïncide avec le don qui est fait à l’être humain d’être accueilli, reconnu, accepté comme présence et sujet d’une parole bonne à écouter » (p. 194). Le choix est celui du « très primordial pouvoir être. » C’est un éveil, qui n’est possible que si naît l’exigence d’une affirmation élémentaire de l’humanité…
L’auteur est conscient de la fragilité des paroles qu’il ose dans la dernière partie, autour de l’éveil, son lien au corps, la « désillusion de la désillusion », « la relation première qui délivre de la faute d’exister » ; la force d’aller dans l’en bas sans y être englouti ; le vœu de présence en amont du désir ; la conscience de nos manques.
Ces pages sont animées d’une lucidité superbe, sur l’impuissance : « Peut-être faut-il tenir en ce paradoxe : plus une parole s’approche de l’extrêmement absolu, plus elle est impuissante. C’est à dire que ce qu’elle porte de vérité (si tel est son cas) ne peut naître qu’en celui à qui elle parle, de son propre fond, hors de prise, de savoir, de méthode, de tout ce qu’on voudra » (p. 244).


