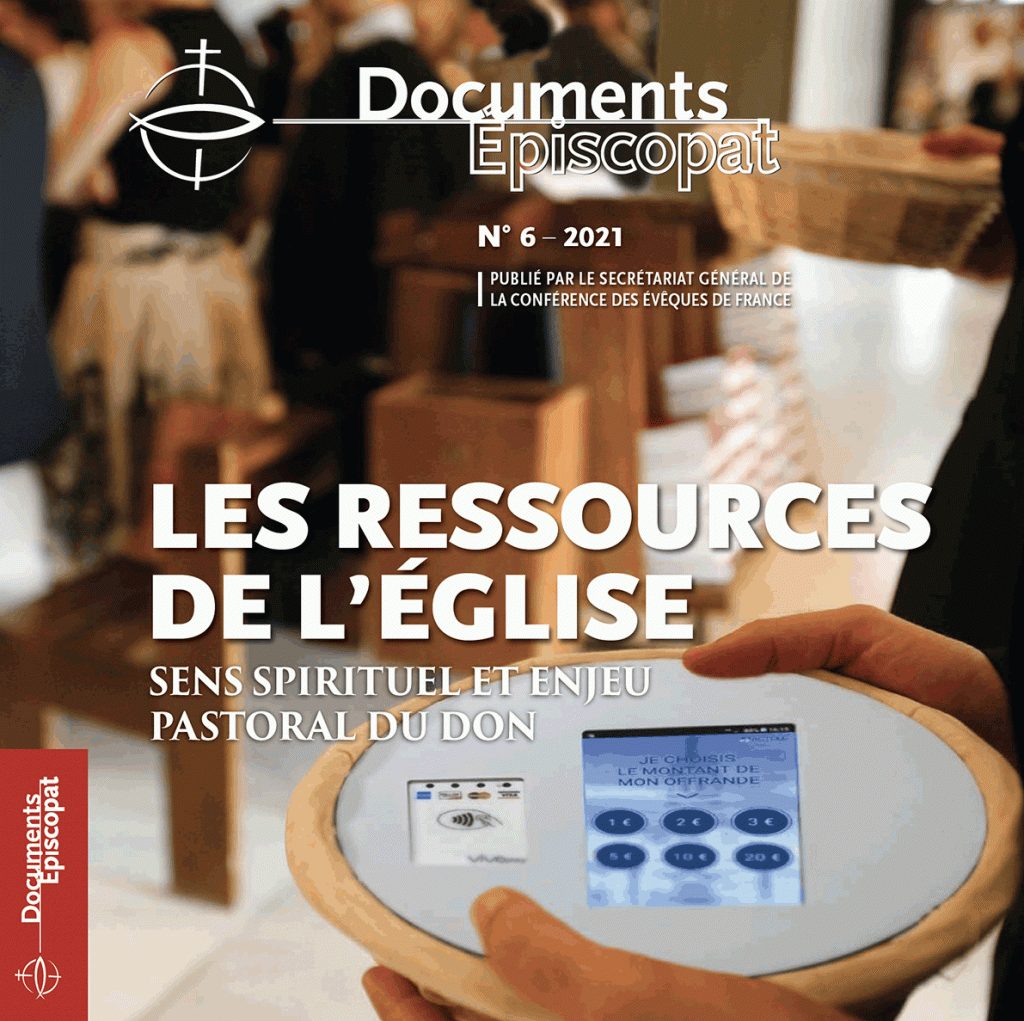Quel est le sens spirituel du don au Denier de l’Eglise ?

Le denier est l’occasion de rappeler que tout don porte en lui un sens spirituel fort pour les chrétiens qui reconnaissent qu’ils ont tout reçu de Dieu : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir », dit Saint-Paul (Ac 20,35). Le père Marc Rastoin, sj, explique l’enracinement théologique du denier de l’Église.
Depuis le livre de la Genèse, on parle de la dîme : « Quand Abram revint après avoir battu Kedor-Laomer et les rois qui étaient avec lui… Melchisédech, roi de Shalem, apporta du pain et du vin : il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction : « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, qui créa le ciel et la terre et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains . Et Abram lui donna la dîme de tout. » (Gn 14,17-21 ). De même c’est Jacob qui rend grâce à Dieu et lui dit : « De tout ce que tu me donneras, je te paierai fidèlement la dîme ». (Gn 28,22)
C’est pourquoi Jésus a admiré la pauvre veuve qui versait deux piécettes dans les troncs du Temple (cf. Mc 12,41-44). Elle unissait ainsi, en un seul acte, amour de Dieu et du prochain. Il y avait plusieurs troncs dans le Temple et Jésus ne précise pas duquel il s’agit. Mais peu importe, c’est l’attitude fondamentale de don, qui rejoint la sienne, qui le frappe. Luc a voulu mettre toute la vie de Jésus, tout l’Évangile, dans cette maxime. Elle ne nie pas l’importance du recevoir mais accorde une priorité quasi ontologique au don. C’est un postulat anthropologique et théologique radical.
Pour Paul, dès le début, les échanges financiers font partie de la nature de l’Église. Le partage concret des ressources appartient à la nature même de l’Église. L’universalité de l’Église se traduit dans un partage des biens : Jésus est mort pour tous. Ainsi la quête dit quelque chose d’essentiel à ce qu’est l’eucharistie. Impossible de se souvenir du Christ sans se souvenir des pauvres, des saints qui sont à Jérusalem, des chrétiens vivants dans des communautés moins riches qu’à Corinthe ou Thessalonique. Et d’ailleurs, mêmes pauvres, il faut donner quand même avec générosité !.
Rappelons enfin que cette contribution est à la fois conforme au droit canonique et au droit civil. Le canon 222 § 1 dispose, en effet, que « les fidèles sont tenus par obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité, à l’honnête subsistance de ses ministres ».
Dans l’Ancien Testament, la dîme correspond à un merci et à une action de grâce.
La communion spirituelle ne peut être séparée de la communion matérielle et Jésus va développer cette conviction : c’est par le don que l’on acquiert la vie (cf. Tobie 4,7b-10 et 12,7-9).
Jésus dénonce le simple acte en l’absence de signification humaine et spirituelle : « Malheur à vous les pharisiens, qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de toute plante potagère, et qui délaissez la justice et l’amour de Dieu ! Il fallait pratiquer ceci, sans omettre cela. » (Lc 11,42) Nous voyons bien que Jésus nous pousse à aller plus loin !
Saint Paul développe cette dimension spirituelle du don dans ses lettres : « Que celui qui reçoit l’enseignement de la Parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l’instruit (Galates 6-6) », ou encore « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter des biens matériels ? (1 Corinthiens 9,10-14) ».
Le discours de Paul aux anciens de l’église d’Éphèse se conclut ainsi : « Souvenez-vous de ces paroles que le Seigneur Jésus lui-même nous a dites : ‘Heureux le donner plus que le recevoir !’ » (Ac 20,35). ….Toute la vie de Jésus est sous le signe du don : le don concret financier aux pauvres et le don de soi, le don de sa personne, qui ne doit pas en être séparé.
Extrait de l’intervention du Père Marc Rastoin, sj, le 9 octobre 2019 à l’occasion d’une journée consacrée au Denier