Un peuple et son roi de Pierre Schoeller
Fiche de l’Observatoire Foi et culture (OFC) n°35 du mercredi 7 novembre sur Un peuple et son roi, de Pierrre Schoeller, 2018.
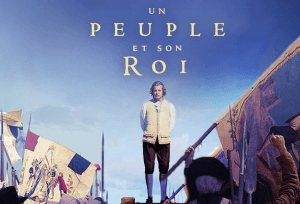 Avec Un peuple et son roi, Pierre Schoeller réussit une brillante immersion dans les années phares de la Révolution française (1789-1793), mais le voyage se fait au prix d’une certaine partialité idéologique. Le cinéma français ne s’approche finalement qu’assez rarement de la Révolution française, et quand il le fait il ne parvient pas toujours à se l’approprier. Cette période, fondatrice de tous les enjeux politiques et constitutionnels de la France contemporaine, condense une telle foule d’événements et de nuances idéologiques qu’il paraît impossible de la traiter en lui rendant justice. A titre d’exemple, la seule question religieuse qui, de la Constitution civile du clergé (1790) au Concordat (1801), est centrale, reste très difficile à saisir. Le pari de Pierre Schoeller (réalisateur de l’excellent Exercice de l’Etat, 2011) de condenser les riches années 1789-1793 en deux heures de film semblait donc bien périlleux. Pourtant, le cinéaste parvient à restituer, avec beaucoup de justesse, l’esprit de la Révolution. Fidèle à son approche réaliste et sans emphase, Schoeller fait preuve d’un sens historique frappant sur de nombreuses séquences. On sent qu’il y a derrière le film un travail de recherche impressionnant, avec l’assimilation de l’historiographie récente (les noms de Timothy Tackett, Guillaume Mazeau, Arlette Farge apparaissent au générique en tant que conseillers). Jamais sans doute la vie du peuple des faubourgs de Paris n’avait été portée à l’écran avec autant de vérité : promiscuité des logements, mortalité infantile, chansons populaires, etc. Avec un art de l’ellipse très maîtrisé, le récit choisit de s’arrêter sur certains moments clés (la prise de la Bastille, la marche des femmes d’octobre 1789, la fuite à Varennes, la prise des Tuileries) et d’en évacuer d’autres (la réunion des États généraux, le serment du Jeu de Paume, la nuit du 4 août 1789, les massacres de septembre 1792) sans que cela soit préjudiciable à cette chronique de la Révolution. C’est aussi par de belles idées de cinéma que ces événements choisis sont restitués : la lumière du jour qui pénètre pour la première fois dans les faubourgs grâce à la destruction de la Bastille ; la fête de la Fédération (1790) vue non pas depuis le Champ de Mars mais dans un petit village où l’on plante un arbre de la liberté ; les grandes figures historiques relayés au rang de second rôle afin de privilégier des héros plus ordinaires, etc. Mais si Schoeller réussit à faire un grand film de cinéma sur la Révolution, c’est peut-être parce qu’il est très partial. Là où Jean Renoir, fidèle à sa maxime « tout le monde a ses raisons », visait à l’œcuménisme et manquait le sien (La Marseillaise, 1938), Pierre Schoeller choisit clairement un point de vue très robespierriste et livre un grand film. Il faut sans doute se résoudre à ce qu’un film sur la Révolution soit partisan et partial pour être réussi. Le Danton de Wajda (1982) en poussant très loin l’analogie entre la Terreur et le totalitarisme, donnait une lecture outrée des événements mais constituait un chef d’œuvre. Le Napoléon de Gance (1927), avec ses fulgurances hugoliennes, donnait une interprétation mystique de l’esprit révolutionnaire, trop lyrique et hostile au peuple pour être juste, mais sublime cinématographiquement. A l’inverse La Révolution française (1989), commande d’État au moment du bicentenaire, qui se voulut neutre, strictement historique, et pédagogique, n’a que peu d’intérêt en termes de cinéma pur.
Avec Un peuple et son roi, Pierre Schoeller réussit une brillante immersion dans les années phares de la Révolution française (1789-1793), mais le voyage se fait au prix d’une certaine partialité idéologique. Le cinéma français ne s’approche finalement qu’assez rarement de la Révolution française, et quand il le fait il ne parvient pas toujours à se l’approprier. Cette période, fondatrice de tous les enjeux politiques et constitutionnels de la France contemporaine, condense une telle foule d’événements et de nuances idéologiques qu’il paraît impossible de la traiter en lui rendant justice. A titre d’exemple, la seule question religieuse qui, de la Constitution civile du clergé (1790) au Concordat (1801), est centrale, reste très difficile à saisir. Le pari de Pierre Schoeller (réalisateur de l’excellent Exercice de l’Etat, 2011) de condenser les riches années 1789-1793 en deux heures de film semblait donc bien périlleux. Pourtant, le cinéaste parvient à restituer, avec beaucoup de justesse, l’esprit de la Révolution. Fidèle à son approche réaliste et sans emphase, Schoeller fait preuve d’un sens historique frappant sur de nombreuses séquences. On sent qu’il y a derrière le film un travail de recherche impressionnant, avec l’assimilation de l’historiographie récente (les noms de Timothy Tackett, Guillaume Mazeau, Arlette Farge apparaissent au générique en tant que conseillers). Jamais sans doute la vie du peuple des faubourgs de Paris n’avait été portée à l’écran avec autant de vérité : promiscuité des logements, mortalité infantile, chansons populaires, etc. Avec un art de l’ellipse très maîtrisé, le récit choisit de s’arrêter sur certains moments clés (la prise de la Bastille, la marche des femmes d’octobre 1789, la fuite à Varennes, la prise des Tuileries) et d’en évacuer d’autres (la réunion des États généraux, le serment du Jeu de Paume, la nuit du 4 août 1789, les massacres de septembre 1792) sans que cela soit préjudiciable à cette chronique de la Révolution. C’est aussi par de belles idées de cinéma que ces événements choisis sont restitués : la lumière du jour qui pénètre pour la première fois dans les faubourgs grâce à la destruction de la Bastille ; la fête de la Fédération (1790) vue non pas depuis le Champ de Mars mais dans un petit village où l’on plante un arbre de la liberté ; les grandes figures historiques relayés au rang de second rôle afin de privilégier des héros plus ordinaires, etc. Mais si Schoeller réussit à faire un grand film de cinéma sur la Révolution, c’est peut-être parce qu’il est très partial. Là où Jean Renoir, fidèle à sa maxime « tout le monde a ses raisons », visait à l’œcuménisme et manquait le sien (La Marseillaise, 1938), Pierre Schoeller choisit clairement un point de vue très robespierriste et livre un grand film. Il faut sans doute se résoudre à ce qu’un film sur la Révolution soit partisan et partial pour être réussi. Le Danton de Wajda (1982) en poussant très loin l’analogie entre la Terreur et le totalitarisme, donnait une lecture outrée des événements mais constituait un chef d’œuvre. Le Napoléon de Gance (1927), avec ses fulgurances hugoliennes, donnait une interprétation mystique de l’esprit révolutionnaire, trop lyrique et hostile au peuple pour être juste, mais sublime cinématographiquement. A l’inverse La Révolution française (1989), commande d’État au moment du bicentenaire, qui se voulut neutre, strictement historique, et pédagogique, n’a que peu d’intérêt en termes de cinéma pur.
La partialité du film s’explique par le choix d’épouser pleinement le point de vue du peuple des faubourgs parisiens. On s’étend donc sur le massacre du Champ de Mars (juil. 1791) mais les massacres de Septembre (sept. 1792), pourtant plus meurtriers sont évacués avec légèreté. Le point de vue du roi n’est jamais vraiment pris en compte et ses motivations restent obscures. On présente la « trahison » de Varennes (juin 1791), sans montrer le contexte qui l’amène : constitution civile du clergé, famille royale dont la liberté et la puissance exécutive étaient sans cesse niées. Par ailleurs, on ne voit jamais le peuple des faubourgs, qui est unanimement héroïsé, verser le sang injustement (le cinéma avait peut-être jusqu’ici trop abusé des scènes de déchaînement populaire et de têtes accrochées sur des piques). La noblesse est également un bloc qui dès l’été 1789 semble s’opposer à la Révolution, alors que ce sont des députés de la noblesse qui ont été au premier plan lors de la nuit du 4 août, au cours de laquelle les privilèges furent abolis. C’est donc bien la vision de la Révolution des sections les plus radicales de Paris, ceux qui en 1793-1794 seront appelés les Enragés, que le film présente. Néanmoins, il faut reconnaître à Schoeller le souci de montrer qu’il existait d’autres visions tout autant respectables par quelques personnages bien croqués : un député qui, en quelques phrases fidèles à la pensée de Montesquieu, défend la nécessité d’un équilibre entre l’exécutif et le législatif ; un homme du peuple qui refuse de signer un appel à la déchéance du roi par crainte de l’anarchie ; une femme du peuple qui juge la condamnation de Louis XVI sacrilège. Cette sacralité de la personne royale est par ailleurs fort bien dépeinte – le film s’ouvre par une scène de lavement des pieds à Versailles.
On apprécie en revanche le rôle du curé de campagne tenu par Stéphane de Groodt qui rappelle que le bas clergé se tenait du côté de l’édifice révolutionnaire, dans ses débuts (la scène se déroule en 1790). La religiosité des différents personnages est par ailleurs un élément que le film traite très bien. L’insurrection populaire se fait d’abord au nom de Dieu et la pratique populaire reste vive (cela est tout à fait juste puisque la période de déchristianisation révolutionnaire débute seulement à l’automne 1793). Un peuple et son roi étant un film s’appuyant sur un grand nombre de personnages, l’interprétation est l’une des clés de sa réussite. Or, elle est d’une très grande qualité : Adèle Haenel est sublime en femme du peuple, elle irradie toutes les scènes où elle apparaît. Olivier Gourmet, incarnant un maître verrier, est, comme toujours, parfait. Laurent Lafitte incarne un Louis XVI qui reste une énigme, ce qui est très judicieux, avec une présence imposante. Dominique Lavant est un Marat très convaincant, même s’il n’égale pas celui d’Antonin Artaud dans le Napoléon de Gance. Enfin, le Robespierre campé par Louis Garrel, mélange de timidité, de froideur, et de rigueur intellectuelle, constitue plutôt une bonne surprise. Un peuple et son roi s’appuie sur un travail d’orfèvre, des costumes à la lumière, et prouve qu’avec un budget relativement modique (16 millions d’euros, là où les américains auraient disposé du triple), les Français excellent dans le cinéma historique. Si l’on regrette donc la partialité idéologique de cette vision de la Révolution, un spectateur averti ne pourra qu’en apprécier la maestria.
François Huzar

