Michel Deguy (1930-2022)
Fiche de l’Observatoire Foi et culture (OFC) du mercredi 29 juin 2022 à propos de Michel Deguy.
Ce que ça coûte d’écrire, comme vous dites, vous ne le soupçonnez pas, le taedium, l’endurance du jeûne. Tristesse, te voici. Je te reconnais à la lisière de l’orage avec tes habits de Sologne. Oui, l’humeur vague où vous baignez je la crispe en paroles ; mes yeux sur vos épaules pour vous aviser : une certaine attention que vous n’apprîtes pas, et c’est pourquoi la sourde déception vous entoure souvent.
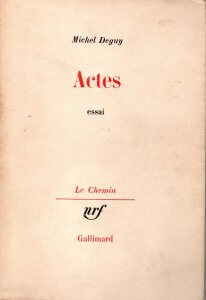 Ainsi commence, dans Actes (1966)1, une des plus belles pages du poète Michel Deguy, mort à Paris le 16 février dernier, à 91 ans. Celui-ci laisse une œuvre considérable, diverse, inventive, mais exigeante et difficile, à mille lieues de toute complaisance. L’homme avait plusieurs casquettes : philosophe (un heideggérien subtil), universitaire (Vincennes puis Saint-Denis), essayiste, et volontiers polémiste, lecteur chez Gallimard pendant 25 ans, directeur de revue pendant 45 ans (Po&sie, qu’il avait créée en 1977) et même éditeur (la collection « L’Extrême contemporain » chez Belin). Si ces tâches le placèrent au cœur du petit monde de la poésie – où il joua un rôle stratégique de médiateur, facilitant les rencontres, aidant les jeunes talents – et lui donnèrent aussi mainte occasion d’y être fêté par ses pairs (colloques, hommages, prix), j’ai voulu suggérer, d’abord, qu’il était, avant tout, un écrivain de la solitude, un poète « en temps de détresse », comme jadis Hölderlin ou Baudelaire, ou « la mauvaise conscience de son temps », comme disait Saint-John Perse2.
Ainsi commence, dans Actes (1966)1, une des plus belles pages du poète Michel Deguy, mort à Paris le 16 février dernier, à 91 ans. Celui-ci laisse une œuvre considérable, diverse, inventive, mais exigeante et difficile, à mille lieues de toute complaisance. L’homme avait plusieurs casquettes : philosophe (un heideggérien subtil), universitaire (Vincennes puis Saint-Denis), essayiste, et volontiers polémiste, lecteur chez Gallimard pendant 25 ans, directeur de revue pendant 45 ans (Po&sie, qu’il avait créée en 1977) et même éditeur (la collection « L’Extrême contemporain » chez Belin). Si ces tâches le placèrent au cœur du petit monde de la poésie – où il joua un rôle stratégique de médiateur, facilitant les rencontres, aidant les jeunes talents – et lui donnèrent aussi mainte occasion d’y être fêté par ses pairs (colloques, hommages, prix), j’ai voulu suggérer, d’abord, qu’il était, avant tout, un écrivain de la solitude, un poète « en temps de détresse », comme jadis Hölderlin ou Baudelaire, ou « la mauvaise conscience de son temps », comme disait Saint-John Perse2.
Avec les poètes de sa génération – ceux qui publièrent leurs premiers livres après-guerre ou dans les années 50 – Deguy accompagna ce grand mouvement de retour aux choses qui s’était amorcé, en réaction au surréalisme, avec Ponge, Follain, Guillevic et d’autres. Il s’agissait de revenir au réel, à l’être, et souvent à travers un attrait renouvelé pour la nature ; mais pas seulement : si ses premiers recueils disent la volonté
d’arpenter à nouveaux frais l’espace de la terre – Fragment du cadastre, Poèmes de la presqu’île, Biefs –, Deguy renouait aussi avec le voyage, le goût des larges horizons des Larbaud, Cendrars, Claudel ; et le monde ainsi perçu dans sa diversité foisonnante, certes rapetissé par la vitesse, a pu fonder peu à peu une conscience géopétique, voire écopoétique, à l’image d’un de ces derniers livres, Écologiques (2012). Mais Deguy n’était pas homme à choisir entre les choses, entre les phénomènes à sauver : il voulait tout, observait tout, avec cette même « attention » dont il parlait : l’orage menaçant, un verre renversé, la « danse » des clients dans une boutique, l’enfer obèse de Disney-World, toutes les nuances du « corps à corps » des amants dans une chambre d’hôtel… « La circonstance est la muse3 », aimait-il à redire. Mais c’était pour lui un devoir, une mission : « Ce qui a lieu d’être / Ne va pas sans dire // Ce qu’on ne peut pas dire… / Il faut l’écrire4 ».
Cela passait par une refondation de la parole. Comme Jaccottet appelant dans sa jeunesse à une « nouvelle rhétorique », Deguy était en quête d’une rénovation, sinon d’une révolution stylistique, de l’écriture du poème. On sait qu’elle prit chez lui la forme d’une combinatoire parfois ardue, entre poèmes, proses, études critiques ou philosophiques, avec une tension singulière du dire sur tous les plans – sémantique, syntaxique, référentiel, etc. – qui a fait sa marque de fabrique, non sans hermétisme ni préciosité. Deguy s’attela à y définir inlassablement, à l’imitation de Valéry, sa poétique – un mot devenu bien vain aujourd’hui –, celle de la « figure généralisée », dominée par le mouvement de l’analogie, du voir-comme, qui favorise non plus la seule comparaison, mais la comparution des choses, dans la lumière d’un rapprochement neuf. « Ma vie / Le mystère du comme5 » : il faut voir dans ce mystère l’incarnation du réel inédit, inouï, dans une forme qui lui donne sens. « La croyance requise par l’œuvre d’art est croyance en la promesse d’un rapport du monde à sa figure6. »
La vertu que demande la poétique, « une poétique continuée par tous les moyens », Deguy l’aura appelée, dans un titre de 1998, « l’énergie du désespoir ». Elle ne laisse envisager aucun avenir heureux, mais sanctionne une mélancolie profonde ; car, sans parler des avant-gardes anémiées, la dernière modernité, aggravant les constats déjà amers de Rimbaud ou Mallarmé, par cette convocation apocalyptique des mots et des choses, trahit la nostalgie d’un monde irrémédiablement perdu. Comme le poète des Regrets, auquel il s’est identifié dans un recueil-charnière – Tombeau de Du Bellay (1973) –, Deguy se fait le témoin des ruines, d’un sentiment d’échec et d’abandon propre à l’histoire universelle, autant qu’à chacune de nos vies. Loin de réenchanter le monde, il se fait l’écho de son désenchantement, voyant partout les signes de sa fin, le « coup de dé- », comme il disait par jeu.
Ce dévoilement lyrique du manque et de la tristesse partout où nous passons, il en faisait un acte de vérité, de salubrité, propre à la « raison poétique ». La « responsabilité du grand art est de changer le passé en sa perte », ou encore « changer la “victoire” mythique en défaite historique », regarder l’homme, le seul vrai « monstre », en face 7. Un de ses combats obstinés était la lutte contre le culturel, ce réductionnisme idéologique dévastateur de la culture et de ses œuvres. Il ne cessait d’opposer l’image artistique, où s’incarne et s’apprivoise l’altérité du monde, aux désolantes séductions de l’image de marque (et de masse) médiatique, numérique, démagogique, idolâtrique, exacerbant le narcissisme collectif et le culte du même.
Il y avait en Deguy un pessimiste radical. « L’humanité est foutue », me confia-t-il un jour, en « un propos de table » (au restaurant chinois) qu’il ne voulait sans doute pas proclamer. Dans ses livres, une rationalité très droite, cartésienne ou kantienne, vient presque toujours corriger les élans prophétiques rageurs, les malédictions et les désolations assumées. Deguy reprend toujours le fil du concept, si par hasard il l’a laissé tomber… D’où le caractère frustrant de ses envolées interrompues, de ses ellipses ou de ses chutes manquées à force de dispersion, de complication, voire, disons-le, de dérive jargonnante. D’où peut-être aussi le faible succès de son œuvre auprès du (grand) public, quand elle ressemble à un chantier permanent, saturé d’allusions, de citations, de néologismes, où s’entassent et s’entrelacent italiques, guillemets, crochets, parenthèses, tirets, en une véritable orgie typographique bien faite pour épuiser le lecteur. Il aurait gagné à la rendre plus concise, moins répétitive, à mieux doser ses effets.
Tous ceux qui l’ont connu, même de loin, s’accorderont à reconnaître une personnalité rare. C’était un affectif, un instinctif. Il avait aussi une allure, une gueule (« Eddy Mitchell reçu à l’ENA » dixit Alain Borer d’après une photo). Des traits de familiarité spontanée traversaient son élégance bourgeoise, costume cravate et Ray-Ban finissaient par lui donner un air de parrain du milieu, et c’est sans doute une sorte de pudeur rentrée que compensait son histrionisme occasionnel8. Sa voix grave et grondante avait des accents merveilleusement imitables. Certes, il ne fallait pas trop attendre de lui, car sa générosité n’allait pas sans mesquinerie, sa franchise sans cachotterie, et, oui, il y eut des brouilles, des ruptures… « Nous nous faisons à tous un défaut si cruel », résumait-il, en un vers crypto-racinien dont il était très fier. Avec lui la communication n’était jamais rompue ; de même, il n’abandonnait jamais la partie, et ses formules les plus tranchantes (en apparence) avoisinaient les plus patientes circonlocutions, comme si les nœuds qu’il démêlait ne pouvaient jamais être tout à fait dénoués.
Parmi eux – et j’en terminerai par là – celui de son « peu de foi ». Michel Deguy, élevé dans la foi catholique, l’avait perdue. Marié à une femme très pratiquante, ayant donné une éducation chrétienne à ses enfants, il les accompagnait encore à la messe mais n’y récitait plus le credo. Dans un de ses ouvrages les plus secrets, Un homme de peu de foi (2002)9, il raconte comment, jeune encore, il quitta l’Église après qu’un prêtre lui eut tendu un piège en confession. Dans ses entretiens récents et passionnants avec Bénédicte Gorrillot, il réaffirme la radicalité de sa « décréance », un processus réfléchi, mûri : « un mouvement que j’appelle “lent”, “peu à peu10” » … Et pourtant, Deguy reste hanté par son ancienne foi : le biblique, le chrétien, psaumes et proverbes, symboles et paraboles, sont partout dans son œuvre, de même que les questions obsédantes du bien et du mal, de la victime, du pardon, de l’au-delà. Durkheimien raisonné, il savait la société structurée par le religieux : on lui doit d’avoir dirigé des volumes, qui ont fait date, sur René Girard ou sur Shoah de Claude Lanzmann (dont il était l’ami). Les catastrophes de l’histoire lui apparaissaient comme des confirmations torturantes d’un sens « forcément » apocalyptique. Dans son refus voltairien de la bigoterie, comme dans son aversion pour les replis communautaires, il appelait à « sortir du crime », à faire en sorte que le Bien ne soit « plus une “divinité adorée”, une révélation, mais la révélation banalisée, au-dedans de chacun11», ou encore à « déconstruire » la transcendance, « pourvu que ce soit savamment, subtilement12 ». Deguy ne voulait pas abandonner, ce qu’il nommait, avec un brin de provocation les « reliques » : « Où sont les précieuses reliques ? Dans la langue. Le religieux est ce qui reste quand on a tout oublié 13. » Il disait encore : « Il faut refonder sur l’Ecclésiaste – c’est-à-dire ne plus fonder 14», ou parlait sans cesse de « rendre ineffaçable le devenu incroyable » : comme si, une fois levé le dépôt de la foi, la valeur n’en était pas totalement perdue, et qu’il fallût veiller sur les restes d’un héritage – à portée esthétique, morale, intellectuelle, spirituelle – qui serait toujours à transmettre, avec lequel on n’en aurait jamais fini.
De ce « peu de foi », paradoxal comme une graine oubliée dans le sol du temps, un dernier exemple peut nous être donné par ce livre de deuil déchirant, À ce qui n’en finit pas (1995), thrène dédié à sa femme « disparue en mort » en 1994. Le poète y décrit ses derniers instants auprès d’elle, agonisante, dans la chambre d’hôpital : « notre dernier côte à côte gisants d’avant la mort ». Et de noter un peu plus loin cet énième adieu, qui, par-delà le désespoir, ouvre encore sur le mystère :
Je ne crois à aucune vie éternelle, nous ne nous retrouverons jamais nulle part, et c’est précisément ce défoncement du futur qu’aucun travail de deuil ne remblaiera en quoi consiste la tristesse, cette tristesse qui disparaîtra à son tour avec « moi ». Mais ces jours de tristesse sans fond dont les pages en parois de papier simulent une perspective sont la « vie future » où m’accompagne ton oubli : l’interminable brièveté changée en brève infinité fait instance d’éternité15.
Fabien Vasseur
- Texte repris dans Poèmes 1960-1970, Poésie/Gallimard, p. 76.
2. On peut s’étonner qu’il ait fallu attendre quatre mois pour voir réaliser cette fiche « nécrologique ». Si je l’ai proposée très vite à l’OFC, je devais en revanche la laisser mûrir. Ayant connu personnellement Michel Deguy, et l’ayant un peu fréquenté, je lui dois beaucoup : il a présidé mon jury de thèse, publié mes premiers poèmes et mon unique recueil à ce jour. Une amitié aurait pu naître, mais nous nous sommes brouillés puis éloignés. Je lui ai toujours conservé un attachement et une admiration sincères.
3. Jumelages (1978), in Poèmes II 1970-1980, Poésie/Gallimard, p. 105.
4. Gisants (1985), in Comme si Comme ça. Poèmes 1980-2007, p. 105.
5. Ouï-dire (1966), in Poèmes 1960-1970, op. cit., p. 49. Voir aussi son dernier livre, posthume, intitulé La Commaison, L’Extrême contemporain, 2022.
6. La poésie n’est pas seule. Court traité de poétique, Seuil, 1987, p. 183.
7. L’Impair, Farrago, 2001, p. 9-10.
8. Souvenir de 1999, lors d’une soutenance d’habilitation : Deguy dans le jury (tandis qu’un autre parle), le visage figé dans une immobilité hirsute, crochue, écarquillée, absorbé dans cette posture par l’attention, la distraction ou la consternation – on n’aurait su le dire. Au marché de la Poésie, en 2001 : « T’as du feu, Vasseur ? » Soudain, sur un ton surjoué de surprise : « Oh ! Qu’est-ce que c’est ? », le doigt pointé vers le ciel, à l’ouest, où flotte un ballon dirigeable… En 2020, la lecture sur YouTube de son poème-calembour du confinement, Coronation, est encore à sa façon le sketch d’un vieux pitre de 89 ans.
9. Il en avait proposé le manuscrit, via Lucette Finas, à Maurice Nadeau, qui le refusa, en déclarant : « On ne parle pas de foi dans ma maison ! » Le livre parut chez Bayard.
10. Noir, impair et manque. Dialogue avec Bénédicte Gorrillot, Argol, 2016, p. 40.
11. Sans retour, Galilée, 2004, p. 19. Ce livre constitue une réponse à Être juif, de Benny Lévy qui, avant de mourir, avait éreinté méchamment « L’humanité juive », chapitre final d’Un homme de peu de foi.
12. Un homme de peu de foi, Bayard, 2002, p. 63.
13. Ibid., p. 117.
14. « L’iconoclaste », Comme si Comme ça, op. cit., p. 424.
L'Observatoire Foi et Culture
Observatoire Foi et Culture
L’Observatoire Foi et Culture (OFC), voulu par la Conférence des évêques de France a pour objectif de capter « l’air du temps » en étant attentif à ce qui est nouveau dans tous les domaines de la culture : la littérature,[...]

