Philippe Jacottet
Fiche de l’Observatoire Foi et Culture (OFC) du mercredi 1er septembre 2021 à propos des ouvrages suivants : Le Dernier livre de Madrigaux, La Clarté Notre-Dame, Bonjour Monsieur Courbet, La Dogana.
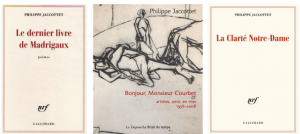 Par une étrange ironie de l’histoire, Philippe Jaccottet est mort – à 95 ans, le 24 février – une semaine avant la parution de ses derniers ouvrages1. Ce n’était pas tout à fait une surprise pour ses proches, qui le veillaient depuis plusieurs mois : le poète avait déjà fermé les yeux sur le monde. Pour ses lecteurs, ses admirateurs, le choc a été profond : à force de le voir défier la mort, de livre en livre, ou plutôt chercher à l’apprivoiser, tel un dompteur intérieur, on avait fini par le croire immunisé contre son pouvoir. Mais il y a eu aussi l’étonnement de découvrir presque aussitôt le testament spirituel du poète, en des pages bouleversantes.
Par une étrange ironie de l’histoire, Philippe Jaccottet est mort – à 95 ans, le 24 février – une semaine avant la parution de ses derniers ouvrages1. Ce n’était pas tout à fait une surprise pour ses proches, qui le veillaient depuis plusieurs mois : le poète avait déjà fermé les yeux sur le monde. Pour ses lecteurs, ses admirateurs, le choc a été profond : à force de le voir défier la mort, de livre en livre, ou plutôt chercher à l’apprivoiser, tel un dompteur intérieur, on avait fini par le croire immunisé contre son pouvoir. Mais il y a eu aussi l’étonnement de découvrir presque aussitôt le testament spirituel du poète, en des pages bouleversantes.
Ces trois livres, désormais posthumes, n’ont pas le même statut ni la même portée, chacun reflétant une facette différente de leur auteur. Le Dernier Livre de Madrigaux se présente comme un court recueil de poèmes écrits en 1984, dont certains avaient paru en revue, et qui, placé sous le signe de Claudio Monteverdi, exalte le versant païen, sensuel et baroque de la poésie de Jaccottet, ainsi que sa passion de la musique. Bonjour, Monsieur Courbet, coédité par son fils Antoine (Le Bruit du Temps) et son neveu Florian Rodari (La Dogana), offre une anthologie de textes critiques sur divers artistes, dont beaucoup furent aussi des amis, de Chagall à Giacometti, de Lélo Fiaux à Jean Eicher, de Jean-Claude Hesselbarth à André du Besset, en passant par sa propre épouse, Anne Marie Jaccottet-Haesler, et nous rappelle quelles furent l’étendue de sa curiosité et l’acuité de son jugement esthétique.
Mais le plus marquant des trois livres est sans conteste La Clarté Notre-Dame, publiée par Gallimard dans un format inhabituel de sa collection « blanche » (23,5 × 18,5 cm), seul véritable inédit, l’ultime testament – et formellement une sorte de dernier cahier de la Semaison. Son titre sonne comme une énigme religieuse : il faut y lire le nom d’un monastère du village de Taulignan, près de Grignan, fréquenté par des sœurs dominicaines. En effet, le point de départ du livre est une promenade, un jour de mars 20122, dans une campagne déserte et sous un ciel gris de fin d’hiver, où se fait entendre en contrebas du vallon « la petite cloche des vêpres » de ce couvent, encore invisible, et que le poète identifie à « une espèce de parole, d’appel ou de rappel » (p. 11). Ce son pur et « véritablement cristallin » (p. 12), interrogé, remémoré, rapproché par la suite d’autres tintements, jusqu’à de lointains souvenirs d’enfance, et d’autres expériences intenses (autant de récapitulations des grands thèmes de l’œuvre), devient un de « ces signes dont Hölderlin, justement, a écrit qu’ils “aident le ciel” » (p. 30), même si Jaccottet minimise d’abord la « résonance religieuse » (p. 16) de son émotion. Cette résonance n’en cesse pas moins de croître, au fil de pages écrites de plus en plus difficilement, à toujours plus grande distance les unes des autres.
On doit à la poétesse suisse José-Flore Tappy, éditrice des œuvres de Jaccottet dans la Pléiade, d’avoir accompagné la genèse du livre – qui s’étend sur pas moins de neuf ans – avec une complicité telle que le poète, un an avant sa mort, lui « a confié avec la plus grande témérité la tâche d’en établir le texte », comme elle l’a révélé au journal Le Temps3. Présente elle-même à la fameuse promenade, elle souligne son aveu tardif que « ce moment avait été le dernier à susciter en lui le désir d’écrire », et nous apprend aussi que la dernière partie – un « Post-scriptum » daté du 7 juin 2020 –, est la transcription du dernier d’une série d’entretiens quotidiens qu’il avait souhaité avoir avec elle à Grignan, où il lui aurait « récité la part manquante du puzzle ». Un tel abandon, plein de confiance, compte beaucoup dans le mystère de cette dernière œuvre : la figure fugitive d’Antigone (« lumière de mes yeux », p. 25), porte sans nul doute la trace de celle à qui, dit elle, « il [l’a] remise aveuglément pour [qu’elle] la porte jusqu’au bout ».
Dernière variation sur le « combat inégal » (p. 22, p. 31), qui chez Jaccottet oppose la fragilité des fameux signes au poids presque démesuré du mal et du malheur, l’ouvrage introduit dans sa seconde partie un contraste extrême : le témoignage glaçant d’un journaliste belge, un temps retenu dans les geôles du régime syrien, et qui, alors qu’il marche vers sa libération entend les cris de torture des prisonniers qui n’en sortiront pas. Le poète, obsédé par ce témoignage, y revient inlassablement, comme à un symbole absolu de l’horreur, une sorte de contre-réalité capable de ruiner toute espérance. L’effet du mal est ici d’autant plus pervers qu’il s’immisce au cœur même de la beauté, puisqu’en Syrie l’on torture jusque sous les sites antiques : « Il se pourrait, je l’ai dit, que cela se soit produit dans les prisons souterraines de Palmyre, alors qu’en 2004, avant le désastre, j’avais pu y faire, tout au contraire, des pas enchantés4. Comment, après cela, croire encore aux enchantements ? » (p. 32)
Ce n’est pas la première fois que Jaccottet s’identifie aux mourants, aux suppliciés, qu’il essaie de soutenir l’horreur du monde, comme pour éprouver ce qui lui résiste5. Mais l’obstacle apparaît cette fois d’autant plus insurmontable, et potentiellement définitif, que le poète, dans ses ruminations macabres, sent venir sa propre agonie, qu’il l’imagine encore dans les termes du supplice (lapidation, « corps déchiré », p. 37), ou se voit simplement en « vieillard reculant » (p. 24). D’autre part, le mal semble cette fois tellement surnaturel que seul un bien lui-même surnaturel pourrait alors lui répondre. Jamais les cris « montés d’un des plus bas cercles de l’Enfer » (p. 23) n’avaient paru si proches, comme près de l’attirer à lui. C’est pourquoi le « rappel » de la petite cloche est d’emblée si important, qu’il agit si puissamment dans le texte, osons le dire (c’est de saison), presque comme un vaccin contre le mal. On dirait qu’il y répand les anticorps de la transcendance rédemptrice, jusque dans les passages les plus désespérés.
Le combat inégal est (re)devenu combat spirituel. Contre les images les plus diaboliques de la mort, il faut que l’emportent les signes d’une vie plus haute. Dans Paysages avec figures absentes, décrivant la tension psychique de Hölderlin au seuil de la folie, Jaccottet suggérait l’impression que « tout alors se rapproche du poète […] les dieux et les choses, mais aussi bien les pensées6[…] », et à propos de Rilke agonisant, et des « reflets infernaux » de son dernier poème, il écrivait que « c’est dans cette lumière-là que le Christ se rapproche, et qu’il grandit7 ». C’est un phénomène analogue qui se produit dans ce dernier livre, à travers le dolorisme des figures souffrantes qui sollicitent implicitement l’intercession du Crucifié ; plus encore à travers les évocations de l’univers chrétien ou de la réalité liturgique : travail ou méditation des moniales, rêverie sur le printemps renaissant « comme une invasion du monde autour de lui » (p. 26) (digne de l’enchantement du Vendredi saint dans le Parsifal de Wagner !), portrait inoubliable de l’organiste en « maître des avalanches sonores », avec cette idée consolatrice que « le chant aura été chanté tout de même, et rien ne pourra faire qu’il ne l’ait pas été » (p. 26-27). Si l’on ajoute les médiations de Dante et de Hölderlin dans l’acheminement vers la prière finale (laissons au lecteur le soin de la découvrir), on pourrait presque parler d’une foi retrouvée à travers une dispersion de traits, qui confirme le refus jaccottéen de tout dogmatisme, au profit d’une ferveur infiniment accueillante.
La petite cloche, qui se donnait au départ « un peu comme une espèce de source suspendue en l’air » (p. 18), figure à la dernière page comme le but sourdement recherché, les nombreux détours ayant reconduit le poète « en direction de quelque chose qui indéniablement était la Clarté Notre-Dame » (p. 44). Avec cet aveu bouleversant : « Comme maintenant, si tard dans ma vie, cela me devenait clair et profond ! »
Fabien Vasseur
1. Rappelons qu’à la même époque, datée – pure coïncidence – du 24 février, était parue la fiche OFC n° 8, où Robert Scholtus rendait compte de ma petite monographie, Philippe Jaccottet. Le combat invisible (Lausanne, Savoir suisse, novembre 2020).
2. Jaccottet précise même, scrupuleusement, « le 4 mars » (p. 11).
3. « La Clarté Notre-Dame. Le testament lumineux de Philippe Jaccottet », Le Temps, 6 mars 2021, p. 32.
4 Voir le chapitre « Palmyre » dans Un calme feu, Fata Morgana, 2007, p. 49-60.
5 Contentons-nous de rappeler que le premier livre (non renié) de Jaccottet, le Requiem de 1947, était dédié aux jeunes maquisards du Vercors torturés et assassinés par les nazis. Le référent liturgique de la messe des morts y avait son importance. Or la mémoire de ce livre est aussi très présente dans La Clarté Notre-Dame.
6 Paysages avec figures absentes, Gallimard, 1970, 1976, p. 153.
7Ibid., p. 169.

